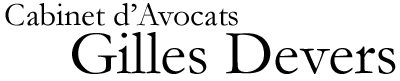Livre 3
Droit de la santé
Chapître 1 :
Le cadre de la responsabilité médicale
Il existe trois régimes de responsabilité : civile, pénale et disciplinaire. Comment les distinguer ?
Ces trois régimes sont liés, mais ils répondent à des buts différents.
La responsabilité civile est orientée vers l’indemnisation des patients, souffrant d’un préjudice, et le procès civil est dirigé contre l’assureur du professionnel libéral ou de l’établissement de santé où le professionnel exerce.
Le procès pénal concerne directement les personnes, dont la responsabilité individuelle est recherchée. Pour parler juste, il faut utiliser le mot de « culpabilité ». Au pénal, chacun répond de sa propre faute. Si un professionnel par sa faute a causé un dommage à un patient, sa responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Dans les faits, il est plus facile pour la famille d’engager le recours au civil contre l’établissement, mais il reste toujours cette possibilité de la plainte pénale.
La responsabilité disciplinaire traite des enjeux professionnels vis-à-vis de l’employeur ou de l’institution ordinale.
Ces trois régimes se cumulent-ils ?
Oui. Dès lors qu’une faute a causé un dommage, chacun des régimes de responsabilité peut s’engager, et pour un même fait, il peut donc y avoir des procédures au civil, au pénal et au disciplinaire.
Qui choisit entre ces trois procédures ?
Pour le civil et le pénal, c’est le patient, qui décide d’engager un recours civil contre l’établissement ou de déposer une plainte pénale. Pour le disciplinaire, l’initiative revient aux directeurs d’établissement.
Pour le patient, quels sont les critères ?
Depuis une vingtaine d’années, nombre de règles ont été adoptées pour orienter le patient vers la responsabilité civile. À ce jour, c’est incontestablement le procès le plus simple : le patient agit non pas contre les professionnels mais contre l’établissement, qui doit répondre de toutes les fautes commises par le personnel, et qui est assuré pour cela. Aussi, la très grande majorité des recours, environ 95 %, sont exercés selon les règles de la responsabilité civile.
Qu’est-ce que la responsabilité administrative ?
C’est la responsabilité civile dans le cadre des établissements publics, et elle relève de la juridiction administrative.
Le pénal est-il amené de disparaître ?
Non, le pénal ne disparaîtra pas. Une personne qui par sa faute cause un dommage corporel à autrui, voire peut-être le décès, cela justifiera toujours une procédure pénale. Simplement, des mesures législatives ont été prises pour cantonner le pénal aux affaires les plus graves. C’est donc une bonne évolution du droit.
La responsabilité est-elle engagée en cas d’erreur médicale
Non. Cette affirmation, si souvent entendue est fausse : l’erreur ne suffit pas, car la responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute. Errare humanum est… Le droit est complexe, mais il est plein de bon sens.
Pour les professionnels, le risque de mise en cause est envahissant.
Non. Le droit de la responsabilité médicale a beaucoup évolué. Il restera toujours un risque de mise en cause du professionnel de santé lorsque par sa faute, il a causé un dommage corporel. Mais, ce risque judiciaire, certain, n’est pas envahissant, loin de là, et la loi tente de le cantonner aux situations les plus graves, car le but du droit est de trouver un équilibre : sanctionner les fautes et permettre la prise de risques qui est inhérente à tout acte médical.
Les procès restent rares, mais il est logique qu’un acte médical fautif, ayant causé un dommage, engage la responsabilité.
Les professionnels de santé sont-ils plus concernés que d’autres ?
Oui. Pour comprendre, il faut partir de la valeur protégée, le corps humain. S’il est bien une question que les professionnels de santé ne se posent pas, c’est celle de la finalité de leur activité, tant l’acte médical est ressenti comme bienveillant par nature. C’est une évidence, mais, sur le plan du droit, l’analyse est sensiblement différente. En effet, un acte médical est une intrusion sur le corps humain.
La pratique médicale est conforme à la loi si elle respecte les conditions fixées par la loi, à savoir l’article 16-3 du Code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Ce qui est en jeu, c’est la protection du corps humain
Oui, et c’est la base de tout raisonnement juridique. Dans la tradition juridique, très marquée par les fondamentaux de la philosophie, le corps est le substratum de la personne. Le corps est la personne, ce qui justifie que la loi lui accorde la plus haute des protections. La personne n’est pas propriétaire d’une chose qui serait son corps. Il existe un tout indissociable entre le corps et la personne… Toute atteinte au corps est une atteinte à la personne. Les professionnels de santé sont soumis à une responsabilité exigeante parce que le plus quotidien de leurs actes met en cause ce que la loi protège le plus, le corps humain, et surtout à un moment où la personne est en situation de faiblesse. Aussi, il est normal que la loi aille loin dans la protection de la personne, et donc dans la responsabilité des professionnels de santé. Mais elle fixe tout de même un critère équilibré : cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute.
Quelle est le fondement juridique de cette responsabilité ?
Ce fondement a été posé par la Cour de cassation par le célèbre arrêt Mercier de 1936 et cette jurisprudence n’a jamais été remis en cause : « Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».
Pour la Cour de cassation, la responsabilité du médecin est subordonnée « à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical ». Aussi, d’une part il n’y a de responsabilité que s’il y a eu une faute, et d’autre part, cette faute est le fait de ne pas avoir mis en œuvre les moyens dont on dispose pour aller vers le meilleur résultat possible.
Et l’erreur ?
L’erreur est l’acte ou la décision qui se révèle inapproprié, mais qui résulte d’un processus diligent et attentif, ayant pris pour référence les données scientifiques acquises. La démarche a été professionnelle, mais il y a eu un petit manque d’analyse ou quelque chose qui est passé à côté. C’est une erreur, pas une faute.
Il n’y a pas de critère absolu de distinction, et le juge tient le plus grand compte de l’avis des experts, qui analysent en fonction des pratiques professionnelles.
Quid pour une erreur de diagnostic ?
La première donnée est de type objectif : le diagnostic n’est pas celui qui avait été porté à l’origine. Il y a eu erreur,… mais cette erreur est-elle fautive ? C’est toute la question. Si le médecin a agi dans ton domaine de compétence, en prescrivant les examens adaptés, en sollicitant des avis spécialisés, avec un bon interrogatoire du patient et une solide étude du dossier, et que malgré tout, il s’est trouvé devant une situation qu’il n’a pas pu analyser, on ne retiendra pas la faute. Si en revanche, il s’est aventuré sur des terres qui ne sont pas les tiennes, qu’il n’a pas sollicité les avis spécialisés, et qu’il a omis des examens reconnus comme nécessaires, ou que tu as procédé à une lecture inattentive de ces examens, en omettant des données qu’il aurait dû voir, on entrera dans le domaine de la faute.
Est-ce qu’on retrouve les mêmes règles à l’hôpital public ?
Dans l’analyse juridique, on ne retrouve pas la notion du contrat. Le patient est usager d’un service, et il est en droit d’attendre une certaine qualité du service. La pratique procédurale est différente, mais on retrouve des données assez proches. Pour comprendre, il faut revenir à la source, c’est-à-dire à la définition du service public et au régime de sa responsabilité.
On ne raisonne pas à partir d’une relation individualisée, mais en fonction de la logique du service. Le service hospitalier doit produire une certaine qualité des soins, qui est en corrélation avec les moyens qui lui ont été alloués. S’il n’offre pas cette qualité, il se situe sur le terrain de la faute. La jurisprudence n’évoque jamais la faute médicale ou la faute hospitalière mais « la faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier », ce dans des approches très contextualisées.
Çela parait assez proche de « l’obligation de moyens » de l’arrêt Mercier…
Oui. Au cas par cas, il est demandé, en tenant compte de la meilleure pratique médicale de répondre à cette question : « Au regard de ce qui est attendu du service public hospitalier, les faits traduisent-ils un manquement ou une insuffisance que l’on puisse qualifier de faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ? » Si le service public n’a pas répondu au niveau que l’on était en droit d’attendre, alors la responsabilité est engagée.
Le pénal connait-il cette distinction entre l’erreur et la faute ?
Bien sûr. Un juge ne condamne pas pour une simple erreur ! Avec le pénal, on passe de la responsabilité à la culpabilité, référence qui en elle-même porte le terme de la faute. Le civil est orienté vers les droits de la victime dans l’idée d’une compensation, avec le grand rôle des compagnies d’assurances. A l’opposé, le pénal est lui centré sur l’auteur des faits : est-il coupable ou non ? Ainsi, il ne peut y avoir de culpabilité pour une erreur. La culpabilité commence quand est atteint le degré de la faute.
Comment est définie la faute ?
Le Code pénal connaît, par principe, la faute intentionnelle, c’est-à-dire celle commise avec intention de nuire, et qui est le lot courant des tribunaux correctionnels. Mais en matière de responsabilité médicale, joue la notion complémentaire de faute involontaire.
Faute involontaire… « Faute » et « involontaire », c’est conciliable ?
La faute est involontaire car l’auteur n’était pas animé par l’intention de nuire. La référence est l’article 121.3 alinéa 3 du Code pénal, qui retient les notions de maladresse, négligence ou inattention : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
Quid pour un geste chirurgical malheureux ?
Le premier signe, c’est l’apparition du dommage corporel, mais cette donnée objective ne veut pas dire que le geste est fautif : le Procureur prouve-t-il que le médecin a été imprudent ou négligent dans sa démarche ?
Quels critères pour le passage entre l’erreur et la faute ?
C’est la distinction entre la prudence ou l’imprudence, l’attention ou la négligence, l’action attentive ou l’inattention. L’erreur est une ligne de défense devant un juge : « Oui, Monsieur le juge, j’ai commis une erreur et je le regrette, mais je n’ai pas commis de faute car cette erreur ne résulte pas d’une négligence, d’une maladresse ou d’une inattention ». Ce à quoi le juge pourra répondre : « C’est votre défense, mais en fonction des éléments qui ressortent du dossier, je considère au contraire que votre erreur a été causée par une abstention, une négligence ou une imprudence et votre culpabilité est retenue pour cette faute involontaire commise sans intention de nuire ».
C’est un vrai risque juridique pour les professionnels.
Oui, et c’est un vrai problème. Le droit doit permettre et même encourager la prise des risques nécessaires à la pratique de la médecine. Un droit trop sévère conduirait les professionnels à éviter les situations à risques. Or, le véritable risque au point de vue sanitaire n’est pas que des préjudices qui méritent considération ne soient pas indemnisés, mais que l’on ne trouve plus les médecins capables de prendre les risques nécessaires pour aller toujours plus en avant face à la maladie.
Que dit la loi du 10 juillet 2000 ?
L’objet de la loi du 10 juillet 2000 était de requalifier la pénale involontaire, qui est la pierre angulaire de la responsabilité pénale médicale. Sans remettre en cause le principe de la faute involontaire, le Législateur a voulu en préciser le contenu, pour le recentrer vers la notion de faute. Elle distingue « l’acteur » et « le décideur ».
Quid pour l’acteur ?
Pour les « acteurs », donc celui qui prodigue des soins aux patients, le principe reste la faute, « d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Le tribunal doit prouver que le professionnel n’a pas accompli les « diligences normales » compte tenu « de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose ». La loi attend des diligences normales, et donc ni exceptionnelles, ni géniales, ni infaillibles….
Quid pour le décideur ?
Le législateur a pensé qu’il fallait protéger celui qui est a pour tâche d’organiser le travail commun, et qui doit à cet effet prendre nombre de décisions. Ce rôle du « décideur » est essentiel et il est apparu nécessaire de lui créer une zone d’autonomie supplémentaire, pour qu’il puisse assumer sereinement cette fonction d’encadrement. La loi définit d’abord ce décideur : c’est celui qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Dans le fonctionnement des hôpitaux, cela concerne toutes les fonctions de direction ou d’encadrement. Pour que ce décideur soit reconnu pénalement coupable, la référence aux diligences normales ne suffit plus. Il faut prouver soit qu’il a violé « de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité » prévue par la loi ou le règlement, soit qu’il a commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Quel est l’apport de la loi du 4 mars 2002 ?
Cette loi a mis en place d’un régime d’indemnisation pour les accidents médicaux, quand le seuil de la faute n’a pas été atteint. Maintenant, tu trouves à côté du classique – la responsabilité pour faute avec garantie de l’assureur – le nouveau, à savoir un régime d’indemnisation sans faute, dont le financement est assuré via la solidarité nationale.
Comment définir un « accident médical » ?
L’accident médical se situe entre la bonne pratique et la faute, et regroupe le champ de l’erreur, acte prudent et diligent mais qui se révèle inapproprié, et l’aléa, acte non critiquable mais ayant causé un dommage imprévisible. La seule exclusion est l’évolution naturelle de la maladie. Il faut que l’acte médical, quoique non fautif, ait été la cause d’un dommage corporel.
Quelle indemnisation ?
On passe ici de la responsabilité à la solidarité. Le financement relève de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages causés par les accidents médicaux et les infections nosocomiales, les vaccinations obligatoire ou les contaminations VIH ou l’hépatite C. C’est un régime de solidarité, sous le contrôle de l’Etat, qui complète aussi le rôle de la Sécurité sociale.
Quel est le rôle de la Sécurité sociale dans la responsabilité médicale ?
La Sécurité sociale est le premier recours des malades, car elle assure, comme un droit, la prise en charge de tous les frais médicaux permettant de réparer les conséquences des fautes médicales.
De telle sorte, la Sécurité sociale joue comme la principale protection des médecins. Cette réalité législative, fondée sur la solidarité, ruine les fantasmes sur la judiciarisation de la médecine, entendue comme la multiplication des procès, comme aux US. Mais là-bas, la première cause des procès, ce sont les recours entre les compagnies d’assurances, pour obtenir le remboursement de frais médicaux avancés. La Sécurité sociale est au centre de tout. La sagesse est d’avoir su concilier la solidarité et la responsabilité.
Comment définir la procédure de référé ?
Le référé est une procédure urgente qui peut être utilisée pour les demandes simples, et joue comme un avant-procès. Un patient qui envisage d’engager une procédure, cherche à réunir des informations et des preuves. Le référé va vite, car justement le juge en reste à des mesures d’instruction et ne statue par sur le fond de l’affaire.
En général, le patient agit en référé pour obtenir une expertise. Si le récit est crédible, laisse apparaitre une situation méritant un avis d’expert et que sont jointes quelques pièces médicales parlantes, le juge désigne un expert.
Un tribunal ne peut pas se prononcer sur une affaire médicale sans avis d’expert, car ce n’est pas son domaine de compétence. Si l’expertise conclut que les soins ont été de qualité, l’affaire en restera là. Un référé est une vraie procédure, mais l’engagement du référé ne veut pas dire qu’il y aura un procès.
Au stade du référé, on veille surtout à ce que la mission soit pertinente.
Les délais sont longs ?
Non. En référé, la date est souvent très proche, soit à quelques semaines. Ces procédures vont vite, dans la mesure où on ne demande pas au tribunal de juger l’affaire, mais seulement de désigner un expert.
Le professionnel de santé ne comparait pas en personne, car s’agissant d’une affaire civile, l’affaire est gérée par son assureur, s’il exerce en libéral, ou l’assureur de son employeur s’il est salarié ou agent public.
Le professionnel libéral doit-il aviser son assureur ?
C’est un impératif absolu. En libéral, la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile est une obligation. En signant ce contrat, il a transféré à l’assureur la gestion du risque. C’est donc à lui de gérer le litige, de désigner un avocat, et de tenir informé de la procédure.
Pour les professionnels salariés ou praticiens hospitaliers ?
Ils ne sont pas avisés personnellement. La procédure est engagée contre l’établissement dans lequel ils exercent, qui gère avec son assureur.
Quel est le rôle du professionnel de santé dans une procédure civile ?
Du fait du transfert du risque à l’assureur, c’est celui-ci qui assure la direction du procès. Le professionnel de santé coopère au mieux avec l’assureur, mais il ne peut avoir de rôle au premier plan, et il doit faire attention à ne pas engager l’assureur par des déclarations qui empireraient sur la direction du procès.
Le professionnel étant en cause, il peut transmettre les éléments nécessaires à l’assureur sans atteinte au secret médical, ce d’autant plus qu’il s’agit de répondre au patient, qui le plus souvent, verse lui-même le dossier médical aux débats. L’assureur désignera un médecin-conseil, qui deviendra le vrai interlocuteur pour la préparation du dossier.
Qu’est ce que la procédure de conciliation ordinale ?
Lorsqu’il reçoit une plainte d’un patient, le conseil départemental de l’Ordre dont dépend le professionnel a l’obligation d’organiser une réunion de conciliation, avant d’éventuellement saisir l’instance régionale, qui est la chambre disciplinaire.
C’est l’occasion pour le médecin de donner des explications, voire de faire amende honorable. C’est l’occasion de donner des explications et de présenter des regrets, avec tact et sincérité, en gardant à l’esprit que toute imperfection n’est pas une faute…
Quel est le résultat d’une conciliation ?
En droit, la « conciliation » veut dire que l’on transige une affaire par un arrangement financier, ce qui est impossible dans le cadre déontologique du conseil de l’Ordre. C’est à l’assureur de gérer les transactions. En réalité, il s’agit moins de conciliation que de médiation : des tiers, les conciliateurs du Conseil de l’Ordre, cherchent à créer un dialogue pour restaurer la confiance et désamorcer un contentieux. La marge est étroite, car cette réunion ne peut avoir pour effet de dissuader le patient de saisir la justice, ce qui est un droit fondamental.
Si le patient n’a pas consulté d’avocat, il a pu se tromper et penser que le conseil de l’ordre lui permettra d’obtenir une indemnisation, ce qui est strictement impossible.
Et en cas d’échec de la conciliation ?
En cas d’échec, le patient maintiendra sa plainte et le conseil départemental devra transmettre à la chambre disciplinaire. Si le conseil départemental estime l’affaire sérieuse, il pourra porter plainte lui aussi.
Comment se passe la procédure devant la chambre disciplinaire ?
Le président de la chambre, un magistrat professionnel, notifie la plainte et les pièces au professionnel, et l’invite à présenter sa défense par un mémoire écrit. S’agissant d’une procédure de base écrite, le mémoire est le pivot de la défense. Est désigné pour chaque affaire un conseiller rapporteur, qui n’est pas un enquêteur mais s’assure que chaque partie a pu exposer ses arguments, et que ces arguments ont été échangés, pour que le débat soit contradictoire. Quand le nécessaire a été fait, le dossier est renvoyé à une audience pour jugement.
Comment se déroule l’audience ?
La trame de la défense a été posée par écrit, mais l’audience compte beaucoup, et elle doit être préparée comme une rencontre, pour compléter l’approche écrite. L’audience s’ouvre par la lecture du rapport, qui doit être une présentation objective de l’affaire. Chaque partie s’exprime, et les membres de la juridiction peuvent poser des questions. C’est le médecin poursuivi ou son avocat qui a la parole en dernier. Comme beaucoup de choses ressortent des mémoires écrits, l’audience va assez vite et le savoir-faire de l’avocat pour repérer ce qui se passe et réagir dans un esprit de synthèse est très utile.
Le résultat est connu immédiatement ?
Non. La chambre disciplinaire délibère immédiatement mais il faut ensuite rédiger le jugement. C’est le secrétariat de la juridiction qui assure la notification, pas courrier recommandé AR, et s’ouvre alors un délai de un mois pour enregistrer un appel. Passé cette date, la décision devient définitive et la sanction doit être effectuée.
Des voies de recours ?
Un mois à compter de la première présentation du courrier notifiant la décision pour faire appel devant la Chambre disciplinaire national, qui siège à Paris, et qui réexaminera toute l’affaire. L’appel est suspensif.
Un professionnel de santé peut-il être entendu par la police pour une faute professionnelle alléguée ?
Oui. C’est l’un des aspects de la responsabilité médicale. Pour une simple faute d’imprudence ou d’inattention, et parce que le patient estime qu’il y a eu imprudence ou inattention, un praticien peut faire l’objet d’une enquête pénale.
La plainte est déposée par le patient, par hypothèse avant une étude approfondie. La police reçoit la plainte et doit enquêter, et l’ouverture de l’enquête ne veut pas dire qu’il y aura jugement ou condamnation.
Quelles sont les modalités de la convocation ?
C’est informel : par tout moyen, un appel téléphonique ou un avis dans la boite aux lettres. La convocation n’indique pas les motifs, et il n’y a pas d’accès au dossier. L’enquête est secrète et la personne entendue l’est en qualité de témoin.
La police doit tout vérifier et être très prudente à l’origine. Il peut d’agir d’une plainte intempestive, qui tombera d’elle-même après une première analyse des faits. A l’inverse, si l’enquête confirme les griefs, la loi oblige alors à passer à leur notification, par une mise en examen ou un renvoi devant le tribunal. Le professionnel mis en cause devient ensuite partie à la procédure, et il accède au dossier.
L’affaire peut en rester à cette audition, sans aucune suite ?
Oui, c’est fréquent. La police reçoit une plainte qui, vu le récit des faits, parait sérieuse, et une fois les vérifications faites, les enquêteurs constatent que les éléments de qualification pénales ne sont pas réunis.
L’assureur est-il impliqué dans le pénal ?
Pas directement : le pénal est une affaire personnelle. Mais une affaire pénale est susceptible d’avoir des suites civiles, qui resteront à la charge de l’assureur, et il faut donc transmettre les informations dès qu’elles sont assez formalisées.
L’avocat ?
L’avocat est indispensable dans une affaire pénale et à tous les stades de la procédure. Le professionnel mis en cause a besoin d’un conseil individualisé, confiant et secret. L’assureur peut proposer un cabinet, mais la liberté de choix est totale.
Il faut contacter l’avocat dès que possible, pour une première analyse, en fonction des infirmations pouvant être réunies, et déterminer les points qui méritent une attention particulière.
Le professionnel de santé peut-il se trouver en garde-à-vue ?
Sur le principe, la garde-à-vue est possible car les enquêtes pour homicide involontaire ou blessures involontaires le permettent. Mais les circonstances de l’enquête justifient rarement cette mesure, car une audition de quelques heures est suffisante.
Quelle information sur la suite de la procédure ?
À ce stade, le professionnel a été entendu comme témoin, et le Code de procédure pénale ne prévoit pas que l’on informe les témoins de la suite d’une enquête. Si l’enquête ne fait rien ressortir, car la plainte s’avère non fondée, le dossier sera classé sans que le professionnel soit avisé. Si l’enquête a confirmé les griefs, le dossier sera transmis au procureur qui désignera un juge d’instruction afin de poursuivre les investigations, notamment par la désignation des experts. Les indices étant suffisants, le juge doit prononcer la mise en examen, qui permet l’accès au dossier et l’exercice des droits de la défense.
Quelle place pour l’expertise ?
C’est la phase la plus médicale de la procédure. L’expertise judiciaire a un rôle décisif dans le procès en responsabilité, car les hommes de loi – avocats et magistrats – n’ont pas les compétences pour remettre en cause les analyses des experts médicaux.
Quel est le statut d’un expert judiciaire ?
C’est d’abord un médecin en activité, qui a effectué des démarches montrant ses aptitudes à effectuer des expertises. Il est alors inscrit sur la liste des experts, prêt à recevoir des missions des tribunaux. Les juges peuvent aussi désigner des experts non-inscrits sur la liste, si cela leur parait plus pertinent. Cette pratique de l’expertise est générale. Des affaires de plus en plus techniques sont confiées à la justice, et les juges ont besoin d’avoir l’éclairage des hommes de l’art sur les aspects techniques qu’ils ne maîtrisent pas. C’est la formule du Code de procédure civile : le juge a besoin des lumières d’un technicien. Après l’expertise,
Quelle est la procédure d’inscription sur la liste ?
Il faut se porter volontaire par une déclaration auprès du procureur de la République. Le candidat doit être en activité, car la justice a besoin de l’avis des praticiens, et l’expertise judiciaire n’est pas une profession. Le candidat justifie lui-même de ses compétences, par tout moyen, et il est a dû suivre des formations universitaires sur la pratique de l’expertise ou l’évaluation du préjudice corporel. Il est alors procédé à une enquête d’ordre général. Au final, c’est la Cour d’appel qui accepte ou refuse l’inscription sur la liste des experts, en tenant compte de manière pragmatique des besoins en expertise dans le domaine sollicité.
Qui désigne l’expert ?
L’expert judiciaire est désigné par un juge, sur une affaire précise, et le juge liste une série de questions qui seront la mission de l’expert, et qui délimitent son intervention : c’est toute la mission et rien que la mission. Au pénal, le magistrat est souvent un juge d’instruction, et au civil, c’est le juge des référés.
Comment le juge choisit-il l’expert ?
Le juge, qui procède à de nombreuses désignations, a parfois son idée, notamment quand il a bien apprécié le travail d’un expert. Les avocats peuvent suggérer des noms d’experts, ou au moins les domaines de spécialisation, et proposer des questions à ajouter dans la mission.
Comment se déroule la réunion ?
L’expert vérifie la liste des présents, donne lecture de la mission et fait le point sur les documents qu’il a reçus. Après, chaque expert a sa méthode, l’essentiel étant que tous les points soient examinés de manière contradictoire. L’expert reprend l’histoire médicale à partir du dossier, en interrogeant les personnes présentes et en recueillant toutes les observations. Ensuite, il demande des observations de synthèse à chacun. Puis il y a un examen du patient plaignant, pour apprécier les séquelles. L’expert procède alors à un premier tur d’horizon des questions posées, pour vérifier qu’il a bien toutes les informations et recueillir les avis des personnes présentes. La réunion prend fin, et l’expert va reprendre tout ce travail d’analyse pour rédiger un écrit, son rapport.
Qu’est-ce que l’on entend par « les dires » ?
Contrairement à leur nom, les dires sont des écrits. L’usage est qu’après la réunion l’expert adresse aux parties un pré-rapport pour recueillir des observations écrites, les fameux dires. C’est l’occasion d’apporter des précisions auxquelles l’expert doit répondre. Le rapport définitif doit inclure la réponse à ces dires.
Quelle est l’autorité du rapport d’expertise ?
L’expert donne des explications sur les faits et ce qui était attendu au regard des bonnes pratiques, mais il n’a pas à qualifier les fautes.
Est-ce toujours le patient qui engage les procès ?
Il peut arriver que ce soit le procureur de la République, mais c’est très rare car le procureur ne dispose pas des informations. En pratique, il ne sera informé que des affaires les plus graves., ou par la plainte elle-même. En pratique, c’est le patient qui agit, dans la défense de ses droits.
Sur quelles bases se décide le patient ? Il n’est ni expert, ni avocat, ni juge…
C’est l’un des grands problèmes. Le point de départ résulte souvent du ressenti, de l’intime conviction du patient. De lui-même, il se rend compte que quelque chose ne s’est pas passé normalement. Il faut bien dire que, parfois, c’est flagrant. Mais souvent, ce sont les médecins qui l’informe qu’il y a eu une faille dans la prise en charge : c’est une obligation légale et déontologique.
La première information doit venir du médecin concerné, mais ce peut être aussi un autre praticien qui a pris le relais ou qui constate que des fautes ont été commises dans la prise en charge. L’information est due au patient qui peut faire valoir ses droits, et toute autre solution serait la loi du silence : insupportable. Ce qui serait choquant, ce serait une dénonciation abusive, et là, pour le coup, c’est une faute disciplinaire.
Mais comment le patient peut-il savoir qu’il est victime d’une faute médicale ?
C’est la grande question, et c’est pour cela qu’il faut s’expliquer sur les évènements indésirables. Le patient peut être impressionné par un échec médical ou par des complications, et construire des raisonnements qui ne tiennent pas, et la suite sera négative pour tout le monde : pour lui, qui verra sa demande rejetée par la justice et pour les médecins mis en cause, tracassés par une affaire qui ne tient pas la route.
En pratique ?
Il faut essayer de prendre des conseils avisés auprès de médecins et d’avocats connaissant bien ces questions. Le premier stade est médical, et le médecin – celui qui a pratiqué les soins ou celui qui prend la suite – doit assurer cette information. S’il y a eu une faute, au moins possible, dans la prise en charge, le patient doit être avisé ; si la patient est confronté à une évolution défavorable, mais qui ne résulte pas d’une faute, il faut aussi lui expliquer. On ne peut pas défendre une sorte de loi du silence qui ferait que les patients se voient privés de l’accès au droit. Et par ailleurs, la franchise dans la gestion de l’information est le meilleur moyen d’éliminer des procédures inopportunes, qui naissent de la méfiance…
Civil, pénal ou disciplinaire : comment le patient choisit-il la procédure ?
C’est une vraie question car plusieurs procédures s’offrent à lui, et pour chaque affaire il faut déterminer le bon terrain procédural. Une erreur d’aiguillage au départ peut être fatale.
Le procès concerne la pratique de la médecine, mais c’est d’abord une question de droit. Le pivot doit être l’avocat qui va analyser au cas par cas comment agir. Il saura aussi prendre conseil auprès de médecin, pour obtenir un premier éclairage. L’une des premières démarches sera de demander une copie du dossier médical. Après il aura à faire deux choix : procès ou pas procès ; civil ou pénal.
Les procédures pénales sont les plus fréquentes ?
Non. Les procédures pénales sont très minoritaires, car elles sont bien complexes. Dans la grande majorité des cas, la victime choisit la voie civile… parce que les chances de succès sont plus grandes. C’est particulièrement le cas quand on agit contre un établissement, public et privé, est en cause. L’établissement, via son assureur répond des fautes commises et des dysfonctionnements du service même, même quand on ne parvient pas à individualiser toutes les fautes. En revanche, au pénal, il faut apporter, et pour chaque fait, la preuve de la faute, la certitude du lien de causalité avec le dommage, et imputer personnellement ces fautes. De plus, le degré de gravité de la faute au pénal est plus élevé qu’au civil. Dans nombre de cas, il peut y avoir responsabilité civile de l’établissement sans qu’on puisse retenir de faute pénale des médecins. Aussi, il est logique que la victime choisisse le terrain procédural le plus favorable.
Mais on dit que la procédure pénale est plus simple, car il suffit d’emporter plainte !
Encore une idée fausse… Bien sûr, il est facile de déposer plainte, mais cet acte simple conduit vers un processus lourd, qui est celui de l’enquête pénale, et qui échappe en grande partie au plaignant. En revanche, dans le procès civil, le patient garde l’initiative et le contrôle de tous les actes de procédure. C’est donc plus compliqué, mais bien préférable.
Un critère pour choisir le pénal ?
Il n’y a pas de critères simples, mais il faut la gravité et la certitude du lien de causalité. La notion de perte de chance, fréquente, ne joue pas au pénal. De même, il faut pouvoir imputer personnellement les fautes, ce qui est parfois difficile avec le travail en équipe ou la surveillance.
Les critères pour le civil ?
Le patient apprécie de pouvoir agir en justice, au civil, contre l’assureur, sans faire condamner le professionnel de santé.
de l’indemnisation du dommage corporel, c’est une question très complexe. Mais juste deux choses. D’abord, pour les affaires courantes, le montant des indemnisations allouées est, dans la tradition française, très modéré, si on compare à ce qui se passe dans des pays proches. Ensuite, pour des préjudices importants, l’indemnisation peut changer la vie, quand elle permet la prise en charge à domicile, avec tierce personne si besoin, et le préjudice économique.
Quels sont les délais ?
Six ans pour une procédure pénale, et dix ans pour une procédure en indemnisation, à partir de l’apparition du dommage.
Quelle stratégie de défense ?
C’est une notion déplacée. Les affaires de responsabilité médicale relèvent du domaine scientifique, et il n’y a pas d’autre stratégie que de se placer au regard des meilleures pratiques. Il y a de la passion dans tout procès, mais tout procès n’est pas passionnel. Aussi, la question est moins une stratégie qu’une méthode.
Mais, ce n’est pas qu’un débat scientifique… C’est un procès !
Oui, et le procès pénal est un affrontement. Le fond relève de l’art médical, mais la méthode est celle de la confrontation des thèses. Il faut assumer cette logique de l’affrontement, qui ne peut se faire que sur une base factuelle stricte. Il n’y pas de lecture simple d’une histoire médicale qui s’est mal passée et le droit de la responsabilité repose sur l’interprétation des règles de droit. Aussi, il y aura débat, et chacun doit de manière nette. Mais dans un premier temps, il faut, à partir des pièces du dossier, chercher la meilleure approche scientifique. C’est de l’étude méthodique de l’affaire que se dégageront les principes qui vont guider la défense.
Que faire quand on se trouve concerné ?
D’abord, faire face et en parler. Cela peut parait idiot, mais l’expérience montre que quand les ennuis s’approchent la tentation de l’autruche est bien présente. Une telle affaire impacte la vie de tous les jours, et on voudrait l’en chasser. C’est une réaction compréhensible. Non, il faut faire face, en parler aux proches, très vite trouver de bons conseils et s’organiser pour sortir au mieux de cette affaire.
Comment choisir l’avocat ?
La compagnie d’assurance peut proposer ses avocats habituels, rôdés à la pratique de ces affaires. Mais s’agissant d’une défense pénale, le choix de l’avocat est toujours libre. Il est indispensable de demander une consultation, et un devis. Les honoraires peuvent être pris en charge par l’assureur, au titre de la garantie de protection juridique, ou l’hôpital public, au titre de la protection fonctionnelle. Quoiqu’il en soit, il faut se sentir en confiance avec son défenseur.
Comment s’organise la défense ?
L’avocat doit expliquer ce qu’est la procédure et quelles sont les règles de droit en cause. Mais il a surtout besoin de comprendre le dossier. Le droit, c’est la seconde étape : il faut d’abord comprendre le fait. L’une de ses premières démarches sera d’obtenir une copie du dossier auprès du juge d’instruction. C’est à l’étude des PV de l’enquête que commence le véritable travail de défense.
On commence par quoi ?
La priorité est de prendre le temps d’une analyse approfondie du dossier, avec les conseils de tiers compétents. Il s’agit de se placer dans la position du juge qui découvre l’affaire à partir des PV. C’est un véritable effort intellectuel que de savoir prendre la distance avec une histoire que l’on connait bien pour le redécouvrir d’un regard neuf. L’essentiel est de parvenir au plus près des faits. Une enquête pénale bien faite conduit à tout vérifier, et les expertises dissèquent les dossiers. Aussi, essayer de ruser avec les faits conduit inévitablement dans une impasse.
Faut-il plaider coupable ou non coupable ?
Cela dépend de chaque dossier. La faute pénale commence avec la négligence ou l’inattention, c’est-à-dire peu de chose. S’il ressort de cet examen que les griefs ne tiennent pas, le praticien mis en cause va se battre pour faire reconnaître ton innocence. En revanche, s’il apparait qu’une faute a bien été commise, et qu’elle ressort du dossier, alors mieux vaut le reconnaitre, et expliquer les circonstances.
Il y a une grande différence entre l’attitude d’un mauvais professionnel et celle d’un bon professionnel mais qui un jour à commis une faute.
Quelle défense si on plaide coupable ?
La défense ne s’arrête pas à la question de la culpabilité. Il reste tout un travail pour définir les limites et le contexte de la faute, et expliquer comment cette faute a pu être commise. Nous commettons tous des erreurs et des fautes, et refuser de reconnaitre ses torts qui ne sont guère discutables donne le sentiment de l’incompétence ou de l’obstination, de telle sorte que le tribunal aura des motifs pour prononcer une sanction aggravée.
Un vice de procédure, pour faire annuler l’affaire ?
Si c’est le cas, on ne se prive pas. Le procès pénal, qui porte l’accusation, répond à des règles strictes. Mais seul l’avocat peut déceler ce vice de forme, et surtout voir s’il est vraiment de nature à permettre une annulation significative de pièces.
Comment se déroule l’audience de jugement ?
La situation est très différente, encore au civil ou au pénal. Dans les procédures civiles et administratives, l’audience est technique, faisant suite d’un dossier écrit, et la présence des personnes à l’audience n’est pas nécessaire. Si elles viennent, elles assistent mais elles ne sont pas entendues. L’audience est un travail technique de conviction du juge, par une présentation organisée des arguments, mais c’est strictement la continuation des écrits qui sont très complets.
En revanche pénale tout le monde comparait et quelles que soient les écrits, il faut procéder une raie instruction à l’audience. L’audience est l’occasion d’un débat contradictoire oral sur tous les éléments du dossier avant les plaidoiries.
Est-ce la même chose pour les affaires civiles et administratives ?
Devant le tribunal administratif, la tradition est celle de la procédure écrite. Aussi, audience un caractère formel, et les plaidoiries sont très courtes, centrées sur des points essentiels, voire absentes. Devant le tribunal de grande instance, il y a la préparation par écrit dont on ne peut pas sortir à l’audience, mais l’audience s’est faite pour qu’il y ait un véritable débat oral devant le juge. Ce débat concerne les avocats.
Au pénal, la personne mise en cause est obligée de comparaitre ?
Non, elle peut se faire représenter, mais dans une affaire de responsabilité médicale, avec des faits toujours complexes, et ce décalage entre la connaissance médicale et la réalité juridique, il est vraiment souhaitable que les professionnels de santé viennent à la barre du tribunal. D’abord, les juges apprécient ce dialogue direct, et pouvoir poser des questions. Ensuite, les professionnels de santé répondront de manière toujours beaucoup plus précise que les avocats mêmes s’ils ont bien travaillé le dossier. Enfin, il arrive fréquemment que les débats, avec leur intensité fasse apparaître des questions nouvelles ou apporte un éclairage nouveau, et la réactivité sera bien meilleure si les professionnels de santé sont là.
Quel est le déroulement de l’audience pénale ?
Le tribunal comporte trois juges, et le président a un rôle central dans la direction des débats.
Le président du tribunal vérifie que toutes les personnes convoquées sont là ou représentées. Ensuite, il va faire un rapport sur le dossier, en présentant les faits tels qu’il a pu les synthétiser de manière neutre, en distinguant les points qui paraissent établis et ceux qui sont litigieux. Puis, il va interroger les uns et les autres, sur le déroulé des faits, et leur analyse. Toutes les parties peuvent elle-même poser des questions.
Après cette période d’interrogatoires et d’étude contradictoire du dossier, le président relève que les débats sont clos, et l’on passe alors aux prises de parole orales des différents intervenants : la partie civile, le procureur, et les avocats de la défense.
Le président du tribunal doit donner la parole à la personne mise en cause en dernier.
L’affaire est alors « mise en délibéré », ce qui signifie que le tribunal va poursuivre son étude du dossier, instruit par tous les éléments de l’audience, pour rédiger un jugement. Il y a donc une autre audience, pour prononcer le délibéré.
La sentence est donc rendue expliquer lors de l’audience de délibéré, et chaque partie dispose d’un délai de 10 jours pour inscrire un appel s’il l’estime justifié.
Le professionnel de santé peut-il refuser de répondre aux questions ?
Oui c’est ce qu’on appelle le droit au silence. C’est un droit de la défense, mais qui doit être utilisé avec discernement. En effet, si le tribunal a l’impression que le droit au silence est utilisé pour ne pas répondre aux questions qui gênent, il en tirera un sentiment et peut-être une conviction.
Est-il encore possible de travailler après une condamnation pénale ?
Oui. Le tribunal correctionnel peut prononcer une interdiction d’exercice, mais il le fait très rarement, seulement dans les cas où le professionnel condamné témoigne d’une incompétence ou d’une désinvolture telle qu’on se pose la question de son aptitude à exercer les fonctions.
Mais pour travailler dans la fonction publique, il faut un casier judiciaire vierge…
Non. La règle n’est pas si simple. Il faut que le casier judiciaire ne comporte une condamnation qui soit incompatible avec les fonctions confiées. Ainsi, il sera difficile de maintenir à l’effectif un professionnel de santé qui aurait été condamné pour une mauvaise affaire de mœurs… Et encore, l’administration devra expliquer sa décision, pour montrer qu’il y a un risque réel. On ne prive pas du droit de travailler comme cela… Pour une faute pénale, commise sans intention de nuire, la pratique générale n’est pas l’exclusion de la fonction publique, loin de là.
Et si un professionnel de santé est condamné au pénal, il doit aussi indemniser les victimes ?
Non, jamais, et là il faut que les choses sont bien claires, car on entend toutes de sorte de bêtises, qui conduisent des aides-soignants à s’assurer. C’est du n’importe quoi. S’il n’y a pas d’intention de nuire – c’est-à-dire de volonté malveillante de causer le dommage – l’indemnisation est toujours prise en charge par l’assureur de l’établissement, et il n’existe aucune possibilité pour lui de se « retourner » contre l’aide-soignante en lui demandant le remboursement. C’est une chose souvent entendue mais qui est strictement impossible… car elle est interdite par la loi.
Le droit commence par la lecture de la loi, et voici une sélection de dix articles qui fondent le droit de la santé.
1/ Droit à la protection de la santé
CSP, Article L. 1110-1
« Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ».
2/ Respect de la dignité
CSP, Article L. 1110-2
La personne malade a droit au respect de sa dignité.
3/ Lutte contre les discriminations
CSP, Article L. 1110-3
« Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles »
4/Droit à des soins de qualité
CSP, Article L. 1110-5
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.
« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ».
5/ Prise en charge de la douleur
Article L. 1110-5-3
« Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.
6/ Suivi scolaire des enfants hospitalisés
Article L. 1110-6
« Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé ».
7/ Principe du libre choix
Article L. 1110-8
« Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
« Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
8/ Droit au soins palliatifs
Article L. 1110-9
« Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ».
9/ Droit à l’information
Article L. 1111-2
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
« La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
« L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
10 / Consentement
Article L. 1111-4
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions ».
Quelle est la base juridique protégeant le consentement du patient ?
Le consentement est une donnée qui concerne le droit fondamental de la personne, et le texte de référence se situe dans les articles-clés du Code civil, à l’article 16-3 :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. ».
Cette donc un devoir déontologique essentiel ?
Oui, et on trouve une excellente formulation dans le code de déontologie médicale, avec les deux articles qui concernent l’information et le consentement.
Article R. 4127-35 CSP
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
« Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
« Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
Article R. 4127-36 CSP
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
« Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
« Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ».
D’autres textes ?
Depuis 2002, un texte détaillé se trouve dans le code de la santé publique, l’article L. 1111-4, qui rappelle que le consentement est la valeur centrale :
« Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
La règle du consentement donne un fondement au refus de soins exprimé par le patient ?
Oui, le principe est clair : libre d’accepter les soins, le patient est libre de les refuser. L’hypothèse est expressément prévue par l’article L. 1111-4 CSP :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif »
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité.
Quid de si le refus de soins mais la vie en danger ?
Le médecin ne peut passer outre, mais il doit vérifier la sincérité de ce consentement Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs (CSP, art. L. 1110-10).
Quelle attitude quand le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ?
Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Qu’en est-il du respect du consentement quand il s’agit d’arrêter les soins, avec un risque de décès ?
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le comment prendre en compte le consentement du mineur ou des personnes protégées ?
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
S’agissant des soins à un mineur, le consentement des parents joue toujours ?
L’autorité parentale est un principe fort, posé par l‘article 371-1 du code civil, mais l’article L. 1111-5 du CSP a prévu une importante dérogation.
Un professionnel de santé peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale lorsque son intervention s’impose pour sauvegarder la santé de l’enfant, et que celuis s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.
Qu’est-ce que la personne de confiance ?
Son statut est régi par l’article L. 1111-6 du CSP :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment ».
Lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance, et le médecin doit s’en assurer.
Le rôle de la personne de confiance ?
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Elle donne un avis, qui doit être particulièrement pris en compte, mais elle ne se substitue jamais à la recherche du consentement direct du patient.
Une personne sous tutelle peut-elle désigner une personne de confiance ?
Oui, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il existe.
Des régimes spécifiques ?
Oui, le législateur a fixé des régimes spécifiques pour l’interruption volontaire de grossesse (CSP, art. L. 2212-7), la stérilisation à visée contraceptive (CSP, art L. 2123-1), les recherches impliquant la personne humaine (CSP, art. L.1122-1), les prélèvements d’organes (CSP, art. L. 1241-1 et L. 1232-2), don et utilisation de gamètes (CSP, art. L. 1244-2).
On sait que le secret professionnel est défini par la loi. Quel est ce texte ?
C’est l’article 226-13 du Code pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Pas trop explicite…
Au contraire. D’abord, reviendra toujours à ce principe : la révélation d’une information à caractère secret. Ensuite, il ne s’agit pas de secret médical, mais de secret professionnel, à adapter à chaque situation à partir de ce texte.
Le texte est court, car il s’agit de faire référence au raisonnement ancestral en matière de secret : pas de soins sans confiance, pas de confiance sans confidences, pas de confidences sans secret.
N’existe-t-il pas de texte législatif plus explicite ?
On dispose désormais d’un texte explicite et très bien rédigé, avec l’article L. 1110-4 CSP, modifié par l’ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 :
« I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV. – La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
« V. – Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
« VI. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Autre texte ?
Oui, l’excellent article R. 4317-4 CSP, issu du Code de déontologie médicale
« Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Comment interpréter ces textes ?
La jurisprudence, centenaire (Arrêts Watelet de 1885 et Degraene de 1947) pose pour principe que le secret médical revêt un caractère général et absolu.
«L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir».
Comme le souligne l’Ordre des médecins, le secret couvre tout ce qui est parvenu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire le « renseignement administratif » (nom, adresse…) et « médical » (diagnostic, traitement…).
C’est donc une conception extensive ?
Oui. Le secret s’impose pour tout ce que le professionnel a vu, entendu ou compris. (CE, 17 juin 2015, n° 385924). Toute personne doit avoir la certitude absolue qu’elle peut, même après sa mort, se fier à la discrétion du médecin.
D’autres principes ?
La jurisprudence précise encore que :
- le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret ;
- cette obligation ne cesse pas après la mort du patient ;
- le secret s’impose même devant le juge ;
- le secret s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins ;
- le secret s’impose à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux) ;
- le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu recours à ses services.
Qu’en est-il pour les mineurs ?
Le secret est également dû aux mineurs. Un mineur doit trouver avec les professionnels de santé un confident qui n’ira pas révéler les secrets qui lui sont confiés, à commencer par les parents. Ces professionnels doivent tout faire pour aider au maintien de la relation avec les parents, mais le secret dégage sa force, comme l’expose l’article L.1111-5 CSP :
« Par dérogation à l‘article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.
« Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ».
Qu’en est-il du secret partagé ?
Le partage n’intervient qu’entre professionnels de santé, pour la prise en charge et la continuité des soins et sauf opposition de la personne dûment avertie, et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.
Et le partage avec le secteur social ?
Ces partages doivent rester limités aux seules contre-indications médicales ou aux traitements nécesaires, sans la moindre information sur le diagnostic.
Quid des dénonciations de sévices ?
L’article 226-14, 2° du Code pénal autorise les médecins qui en ont connaissance à dénoncer les sévices ou privations. L’article 434-3 du Code pénal qui réprime la non-dénonciation des sévices exclut le cas des personnes tenues au secret professionnel.
Du fait de la règle du secret, la dénonciation n’est pas une obligation pour les professionnels de santé, mais attention : les praticiens ne peuvent prendre le risque du renouvellement de l’infraction, et ils doit impérativement fait le nécessaire pour protéger la victime. En cas de constat de sévices infligés à un mineur ou à une personne vulnérable, un professionnel de santé qui resterait passif commet l’infraction de non-assistance à personne en danger.
Qui prévenir ?
Le procureur de la République, notamment en situation d’urgence, joignable via le 17. Attention à ne révéler que ce qui est strictement nécessaire à la protection de la victime. Un modèle de signalement est disponible sur le site internet du Conseil national.
Qu’en est-il de la protection des mineurs en danger ?
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a inclus dans le Code de l’action sociale et des familles le texte de référence, à savoir l’article L.226-2-2 :
« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfant définie à l’article L.112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
La Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation de l’information préoccupante (CRIP) rassemble et analyse les informations y compris médicales qui lui parviennent et qui laissent craindre que la santé, la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Pour ce qui est des violences sur une personne majeure ?
Selon l’article 226-14, 2° du code pénal, cette déclaration ne peut être faite que par le médecin, auprès du procureur de la République et avec l’accord de la victime, majeure.
Le certificat descriptif, avec mention éventuelle de l’état psychologique, doit être remis à la victime. Il sera opportun de la diriger, si possible, vers une unité médico-judiciaire.
Et que penser des dénonciations faites aux proches ?
La question est réapparue avec l’’infection due au VIH, mais le Conseil national de l’Ordre des médecins, en 1992, et la Commission de réflexion sur le secret professionnel, en 1994, ont posé des principes forts, qui ont résisté à l’épreuve du temps :
- dès lors qu’elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne séropositive, mise en face de ses responsabilités, la révélation ne pose pas de problème juridique en matière de secret ;
- lors de cette révélation au partenaire, par celui qui est séropositif, le médecin peut, selon la déontologie traditionnelle, assister à l’entretien à la demande des intéressés et leur donner les éclaircissements et conseils utiles en la circonstance ;
- la loi n’autorise pas le médecin à révéler au partenaire du patient séropositif le danger que lui fait courir le comportement de ce dernier si celui-ci s’oppose obstinément à toute révélation ; il lui faudrait d’ailleurs une certaine naïveté pour prétendre connaître le ou les partenaires exposés.
Les soins en santé mentale résultent d’une organisation par les pouvoirs publics ?
Oui, il s’agit d’une politique de santé mentale, qui comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l’ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion (CSP, art. L. 3221-1).
Qu’est-ce que la psychiatrie de secteur ?
Le principe est une organisation par projets territoriaux, pour faciliter l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture (CSP, art. L. 3221-2). Dans ce cas, l’unité de référence est le secteur (CSP, art. L3221-3), qui consiste à garantir à l’ensemble de la population un accès de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, et la continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé sont particulièrement complexes.
La pratique des soins résulte-t-elle d’un régime spécifique ?
Sur certaines modalités, notamment dans les cas minoritaires d’hospitalisation sans consentement, oui, mais pour l’immensité des pratiques, c’est le droit commun qui s’applique : « Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques » (CSP, art L. 3211-1).
Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause.
L’hospitalisation sous contrainte ?
L’article L 3211-2-1 retient la notion de « soins psychiatriques sans consentement », ce qui est une formule contestable, car il y a toujours la recherche du consentement dans des soins psychiatriques, par hypothèse. Il serait plus juste de parler de soins psychiatriques sous contrainte, car il y a effectivement contrainte de la loi, qui prend la forme d’une hospitalisation complète en établissement ou de soins hors les murs, dans le cadre d’un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Comment procèdent les équipes pour la prise en charge ?
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte (CSP, art. L. 3211-2-2). Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi, et confirme ou non la nécessité de poursuivre ce mode de prise en charge.
Quel régime de droits et libertés pour les personnes hospitalisées sous contrainte ?
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée (CSP, art. L. 3211-3).
En tout état de cause, elle dispose du droit :
- de communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
- de saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
- de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
- de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
- d’émettre ou de recevoir des courriers ;
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
- d’exercer son droit de vote ;
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Quelles garanties ?
D’abord, le sens de la responsabilité des professionnels de santé, qui à tout moment cherche à construire une relation confiante à limiter à ce qui est strictement nécessaire les mesures de contraintes.
Mais la loi en outre prévu un recours juridictionnel facilité : le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal compétent peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte (CSP, art. L. 3211-12). De plus, la loi organise des contrôles réguliers par ce magistrat (CSP, art. L3211-12-1).
Quel est le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ?
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. (CSP, art. L. 3212-1).
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci,
Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande, l’admission est prononcée s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (CSP, art. L. 3212-3).
Quel est le régime d’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet ?
Le préfet prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire (CSP, art. L. 3213-1).
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission (CSP, art. L. 3213-2).
Le régime de l’admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux ?
Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire être admises en soins psychiatriques sous contrainte (CSP, art. L. 3214-1).
L’isolement et la contention sont-ils autorisés par la loi ?
Oui. Selon l’article L. 3222-5-1 CSP, l’isolement et la contention sont des « pratiques de dernier recours ». Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement.
En matière de fin de vie, quels sont les textes de référence ?
Le droit d’abord résulte de principes généraux législatives et déontologiques : les soins ne sont possibles qu’avec le consentement du malade, la volonté du malade doit être respectée, les actes pratiqués doivent être conformes aux données acquises de la science, ce qui condamne l’acharnement thérapeutique, et le fait d’abréger la vie d’autrui est un homicide. Ces principes qui ont guidé la réflexion depuis des décennies sont désormais inscrits dans les textes, avec deux lois qui structurent le sujet. e régime de base a été posé par la loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, du nom du député rapporteur du texte, et amendé par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite loi « Leonetti Claeys ». Ces lois ont été incluses dans le code de la santé publique aux articles L. 1110-5 et suivants, et L. 1111-11 est suivants.
Peut-on parler d’un droit de la personne ?
Oui en effet, le texte de loi est très clair. Selon l’article L. 1110-5 CSP : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ». Ce droit sera mis en œuvre selon des critères et des conditions, mais il s’agit bien d’un droit, et la loi s’impose à tous… à partir du moment où l’on se trouve dans un cadre médical ou hospitalier.
L’article L. 1110-9 dispose pour sa part que toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Quel est le principe directeur ?
C’est le refus de l’obstination déraisonnable, qui est posé par l’article L. 1110-5-1. Les actes de soins « ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable ». La loi ajoute : « Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire ».
En ce qui est redouté, ce sont d’abord les souffrances inutiles, mourir dans la douleur.
Le traitement de la douleur fait partie de la mission médicale, mais l’article L. 1110-5-3 en a fait un droit du malade : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée ».
L’un des freins est que l’administration des traitements antidouleur peut avoir pour effet indirect d’abréger la vie ?
C’est ce qu’on appelle le double effet, une réalité prise en charge par la loi pour écarter une responsabilité du médecin : il doit mettre en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, « même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie ».
L’acharnement thérapeutique est donc une faute ?
Depuis toujours, les actes doivent être de qualité répondant aux critères de la science, et s’obstiner à pratiquer des actes quand ils n’ont aucune utilité n’est pas défendables.
Qu’en est-il de la nutrition et de l’hydratation artificielle ?
Le texte précise que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés dans les mêmes conditions.
La loi légitime ainsi l’arrêt des soins ?
Non. Elle légitime l’arrêt ou le refus d’entreprendre une action active, qui n’a ni sens, ni résultat. On passe alors à une relation d’accompagnement, et il revient aux professionnels de sauvegarder la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs.
Y a-t-il une définition légale pour les soins palliatifs ?
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage (CSP, art. L. 1110-10).
Mais cette suspension du traitement actif, devenu inefficace, peut ouvrir sur engager une phase marquée par la souffrance et le non-sens ?
En toute situation, le médecin doit rester dans une attitude professionnelle et agir là il peut avoir une efficacité. Compte tenu de débats complexes, avec un fort retentissement dans l’opinion, la loi de 2016 est venue apporter des précisions sur cette phase avec l’article L. 1110-5-2 qui instaurent le régime de la sédation profonde et continue :
« A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
Que faire lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté ?
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
Qui décide, et selon quel processus ?
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient.
Cette phase ultime des soins peut-elle être pratiqué à domicile ?
Oui. A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un EPHAD.
Comment s’assurer de la volonté du malade ?
Il n’y a pas de solution générale. Tout est affaire d’analyse spécifique, de sens clinique et de qualité de la relation. Tout signe doit être interprété, pour comprendre qu’elle est la volonté profonde du patient.
Le patient peut-il faire connaître à l’avancée volonté ?
C’est le jeu des directives anticipées prévues par l’article L. 1111-11 CSP :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
« A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables ».
Quelle est la force des directives anticipées ?
Selon la loi, les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Il y a donc une appréciation du médecin ?
Oui, à ceci près que c’est une appréciation de l’équipe médicale. Il faut s’assurer que ces directives anticipées ont bien été fournies en connaissance de cause, c’est-à-dire avec une connaissance des tenants et les aboutissants.
La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par s
Si le médecin estime ces directives manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, il doit engager une collégiale pour décider d’appliquer ou non ces directives.
Une personne sous tutelle peut-elle rédiger des directives anticipées ?
Oui, c’est prévu par la loi.
Que faire lorsque la personne est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ?
À propos de cette situation si délicate, il faut citer l’article L. 1111-12 :
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches ».
Les équipes médicales pas toujours le temps. Y a-t-il des relais ?
Le premier relais celui de la famille ou des proches, qui vont être parties prenantes de la phase accompagnement.
Mais la loi également prévue l’association de bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations agrées qui, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, peuvent apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage (CSP, art. L. 1110-11).
Quel est le cadre législatif pour l’accès au dossier médical ?
Le texte de référence est l’article L. 1111-7 CSP :
« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »
Quelle lecture faire de ce texte ?
La formule exacte n’est pas l’accès au dossier médical, mais d’accès aux informations concernant sa santé détenues par les professionnels, à partir du moment où ces informations sont formalisées. Ensuite, cela concerne toutes les informations, sauf celles qui ont été recueillies auprès de tiers.
A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l’établissement de santé ou de l’hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents.
Il n’y a donc pas de texte pour définir ce qu’un dossier médical ?
Si, c’est l’article R. 1112-2 :
« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
« 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison prévue à l’article R. 1112-1-1 ;
b) Les motifs d’hospitalisation ;
c) La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l’évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d’anesthésie ;
j) Le compte rendu opératoire ou d’accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40 ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.
« 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R. 1112-1-2 ;
b) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière ;
« 3° Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
« Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
Qu’appelle-t-on les « notes personnelles ?
Il n’y a pas de définition légale précise. On considère qu’un professionnel doit tenir le dossier médical, répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus, mais il tient aussi un document moins formalisé, qui est en quelque sorte son « laboratoire ». C’est ce qu’on appelle les notes personnelles : dès qu’une information est assez « formalisée » et doit se retrouver dans le dossier du patient, mais sous cette réserve, les notes personnelles ont une existence reconnue, comme l’expose l’article R. 4127-45 CSP :
« Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
« Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin ».
Comment accéder à son dossier ?
La personne concernée peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication.
Quel délai ?
La communication doit être assurée au plus tard dans les huit jours suivant la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.
L’hôpital peut-il imposer la présence d’une tierce personne ?
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
Dans le cas des hospitalisations sans consentement, l’établissement peut subordonner l’accès aux informations à la présence d’un médecin désigné par le demandeur. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie, et son avis s’impose.
Quelle est la règle pour les mineurs ?
Dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Le mineur peut former une opposition en application de l’article L. 1111-5. La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l’objet dans les conditions prévues à l’article L. 1111-5 peut s’opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.
Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
Tout médecin saisi d’une demande présentée par le titulaire de l’autorité parentale pour l’accès aux informations doit s’efforcer d’obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l’autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l’opposition est maintenue.
En cas de décès du malade ?
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Le service est-il payant ?
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.
En cas de litige ?
Si la demande concerne un établissement de santé, il y a lieu de saisir, avant d’engager une procédure, de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Si la demande concerne un professionnel de santé privé, en libéral, la demande doit être adressée à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).
* * *
Des modèles de lettre (Lettre recommandée avec avis de réception)
1/ Demande de la personne concernée
Madame, Monsieur,
(Expliquez brièvement les informations qui vous intéressent : consultations, hospitalisations…).
Conformément à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique,
(1er cas : si vous souhaitez consulter vous-même votre dossier) je vous prie de bien vouloir :
(a) me permettre de consulter mon dossier médical.
(b) me transmettre une copie de mon dossier médical.
(2d cas : si vous souhaitez en prendre connaissance par l’intermédiaire de votre médecin) je vous prie de bien vouloir
(a) permettre l’accès à mon dossier au médecin que je désigne à cet effet : Dr (nom et adresse du cabinet).
(b) transmettre une copie de mon dossier médical au médecin que je désigne à cet effet : Dr (nom et adresse du cabinet).
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
(Signature)
2/ Demande par les ayants-droits
Madame, Monsieur,
(Expliquez brièvement :
- Votre situation d’ayant droit vis-à-vis de la personne décédée, avec les jusitficatifs,
- Le ou les motifs connaître, à savoir connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir vos droits
- les informations qui vous intéressent : consultations, hospitalisations…).
Conformément aux articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique,
(1er cas : si vous souhaitez consulter vous-même le dossier) je vous prie de bien vouloir :
(a) me permettre de consulter le dossier médical.
(b) me transmettre une copie du dossier médical.
(2d cas : si vous souhaitez en prendre connaissance par l’intermédiaire de votre médecin) je vous prie de bien vouloir
(a) permettre l’accès au dossier au médecin que je désigne à cet effet : Dr (nom et adresse du cabinet).
(b) transmettre une copie de ce dossier médical au médecin que je désigne à cet effet : Dr (nom et adresse du cabinet).
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
(Signature)
A
Accouchement sous X. De tradition ancienne, le droit français admet la possibilité pour une parturiente de demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé, par le procédé de l’accouchement sous X. L’enfant est déclaré par un tiers, en général l’établissement hospitalier, comme s’il avait été trouvé, sans qu’aucun lien de filiation ne puisse être établi avec la mère. La loi du 22 janvier 2002 a apporté des aménagements, sans remettre en cause le principe. La mère dispose d’un délai de quelques mois pour revenir sur sa déclaration, et elle est encouragée au moment de l’accouchement à laisser des coordonnées ou des éléments qui perm
ettront peut-être un jour à l’enfant de savoir qui était sa mère. La loi a créé un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, organisme qui a en charge d’aider à la reconstitution de ces liens effacés (Code civil, Art. 341-1).
Acte médical (Notion). Le corps humain est protégé par le principe d’inviolabilité, car il est l’incarnation de la personne. Aussi, l’acte médical, qui remet en cause l’intégrité corporelle, doit s’inscrire dans un registre d’autorisation. C’est un paradoxe : l’acte médical, ressenti comme bienveillant par nature, est du point de vue juridique, une remise en cause de l’intégrité corporelle. Bien sûr, nul ne conteste l’utilité ou la légitimité de ces interventions, dont la science démontre leurs bienfaits, mais l’acte ne devient licite que s’il respecte les conditions du consentement préalable et du but médical.
Acte médical (validité). Deux conditions doivent être réunies.
Première condition : le consentement. La règle fondamentale du consentement se trouve dans le Code civil, et c’est dire l’importance que le droit apporte à cette notion. Le Code de la santé publique et les règles déontologiques précisent cette donnée, mais tout part de l’article 16-3 du Code civil. Le consentement n’est pas une modalité du soin, mais sa condition, ce qui renvoie au statut fondamental de la personne.
Deuxième condition : une nécessité médicale. Si les motifs médicaux ne justifient pas l’intervention, il faut s’abstenir. La loi fixe une exception, l’intérêt thérapeutique d’autrui, ce qui autorise la recherche et les dons d’organe.
Aléa médical. Atteinte corporelle inhérente à un médical irréprochable, l’aléa n’engage pas la responsabilité
Arrêt ou limitation du traitement. Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs (CSP, Art. L.1111-10).
Assurance responsabilité civile. Les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile Lorsque le médecin est salarié ou fonctionnaire, c’est l’employeur qui assume les conséquences financières, et qui doit être assuré. L’assurance des professionnels de santé et des établissements couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. La responsabilité financière personnelle du médecin salarié ou praticien hospitalier ne réapparaît qu’en cas de faute volontaire, c’est-à-dire commise avec intention de nuire, ou d’acte commis en dehors de la mission confiée (CSP, Art. L. 1142-2).
B
Bénévoles. Des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage (CSP, Art. L. 1110-11).
C
Clause de conscience. Tout professionnel de santé peut opposer une « clause de conscience » et refuser de pratiquer une IVG, mais l’admission de cette clause de conscience ne doit pas remettre en cause le fonctionnement des services hospitaliers, qui doivent appliquer la loi.
Consentement L’article L. 1111-4 souligne le rôle du patient dans l’acceptation ou le refus des soins.
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Consentement de l’enfant. Les soins destinés à l’enfant supposent une autorisation des parents. En temps normal, les parents signent une autorisation. En cas d’urgence, l’équipe médicale peut pratiquer les soins nécessaires. Si les parents adoptent une attitude déraisonnable, mettant l’enfant en danger, un praticien peut saisir le procureur chargé de la protection de l’enfance, dont la décision se substituera à celle des parents. Selon l’article L. 1111-5 du CSP, l’enfant peut décider lui-même des soins, s’il est accompagné d’une personne majeure, en demandant que ses parents ne soient pas avisés.
Consentement (Régime général). La référence est l’article 16-3 du Code civil, cadre général de tout acte médical :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
La rédaction de cet article 16-3 est remarquable. Le consentement doit être préalable, car il s’agit d’une atteinte à l’intégrité corporelle, mais si le patient n’est pas à même d’exprimer ce consentement, les soignants peuvent passer outre quand la nécessité thérapeutique commande, et ils agissent alors sous leur responsabilité.
Corps humain. Pour le droit, le corps est indissociable de la personne. Tout part de l’article 16-1 du Code civil : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
Curatelle. La curatelle répond aux besoins d’une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Ce point marque le passage entre la sauvegarde de justice et la curatelle : l’assistance doit être continue s’agissant des actes importants (Code civil, Art. 440).
Dénonciations. Aux termes de l’article 434-1 du Code pénal, tout citoyen a l’obligation de dénoncer au Procureur de la République les faits qui lui paraissent être de nature à constituer une infraction. Le dernier alinéa de cet article prévoit une exception pour les personnes soumises au secret professionnel, pour lesquels la dénonciation n’est plus qu’une faculté. Il faut ainsi distinguer l’obligation de protection, par la mise à l’abri de la victime, et la dénonciation des faits. Bien sûr, la loi souhaite que l’auteur des faits puisse être sanctionné. Mais pour les personnes soumises au secret, lorsque les informations reçues relèvent de ce secret, et dans la mesure où la victime a été mise à l’abri, il est possible d’envisager un temps avant de dénoncer les faits, ce qui permet de mieux préparer la victime à des démarches toujours très difficiles. S’il n’existe pas de possibilité de protection de la victime, alors la dénonciation des faits d’impose.
Dignité. S’il ne faillait qu’une règle, c’est celle-là qu’il faudrait garder, l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». L’égalité de naissance est de jure, pas de facto, certes, mais le principe est essentiel. La construction effective de l’égalité est un objectif social, qui se construit dans les rapports de forces, mais rien ne serait envisageable sans la proclamation de l’égalité de droit. La seconde partie de la phrase compte davantage : les hommes demeurent libres et égaux en droit. C’est dire que reste l’intangible égalité de droit au long de la vie. Le droit s’interdit de qualifier la qualité des vies, ou la qualité de tel ou tel moment de vie.
Directives anticipées. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant (CSP, Art. L. 1111-11).
Dossier médical (modalités d’accès). Le patient peut accéder à aux informations contenues dans son dossier directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne. La communication doit avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant sa demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques doit être saisie (CSP, Art. L. 1111-7).
Dossier médical. Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé. Il s’agit de toutes les informations formalisées ou ayant fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (CSP, Art. L. 1111-7).
E
Enfance en danger. Chaque fois qu’apparaît le soupçon d’un danger pour l’enfant, le recours est le juge des enfants, qui peut être saisi sans formalité, par toute personne : les parents, les proches de l’environnement amical ou scolaire, l’enfant lui-même. En cas d’urgence, il faut contacter le procureur chargé des mineurs, en passant par le 17. La loi retient deux critères : un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur, ou des conditions d’éducation gravement compromises. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel (Code civil, Art. 375).
Erreur médicale. L’erreur médicale est un acte objectivement inadapté et qui aurait pu être évitée, à l’inverse de l’aléa, parce qu’elle n’est pas inhérente à l’acte pratiqué. Mais le processus qui a conduit à cette erreur a été prudent et attentif, de telle sorte que le degré de la faute n’est pas atteint. L’erreur n’engage pas la responsabilité.
F
Fin de vie (Accompagnement médical). Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire (CSP, Art. R. 4127-38).
Fin de vie (Dossier et information). Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement.
Fin de vie (Double effet). Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit dans la mesure du possible, en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical (CSP, Art. L. 1110-5-5°).
Fin de vie (Limitation ou arrêt du traitement) Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs (CSP, Art. L. 1111-13).
Fin de vie (Mineurs ou majeurs protégés). Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille, outre les avis requis par la procédure collégiale, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.
Fin de vie (Personne de confiance). Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin (CSP, Art. L. 1111-6 et L. 1111-12).
Fin de vie (Procédure collégiale). La décision médicale de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. L’initiative revient au médecin et c’est une obligation en fonction des directives anticipées du patient ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. La décision relève du médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches (CSP, Art. R. 4127-38).
G
Gestation pour autrui. La France ne reconnait pas la gestation par autrui, soit l’accord par lequel une femme porte le bébé d’un autre couple, avec une fécondation artificielle. Le législateur estime que la conception et la maternité ne peuvent faire l’objet d’un contrat, qui porterait sur l’existence d’une personne humaine. Des expériences étrangères montrent que la gestation pour autrui, dès lors qu’elle est légalisée, peut échapper aux pratiques financières choquantes, et devient un procédé permettant à des couples d’avoir des enfants, quand les autres solutions se révèlent des échecs.
I
Infections nosocomiales. Les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (CSP, Art. L. 1142-1).
Information du patient. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (CSP, Art. L. 1111-2).
Interruption de grossesse pour motif médical. Passé le délai de douze semaines de grossesse, l’interruption n’est possible qu’en cas de découverte d’une maladie d’une particulière gravité et incurable, reconnue comme telle par deux praticiens dont un expert.
Interruption volontaire de grossesse (Mineures). Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale est recueilli. Si la femme mineure désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son consentement pour que les parents soient consultés. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix (CSP, Art. L. 2212-7).
Interruption volontaire de grossesse. L’interruption de grossesse peut intervenir avant un délai de douze semaines de grossesse. Le critère est l’état de détresse de la femme, appréciée par celle-ci en conscience (CSP, Art. L. 2212-1).
M
Majeurs protégés. Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. La mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Le juge des tutelles est le garant des droits des personnes en situation de vulnérabilité (Code civil, Art. 425).
Maltraitance. La question, très sensible, conduit à distinguer la dénonciation des faits en vue de la condamnation de l’auteur des faits, et la protection la victime des mauvais traitements. Les deux démarches sont distinctes, même s’il faut les gérer dans un même temps. Si un médecin a des raisons sérieuses de craindre un renouvellement de l’infraction, c’est-à-dire de l’agression de la victime, il doit prendre toutes les mesures pour que ce risque ne se renouvelle pas, avant de se poser la question de la dénonciation des faits, en cherchant à y associer la victime.
Mandat de protection future. Chacun peut désigner, pour le jour où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires chargés de la mission de protection. Ce mandat, qui peut être passé de manière informelle ou devant un notaire, peut concerner la protection de la personne et l’administration du patrimoine. Il s’agit de désigner une personne, mais aussi de donner un certain nombre d’indications sur ce que l’on souhaite pour l’organisation de sa vie lorsque la conscience faillira (Code civil, Art. 477).
Mise en danger d’autrui. Cette infraction punit le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Code pénal, Art. 223-1).
Mort. Si une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1º Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; 2º Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3º Absence totale de ventilation spontanée (CSP, Art. R. 1232-1).
N
Non-assistance à personne en danger. Pour que le délit d’omission de porter secours à une personne en danger soit constitué, il faut, d’une part que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril imminent et constant rendant son intervention nécessaire, et, d’autre part, qu’elle se soit volontairement refusée à intervenir par les modes qu’il lui était possible d’employer en vue de le conjurer (Code pénal, Art. Art. 223-6).
O
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux). Si un dommage corporel a été causé par une erreur ou résulte d’un aléa, la seule prise en charge est celle de la Sécurité sociale, hormis si le dommage est important. Au-delà de 25 % d’incapacité, une indemnisation peut être versée par l’ONIAM, un organisme public, au titre de la solidarité nationale.
P
Personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation, qui doit être proposée lors de l’admission, est faite par écrit et peut être révoquée à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions (CSP, Art. L. 1111-6).
Responsabilité civile (En général). C’est le régime juridique le plus sollicité : plus de 95% des procédures. Il met en cause le médecin libéral ou l’établissement, public ou privé, qui est l’employeur du médecin, et le procès est géré par l’assureur. Le principe est celui de la responsabilité pour faute, géré via l’assurance. Mais la loi a admis des régimes dérogatoires de responsabilité sans faute, avec une prise en charge via l’ONIAM. L’idée qui sous-tend les évolutions législatives est que le patient atteint d’un dommage important doit trouver une solution d’indemnisation, mais que la charge financière doit être mutualisée.
R
Responsabilité civile pour faute. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (CSP, Art. L. 1142-1).
Responsabilité morale. Dans la pratique quotidienne, les premières références ne sont pas la loi et le procureur, mais le bon sens, l’esprit de responsabilité et le devoir moral. La morale irrigue la pratique. Mais il faut moins parler de la morale que de la coexistence des morales. Autant de personnes, autant d’époques, autant de pays : autant de morales… L’éthique tend à étudier la diversité des morales pour déterminer quelles sont les principes qui les fondent, et comment, lorsque la loi dit peu de choses, les décisions peuvent être prises au mieux.
Responsabilité pénale (Faute involontaire de l’acteur). Selon l’article 121-3, alinéa 3 du Code pénal, il y a délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. En vertu de ce texte, l’auteur direct peut être pénalement sanctionné pour une faute involontaire, c’est-à-dire commise sans intention de nuire.
Responsabilité pénale (Faute involontaire du décideur). L’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal définit la catégorie des « décideurs » comme les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Ces décideurs sont responsables pénalement si ils ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Le décideur n’est pas celui qui a réalisé, mais celui qui a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. C’est typiquement la situation du médecin chef de pôle ou du cadre de santé. Pour l’engagement de la responsabilité, le manquement aux diligences normales ne suffit plus. Il faut passer un degré dans la gravité de la faute. Le législateur a pensé que la fonction des personnes amenés à prendre de nombreuses décisions devait bénéficier d’une certaine compréhension, car le contrecoup d’une responsabilité trop stricte serait de refuser d’assumer des fonctions ressenties comme trop risquées. Il faut admettre une marge, que l’on ne retrouve pas pour celui qui réalise effectivement l’acte. Pour apprécier cette faute, le Code pénal définit deux hypothèses : la violation de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou la faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée. On reste ainsi dans la faute d’imprudence, mais il faut atteindre le seuil d’une faute « caractérisée ».
Responsabilité pénale (Intention coupable). L’article 121-3, alinéa 1 du Code pénal pose le principe de la responsabilité pénale : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». La responsabilité pénale médicale se joue dans un régime d’exception, celui de la faute involontaire, commise sans intention de nuire.
Responsabilité pénale (Mise en danger délibéré d’autrui). Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (Code pénal, Art. 223-1).
Responsabilité pénale (Principe). Le principe cardinal de la responsabilité pénale se trouve dans l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». La responsabilité pénale est individuelle, et chacun est concerné, quel que soit son statut. De ce point de vue, le Code pénal est très égalitaire… Le droit pénal ignore la responsabilité du fait d’autrui. Dans le cadre d’un travail en équipe mettant en cause un médecin, un interne et une infirmière et une aide-soignante, le juge pénal analysera le rôle de chacun. Le médecin, au pénal, n’est pas responsable de la faute de l’interne, pas plus que le cadre de santé pour la faute de l’infirmière, mais il peut être responsable d’une faute d’encadrement, mission qui lui incombe à titre personnel.
Responsabilité pénale médicale. Les médecins connaissent un haut niveau de responsabilité, non parce que la loi se voudrait sévère avec cette profession, mais en fonction de la valeur protégée, le corps humain. Le corps étant l’incarnation de la personne, et tout acte médical supposant une intervention sur le corps, la limite pénale n’est jamais loin.
Responsabilité sans faute. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation s’ils ont eu des conséquences qui ont été anormales au regard de l’état de santé et de son évolution prévisible et présentant un caractère de gravité, fixé par décret, atteignant les capacités fonctionnelles ou la vie privée et professionnelle. Les critères sont notamment le taux d’incapacité permanente ou la durée de l’incapacité temporaire de travail (CSP, Art. L. 1142-1).
S
Sauvegarde de justice. Cette mesure d’assistance correspond à la situation d’un majeur qui a besoin d’une aide temporaire ou d’une représentation pour l’accomplissement de certains actes. Il s’agit de passer un cap difficile, dans le cadre d’une situation de crise, ou d’attendre le temps de la mise en place d’une procédure de curatelle ou de tutelle (Code civil, Art. 433).
Secret médical (Décès). Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Secret médical (Dénonciations). Selon l’article 226-14 du Code pénal le secret médical n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
« 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »«
2º Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire »
« 3º Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ».« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ».
Secret médical (Déontologie). Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (CSP, Art. R. 4127-4).
Secret médical (Etendue). Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, le secret médical couvre l’ensemble des informations personnelles venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Secret médical (Information des proches). En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires, destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Secret médical (Informatique). Afin de garantir la confidentialité des informations médicales, leur conservation et leur transmission sur support informatique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Secret médical (Pénal). La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende 15000 euros (Code pénal, Art. 226-13).
Secret médical (Régime général). Tout commence avec le fameux triptyque, qui fonde le raisonnement : pas de soins sans confidences, pas de confidences sans confiance et pas de confiance sans secret. Toujours proclamé, le secret est sans cesse remis en cause, pour des raisons qui d’ailleurs ne manquent pas de pertinence : préoccupations sanitaires, qui imposent de connaître un certain nombre d’éléments épidémiologiques ; logiques sociales, car la Sécurité sociale doit avoir un regard sur ce qu’elle finance ; impératifs judiciaires, car les poursuites pénales doivent pouvoir suivre leur cours ; nécessités gestionnaires, car on ne peut gérer sans connaître la réalité du terrain. Mais la jurisprudence disciplinaire et pénale est très ferme pour défendre le secret, règle d’ordre public (CSP, Art. L. 1110-4).
Secret médical partagé. Le secret s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
Soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage (CSP, Art. L. 1110-10)
T
Traitement de la douleur. En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
Tutelle. La mesure de tutelle permet de répondre aux besoins d’une personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, à l’inverse de la curatelle, qui est une mesure d’assistance. La mesure est prononcée pour 5 ans, renouvelable après réexamen complet de la situation (Code civil, Art. 440).
V
Vie. Une seule chose compte : un être humain vit, et un jour de vie, c’est la vie. Si le corps vit, l’être est là, comme sujet de droit, quand bien même il n’est plus en mesure d’assurer l’exercice de ses droits. Le corps vivant est l’être humain. Cette conception est si forte, que même après la mort, le corps inerte ne redevient pas une simple chose.
Chapître 2 :
La jurisprudence
Consentement
Règle 1 – Le respect de la personne humaine impose le principe du consentement aux soins
Cour de cassation, 28 janvier 1942, « arrêt Teyssier »
« Attendu que, comme tout chirurgien, le chirurgien d’un service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance, sous sa responsabilité, l’utilité, la nature et les risques; qu’en violant cette obligation imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du malade, un manquement à ses devoirs proprement médicaux qui constitue une faute personnelle se détachant de l’exercice des fonctions que l’Administration des hospices a qualité pour réglementer […] ».
Faits
Le 30 mars 1930, un homme a été victime d’un accident de la circulation. Il a été admis à l’Hôpital Saint André, à Bordeaux, où furent diagnostiquées, sur le membre supérieur gauche, une double fracture de l’humérus et une fracture du radius et du cubitus. La fracture du bras a été réduite, mais pour celles de l’avant-bras, l’option était entre un traitement orthopédique par appareil plâtré et une ostéosynthèse. Le praticien a retenu l’ostéosynthèse, et l’intervention a eu lieu le 5 avril.
Les suites anormales s’étaient enchainées : le lendemain 6 avril, une forte fièvre ; le 10 avril, un phlegmon gangreneux ; le 14 juin, de vives souffrances à la mobilisation sous anesthésie. Dans la nuit du 4 juillet, des phénomènes infectieux graves imposèrent l’amputation en urgence de l’avant-bras, pratiquée le 5 juillet.
Du dossier et de l’expertise, deux points se dégagent :
- la fracture ne présentait pas en fait un grand déplacement des fragments, ce qui pouvait orienter vers un traitement orthopédique, avec une bonne prévision fonctionnelle ;
- l’apparition quasi immédiate de phénomènes infectieux faisait présumer une insuffisance d’asepsie, permettant un traitement plus précoce et évitant l’amputation.
Procédure
Cour d’appel de Bordeaux, 4 juin 1937
- Faute
Le patient n’avait pas été prévenu du choix de l’ostéosynthèse. Or, il devait être éclairé pour faire un choix en raison de l’aléa que présentait l’ostéosynthèse. Même pour ses partisans, les résultats de cette technique ne dépassaient pas sensiblement ceux obtenus par les procédés orthopédiques. Ainsi, le médecin a commis une faute en n’éclairant pas le malade sur les conséquences de l’intervention à laquelle il allait procéder.
- Préjudice
La cour, compte tenu de la gravité des blessures d’origine, propres à laisser des séquelles, avait retenu une indemnisation partielle.
Cour de Cassation, 28 janvier 1942
Tout chirurgien est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance, sous sa responsabilité, l’utilité, la nature et les risques. En violant cette obligation imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du malade, un manquement à ses devoirs médicaux.
A retenir
Pas de soins sans consentement, au nom du respect de la personne humaine : par cet arrêt de 1942, la Cour de cassation pose la base incontournable de la relation médicale. La Cour de cassation ne se contente pas de confirmer la motivation de la cour de Bordeaux, car elle ajoute une dimension fondamentale, le lien entre le consentement et la protection de la personne humaine. Ce principe, qui résulte désormais de la loi (Code civil, art. 16-3), est aussi une des bases de la déontologie médicale.
Règle 2 – Un patient est libre d’accepter ou non les soins préconisés par son médecin.
Cour de cassation, 2° chambre civile, 19 juin 2003, n° 01-13289, publié
« Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… n’avait pas l’obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d’appel a violé le texte susvisé […] ».
Faits
Une femme, victime d’un accident de la circulation en 1988 et ayant bénéficié d’une indemnisation conformément à la loi, a estimé une dizaine d’années plus tard que le préjudice s’était aggravé, et elle a formé une nouvelle demande d’indemnisation contre l’assureur de l’auteur de l’accident.
Du rapport d’expertise, il ressort que :
- la victime souffre de troubles psychiques qui sont la conséquence de l’accident ;
- elle avait été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu’elle n’a pas fait.
Procédure
Le tribunal a inclus ces troubles dans l’indemnisation. A l’inverse, la cour d’appel les a écartés au motif que le refus de se soigner était fautif et cette faute a concouru à la persistance de troubles psychiques. La Cour de cassation casse cet arrêt en jugeant que la patiente n’avait pas l’obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins.
A retenir
Une personne ne commet pas de faute en refusant des soins préconisés par son médecin. Le principe est certain, et les conséquences sont bien affirmées dans cet arrêt de la Cour de cassation. La situation peut être différente et l’attitude du patient peut être considérée comme fautive, notamment s’il ne respecte pas la prescription ou où s’il adopte des comportements prohibés.
Règle 3 – Le refus de soin éclairé, après que le médecin ait tout fait pour convaincre le patient, s’impose.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 15 novembre 2005, n° 04-18180, publié
« En statuant ainsi, sans rechercher si le patient avait été informé par le médecin des risques graves encourus en cas d’opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé […] ».
Faits
Un patient présentant une lipomatose pelvienne a subi une entéroplastie d’agrandissement avec réimplantation urétéro-vésicale réalisée par un chirurgien urologue. Souffrant de différents troubles à l’issue de cette intervention, il a recherché la responsabilité du chirurgien.
Du dossier et de l’expertise il ressort que :
- un traitement par corticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une néphrotomie et à la pose d’une sonde vésicale ;
- le médecin en était conscient, mais il s’était heurté au refus de son patient quant à la pose d’une sonde ;
- ce refus avait été consigné dans un commentaire rédigé par le chirurgien, confirmant les déclarations faites à l’expert ;
- l’aggravation de l’état de santé a conduit à pratiquer une entéroplastie.
Procédure
Cour d’appel de Pau, 5 avril 2004
C’est la propre décision du patient qui l’a privé d’une chance d’éviter une opération mutilante. Cette décision s’imposait au médecin, et le recours est rejeté.
Cour de cassation, 15 novembre 2005
- Principe
Le patient doit être réellement mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés. Devant un refus de soin, le médecin doit avec conviction informer des risques graves encourus en cas d’opposition au traitement préconisé.
- Analyse
La cour d’appel n’a pas recherché si le patient avait été informé par le médecin des risques graves encourus en cas d’opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie. Dans une telle situation, il faut analyser la réalité de la situation et on ne peut pas se satisfaire de la simple mention du refus consignée dans le dossier.
A retenir
Le refus de soins s’impose au médecin si celui-ci a tout fait pour informer et convaincre de l’utilité des soins, de manière à s’assurer que le patient prend une décision éclairée. La mention portée dans le dossier est un élément participant à la preuve. Mais, alors que les suites graves et invalidantes étaient inéluctables, le médecin devait apporter des éléments plus convaincants pour établir que le refus de soin du patient était pleinement éclairé. Le patient doit être correctement informé, ce qui impose de l’aviser de tous les risques graves, c’est-à-dire ceux liés à la réalisation des actes médicaux préconisés, mais aussi ceux qui peuvent résulter d’un refus du traitement.
Règle 4 – L’information doit porter sur pour sur tous les risques graves, même s’ils sont exceptionnels
1/ Secteur privé
Cour de cassation, 1° chambre civile, 7 octobre 1998, n° 97-10267, publié
« Attendu qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu’il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement […] ».
Faits
Une dame a été victime le 3 avril 1985 d’une chute lui ayant causé une fracture de la deuxième vertèbre lombaire. En raison d’une cyphose lombaire persistante, elle a subi le 3 février 1987, dans la matinée, une intervention pratiquée par un chirurgien à la Clinique du Parc, consistant en la mise en place d’un cadre de Hartchild. Cette intervention devait être suivie d’une greffe vertébrale. Dans l’après-midi, des troubles de l’œil gauche se sont manifestés. Dès qu’il a été averti, le chirurgien est venu au chevet de la patiente, a modifié la thérapeutique prescrite et a organisé une consultation ophtalmologique en urgence, ce qui a permis de poser le diagnostic de thrombose du sinus caverneux. Cette affection a eu pour conséquence la perte fonctionnelle définitive de l’œil.
Il résulte du dossier et de l’expertise que :
- l’acte pratiqué a été conforme aux règles de l’art et ne révèle pas de faute technique ;
- la thrombophlébite du sinus caverneux est une complication connue mais très rare ;
- la réaction de l’équipe a été diligente et les délais observés ne laissent apparaître de carence ni dans la surveillance, ni dans la réponse médicale apportée à cette complication.
Procédure
Cour d’appel de Lyon, 26 septembre 1996
La cour d’appel, confirmant le tribunal, écarte toute responsabilité aux motifs que l’acte opératoire n’a pas été fautif, la thrombophlébite du sinus caverneux étant une complication et que la surveillance infirmière a été diligente et la réaction médicale adaptée. Cette complication, bien que connue, est très rare, et le médecin n’est tenu d’informer que sur les risques graves normalement prévisibles.
Cour de cassation, 7 octobre 1998
- Principe
Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
- Analyse
La cour d’appel a estimé que l’information que doit donner le praticien n’est exigée que pour des risques graves « normalement prévisibles », et son arrêt doit donc être cassé.
A retenir
La règle est certaine, et elle joue dans le privé comme dans le public : l’information est due sur tous les risque graves, même s’ils sont rares, voire exceptionnels. L’information doit être donnée en soulignant cette rareté, en exposant aussi les risques graves en cas de renonciation aux soins, et en veillant à ne pas dissuader le patient d’accepter des soins nécessaires. La jurisprudence focalise sur les risques, car c’est à partir de la survenance de ces risques que se pose la question du consentement. Mais dans la pratique, l’information doit d’abord être simple, explicative et éclairante.
2/ Secteur public
Conseil d’Etat, 5 janvier 2000, n° 181899, publié
« Considérant que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
« Considérant que la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis […] ».
L’histoire
Lors d’une intervention endovasculaire pratiquée au sein des Hospices Civils de Lyon, et destinée à traiter par embolisation une malformation artérioveineuse, le micro-cathéter introduit dans l’artère cérébrale s’est brisé, provoquant un accident ischémique. Le patient est demeuré atteint d’une hémiplégie à gauche.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- l’intervention s’est déroulée conformément aux règles de l’art ;
- le traitement par embolisation, même effectué dans les règles de l’art, présente des risques de décès ou d’invalidité du patient, pouvant résulter notamment d’un accident ischémique consécutif à la rupture du micro-cathéter au moment de son retrait de l’artère dans laquelle il avait été introduit ;
- ce risque est indépendant de la qualité de l’opérateur ou du matériel utilisé ;
- compte tenu de la rareté du risque, les praticiens n’ont pas donné cette information ;
- l’hémiplégie est la conséquence de l’intervention ;
- la malformation artérioveineuse dont le patient était atteint pouvait provoquer, à défaut de procéder à un traitement par embolisation, des céphalées plus ou moins invalidantes, des crises d’épilepsie, des hémorragies cérébrales entraînant la paralysie, voire le décès du patient. Ainsi, sur le plan médical, les séquelles d’hémiplégie consécutives à l’intervention ont un certain rapport avec l’état initial et son évolution prévisible.
Le procès
Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 1995
Le patient ne fondait pas ce recours sur la faute technique, nettement écartée par les experts, mais il soutenait ne pas avoir été informé des risques de l’intervention. Pour le tribunal, le manquement à l’obligation d’information n’était pas contestable, et il a condamné les HCL à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident.
Cour administrative d’appel, 20 juin 1996
Devant la cour, les HCL ont produit une attestation établie par un praticien postérieurement à l’intervention, affirmant que le patient avait été « informé des risques du traitement envisagé ». Pour la cour, un tel document n’est pas de nature à établir la preuve. Sur le fond, la cour, se fondant sur le caractère exceptionnel d’un tel accident, a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’informer le patient des risques de l’opération. Elle a aussi réformé le jugement, et débouté le patient de toutes ses demandes.
Conseil d’Etat, 5 janvier 2000
Principe
Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Il appartient à l’hôpital d’établir que l’intéressé a été informé des risques de l’acte médical.
La faute commise par les praticiens d’un hôpital au regard de leur devoir d’information du patient n’entraîne pour ce dernier que la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d’une part, les risques inhérents à l’acte médical et, d’autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte.
Analyse
- Faute
Le caractère exceptionnel de ce risque grave ne dispensait pas les médecins du devoir d’information, et la faute est établie.
- Préjudice
La réparation du dommage résultant pour le patient de la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis. Compte tenu du rapprochement entre, d’une part, les risques inhérents à l’intervention et, d’autre part, les risques d’hémorragie cérébrale qui étaient encourus en cas de renoncement à ce traitement, cette fraction doit être fixée au cinquième.
A retenir
L’information est due sur tous les risques graves, même s’ils sont exceptionnels sauf urgence, impossibilité, ou refus du patient d’être informé. La survenance du risque n’engage la responsabilité qu’en proportion de la perte de chances de se soustraire au risque. Si l’intervention n’avait rien de nécessaire, l’indemnisation sera totale, alors que si elle était impérieuse, il n’y aura pas d’indemnisation à ce titre. Entre les deux, il faut évaluer le pourcentage de perte de chances.
Règle 5 – Le médecin est dispensé de l’obligation d’informer en cas d’urgence ou d’impossibilité
1/ Décision à prendre au cours d’une intervention
Cour de cassation, 1° chambre civile, 22 mai 2002, n° 00-19817, publié
« Attendu que le médecin est dispensé de l’obligation d’informer son patient sur les risques graves inhérents aux investigations ou aux soins qu’il propose en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé […] ».
Faits
A la suite d’une première intervention chirurgicale, un patient souffrait de troubles urinaires. Il a consulté un chirurgien urologue, lequel a préconisé une uréthrotomie, qui a été réalisée le 5 janvier 1989. Au cours de cette opération, le chirurgien a estimé nécessaire de procéder à une résection endoscopique complémentaire. Comme suite à ce geste, est survenue une lésion du sphincter strié, entrainant des troubles fonctionnels graves auxquelles il n’a pu être totalement remédié.
Il résulte du dossier et de l’expertise que :
- la résection endoscopique complémentaire s’est imposée en cours d’intervention, comme une nécessité anatomique, en présence de tissus obstructifs que seules les constatations visuelles préopératoires avaient permis de déceler ;
- le geste chirurgical a été pratiqué selon les règles de l’art ;
- cet acte comporte des risques connus, et qui sont survenus du fait de ce geste et alors même que ce geste a été conforme aux bonnes pratiques ;
- pour informer sur ce risque, le chirurgien aurait du programmer une nouvelle intervention sous anesthésie générale ou loco-régionale, avec les risques afférents à l’anesthésie et à une réintervention.
Procédure
Cour d’appel de Paris, 9 octobre 1998
L’obligation de procéder à une résection endoscopique complémentaire, source du risque non révélé au patient, s’était imposée en cours d’intervention. Le chirurgien ne pouvait informer son patient des risques inhérents à cet acte complémentaire sans l’exposer au risque d’une nouvelle intervention sous anesthésie générale ou loco-régionale. En l’absence de faute, la responsabilité est écartée.
Cour de cassation, 22 mai 2002
- Principe
Le médecin est dispensé de l’obligation d’informer son patient sur les risques graves inhérents aux investigations ou aux soins qu’il propose en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé.
- Analyse
La résection endoscopique complémentaire s’est imposée en cours d’intervention. Le chirurgien avait pour option de pratiquer ce geste indispensable, ou de différer, ce qui conduisait à pratiquer une seconde intervention sous anesthésie. Ces éléments caractérisent l’impossibilité dans la quelle s’est trouvé le médecin d’informer son patient du risque grave, qui ensuite s’est réalisé.
A retenir
Le geste complémentaire, qui résultait des constations de visu faites lors de l’intervention, était imposé par les nécessités médicales. Le chirurgien aurait certes pu différer et procéder à une seconde intervention, mais celle-ci était inéluctable, et dans ce contexte, la perspective d’une nouvelle anesthésie rendait l’information impossible. Le fait que soit survenu la complication, considérée comme un risque rare, ne remet pas en cause qu’en pratique, le médecin avait été dans l’impossibilité d’informer. En l’absence de faute, la responsabilité n’est pas engagée.
Si cette affaire avait été postérieure à la loi du 4 mars 2002, l’indemnisation via l’ONIAM aurait été susceptible de jouer, vu l’importance du préjudice, une hémiplégie.
2/ Donnée médicale très rare
Cour de cassation, 1° chambre civile, 26 octobre 2004, n° 03-15120, publié
« Attendu que la cour d’appel, se fondant sur le rapport d’expertise, a relevé que les trois médecins ayant examiné M. X… avaient évoqué l’existence d’une tumeur cancéreuse, que l’exérèse-biopsie s’imposait en urgence pour poser un diagnostic certain, que seule cette intervention avait permis de déterminer qu’il s’agissait d’une tumeur bénigne à type de Schwannome très rare et que son exérèse, même partielle, à des fins de biopsie pouvait entraîner des séquelles nerveuses ; qu’en l’absence d’élément en faveur d’une tumeur nerveuse, elle a pu en déduire que M. Y… n’avait pas commis de faute en n’informant pas préalablement son patient des conséquences possibles de la découverte éventuelle d’une telle tumeur et de son exérèse, caractérisant ainsi l’impossibilité pour le praticien de délivrer une information éclairée […] ».
Faits
Afin de déterminer la nature d’une tumeur supposée cancéreuse, localisée dans la gouttière carotidienne, un patient a subi une exérèse-biopsie réalisée par un chirurgien oto-rhino-laryngologue. Les résultats ont établi qu’il s’agissait en fait d’une tumeur bénigne à type de Schwannome. Cette exérèse-biopsie a entraîné des lésions nerveuses, avec des séquelles.
Le dossier et le rapport d’expertise font ressortir que :
- les trois médecins ayant examiné le patient avaient évoqué l’existence d’une tumeur cancéreuse ;
- l’exérèse-biopsie s’imposait en urgence pour poser un diagnostic certain ;
- seule l’intervention chirurgicale avait permis de déterminer qu’il s’agissait d’une tumeur bénigne à type de Schwannome, très rare ;
- son exérèse, même partielle, à des fins de biopsie était justifiée ;
- le geste a été conduit conformément aux bonnes pratiques et ne révèle pas de faute technique ;
- les séquelles nerveuses sont la conséquence de ce geste et doivent médicalement être qualifiée de complications.
Analyse
Le geste chirurgical, qui devait être pratiqué en urgence, n’est pas fautif et le fait qu’il ait entrainé des séquelles, connues comme une complication, n’engage pas la responsabilité. En l’absence d’élément en faveur d’une tumeur nerveuse, le chirurgien n’avait pas commis de faute en n’informant pas préalablement son patient des conséquences possibles de la découverte éventuelle d’une telle tumeur et de son exérèse. Ces faits caractérisent l’impossibilité pour le praticien de délivrer une information éclairée, et la responsabilité est écartée.
A retenir
L’impossibilité d’informer est liée à la réunion de critères stricts : ici, la conjugaison d’une intervention urgente, d’un diagnostic rare et ne correspondant pas aux signes analysés par un collège médical, et la nécessité de pratiquer le geste. La survenance de la complication, avec les séquelles qui en résultent, n’engage pas la responsabilité en l’absence de faute.
Règle 6 – L’information peut être limitée ou différée en fonction d’un intérêt thérapeutique.
Cour de cassation, 1° chambre civile 1, 23 mai 2000, n° 98-18513, publié
« Attendu que l’article 42 du code de déontologie médicale issu du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, applicable en la cause, autorise le médecin à limiter l’information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave ; que si une telle limitation doit être fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade, la cour d’appel a, sans dénaturation, procédé à la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise […] ».
Faits
Un homme avait contacté un médecin psychiatre exerçant en libéral pour un contexte dépressif à partir du mois d’avril 1987, et le psychiatre avait posé quelques mois plus tard le diagnostic de psychose maniaco-dépressive. Mais il n’avait pas informé le patient de ce diagnostic, retenant que l’évolution sous traitement d’une psychose maniaco-dépressive supposait un recul de plusieurs années et que l’état de santé du patient avait connu une amélioration nette en 1988 et 1989. Compte tenu de l’alternance des phases mélancoliques et d’excitation maniaque, il lui semblait nécessaire de faire preuve de beaucoup de prudence. En phase dépressive, l’annonce du diagnostic pouvait être un élément aggravant, et cette annonce dans une phase de stabilisation pouvait amener le patient à contester ce diagnostic, et à rompre la relation de soin. Aussi, le diagnostic a été annoncé tardivement.
Le patient a déploré cette information tardive et a engagé un recours en responsabilité contre le psychiatre, demandant réparation d’un préjudice moral, pour ne pas avoir été informé de ce diagnostic grave, et d’un préjudice matériel car l’ignorance du diagnostic l’avait privé de la possibilité de former une demande tendant à l’obtention d’une pension d’invalidité.
Textes
CSP, Art. R. 4127-35 :
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Analyse
Le code de déontologie médicale autorise le médecin à limiter l’information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave. Une telle limitation doit être fondée sur des raisons légitimes, dans l’intérêt du patient. Cet intérêt doit être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade.
Le médecin avait choisi de différer l’information sur le diagnostic en tenant compte du temps nécessaire à l’évaluation de la maladie une fois le traitement en place, de l’amélioration survenue en 1988 et 1989 et de la prudence nécessaire à la révélation de ce diagnostic. Aussi, l’intérêt du patient justifiait la limitation de son information quant au diagnostic, et le praticien n’avait pas commis de faute.
A retenir
La priorité est l’intérêt thérapeutique, qui peut conduire le médecin à limiter l’information sur un diagnostic ou un pronostic grave. Dans la mesure où les conditions sont respectées – nature de la maladie, évolution prévisible, personnalité du patient – elle est le moyen de conforter la relation médicale, qui doit rester fondée sur la confiance.
Règle 7 – Le médecin détenteur d’informations est tenu de délivrer ces informations au patient, sans s’en remettre à d’autres praticiens.
Conseil d’État, 28 juillet 2011, n° 331126, mentionné dans les tables
« Il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d’informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu’elles mettent en évidence des risques pour sa santé, à moins que celui-ci n’ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l’intermédiaire de son médecin traitant […] ».
Faits
Un patient, âgé de 57 ans, a subi au centre hospitalier d’Auxerre divers examens dont, le 13 mars 2001, une radiographie thoracique et, le 10 mai 2001, des biopsies bronchiques et un scanner thoracique. Les résultats de ces examens permettaient de suspecter que le patient était atteint d’un cancer bronchique et impliquaient nécessairement des investigations complémentaires afin de poser le diagnostic et de proposer un traitement. Ces résultats ont été transmis au médecin traitant, mais le médecin pneumologue du centre hospitalier n’a pas informé le patient de cette suspicion d’un cancer et de la prise en charge qui s’imposait. Le patient a de nouveau été admis au centre hospitalier d’Auxerre en janvier 2002. A alors été diagnostiqué un cancer du poumon avec dissémination osseuse, et le patient en est décédé.
Textes
CSP, art. L. 1112-1 :
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l’hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l’information des personnes soignées […].
Analyse
Il appartient aux praticiens spécialistes d’informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu’elles mettent en évidence des risques pour sa santé. La seule limite serait que le patient ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l’intermédiaire de son médecin traitant.
Les praticiens des établissements publics de santé avaient l’obligation d’informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier parce qu’elles mettaient en évidence des risques pour sa santé, et qu’un traitement est envisageable. Ce défaut d’information révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, qui a fait perdre au patient une chance de recevoir des soins permettant de retarder son décès, et la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre est engagée.
A retenir
Les praticiens doivent informer le médecin traitant des résultats des examens pratiqués sur le patient qui leur a été confié, mais ils ont aussi l’obligation d’informer directement le patient, surtout en cas de risques pour la santé et alors qu’un traitement est envisageable.
La juridiction administrative ne peut traiter que de l’attitude des praticiens hospitaliers, et il y a tout lieu de penser qu’une autre procédure a été engagée contre le praticien libéral, qui manifestement a sous-informé son patient.
Règle 8 – Dans le cadre d’une prise en charge commune, un médecin est tenu de transmettre les informations utiles à son confrère.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 28 octobre 1997, n° 95-17274, publié
« Mais attendu que la cour d’appel a pu décider que les obligations du chirurgien ophtalmologiste ne pouvaient se limiter aux seuls gestes chirurgicaux dès lors que, suivant depuis plusieurs années le patient dont le globe oculaire était plus allongé du fait d’une grande myopie, il se devait d’aviser le médecin anesthésiste des risques que comportait une anesthésie locale par injection rétrobulbaire […] ».
Faits
Un patient, qui avait déjà perdu la vision de son œil droit, a été opéré d’une cataracte à l’œil gauche par un chirurgien ophtalmologiste, avec une anesthésie locale pratiquée par un médecin anesthésiste. Or, le globe oculaire a été perforé par l’aiguille de l’anesthésiste.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- le globe oculaire du patient était allongé du fait d’une grande myopie ;
- ceci rendait préférable le recours à une anesthésie générale ou à l’utilisation d’une aiguille à biseau court, plutôt que celle d’une aiguille à biseau long, utilisée par l’anesthésiste ;
- le patient n’a recouvré, après l’opération, qu’une acuité visuelle réduite et un champ de vision extrêmement rétréci.
Procédure
Cour d’appel de Lyon, 3 mai 1995
L’anesthésiste a agi sans prendre les renseignements suffisants, et la technique était inadaptée. Le chirurgien a commis une faute en n’informant pas l’anesthésiste du fait que le globe oculaire était allongé, ce qui rendait préférable le recours à une anesthésie générale ou à l’utilisation d’une aiguille à biseau court, plutôt que celle d’une aiguille à biseau long. Aussi, la cour a retenu la responsabilité des deux praticiens, chacun pour moitié.
Cour de cassation, 28 octobre 1997
- Moyens en défense
Le chirurgien soutient pour sa défense qu’il revient au seul anesthésiste, qui a le libre choix du mode d’anesthésie, de rechercher les informations qui lui sont nécessaires pour exercer ce choix, et qu’il n’appartient pas au chirurgien de délivrer spontanément des informations à l’anesthésiste, dès lors qu’il ne peut connaître les informations qui sont nécessaires à celui-ci pour exercer son choix.
- Réponse de la Cour
Les obligations du chirurgien ne pouvaient se limiter aux seuls gestes chirurgicaux. Dès lors qu’il suivait depuis plusieurs années le patient dont le globe oculaire était plus allongé du fait d’une grande myopie, le chirurgien se devait d’aviser le médecin anesthésiste des risques que comportait une anesthésie locale par injection rétrobulbaire.
A retenir
L’indépendance inhérente à la fonction de médecin interdit tout rapport de hiérarchie dans la pratique des actes, qu’il s’agisse du diagnostic, du choix du traitement ou de la surveillance. Mais un praticien a l’obligation de transmettre à ses confères les informations pertinentes pour la meilleure prise en charge.
Règle 9 – C’est au médecin de prouver qu’il a informé le patient, et la preuve de l’information peut être apportée par tous moyens, notamment par présomption.
1/ Preuve à la charge du médecin
Cour de cassation, 1° chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19685, publié
« Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ;
« Attendu que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé […] ».
Faits
A l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype, est survenue une perforation intestinale.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- cet examen était nécessaire ;
- il a été pratiqué par un praticien compétent, et selon les règles de l’art ;
- la perforation a été une complication, ne laissant apparaître aucun manquement professionnel ;
- la reprise chirurgicale a été conforme aux bonnes pratiques ;
- le patient indique que le praticien ne l’avait pas informé du risque de perforation, et le praticien soutient le contraire.
En l’absence de faute dans la pratique de l’acte ou dans la reprise chirurgicale, le patient fonde son recours sur le défaut d’information.
Analyse
Cour d’appel de Rennes, 5 juillet 1994
Il appartient au patient, demandeur à l’action, de prouver que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque. Or, le patient ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse, et son recours a été rejeté.
Cour de cassation, 25 février 1997
Le médecin est tenu d’une obligation d’information vis-à-vis de son patient et, dans cette mesure, il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation. La cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, et son arrêt est cassé.
A retenir
Lors de sa publication, cet arrêt a causé un grand émoi, alors que la solution est certaine : le médecin est tenu par une obligation d’information, et c’est à lui de prouver qu’il s’en est acquitté. En réalité, les craintes étaient plutôt celles des modalités de la preuve, avec la crainte d’une preuve impossible. Mais la jurisprudence, puis la loi, sont venues dire que cette preuve peut être apportée par tous moyens, dans une démarche adaptée à la situation, loin du formalisme.
2/ Preuve par tout moyen
Cour de cassation, 1° chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-19609, publié
« Mais attendu que s’il est exact que le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens […] ».
Faits
Une patiente, née en 1957, a eu un enfant en 1977 et, ne parvenant à en avoir un second, elle a subi, à partir de 1982, des examens, bilans hormonaux et traitements, lesquels n’ont pas eu de résultats. Son médecin gynécologue lui a proposé de procéder à une cœlioscopie destinée à rechercher si elle ne présentait pas une étiologie ovarienne expliquant sa stérilité. La patiente, qui exerçait la profession de laborantine titulaire dans un centre hospitalier, a pris contact avec un médecin de l’établissement, spécialisé pour cet acte. Or, au cours de l’intervention, en mars 1983, est survenue une embolie gazeuse par migration du gaz d’insufflation dans les vaisseaux cérébraux, qui a été mortelle.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- l’indication de la cœlioscopie était justifiée ;
- la cœlioscopie a été pratiquée par un médecin expérimenté, et n’appelle aucune citrique ;
- le risque, grave, d’embolie gazeuse lors d’une cœlioscopie est connu ;
- la patiente avait eu divers entretiens avec le praticien, qui avait évoqué le risque de l’embolie gazeuse ;
- le médecin prescripteur avait donné lui aussi des informations sur ce risque ;
- la patiente a pris sa décision après un long temps de réflexion et, selon le dossier, manifesté de l’hésitation et de l’anxiété avant l’opération.
Analyse
Cour d’appel de Rennes, 31 mai 1995
La cour d’appel a examiné tous les éléments et indices du dossier pour se forger une conviction. En tenant compte de la profession exercée, des divers entretiens avec le médecin, du temps de réflexion très long lié à ses hésitations, de l’anxiété avant l’opération, des déclaration du médecin sur ce risque, justifiant ce temps de réflexion, elle a estimé que l’information avait été donnée de manière adaptée.
Cour de cassation, 25 février 1997
- Principe
Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription. Si le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens.
- Analyse
Le médecin n’apportait pas de preuve directe, mais l’analyse démontre, par un ensemble de présomptions de fait bien relevées par la cour d’appel, que la patiente avait été informée du risque grave d’embolie gazeuse inhérent à la cœlioscopie.
A retenir
La jurisprudence n’a jamais été en faveur du formalisme, et la loi (CSP, art. L. 1111-2 al. 3) précise que cette information « est délivrée au cours d’un entretien individuel ». En droit, l’information est un fait, et un fait se prouve par tout moyen. C’est ce régime de droit commun qui a été adapté à la matière médicale et sont retenus « tous les éléments et indices » : mention des entretiens dans le dossier, élaboration d’un processus dans le service, correspondances avec le médecin traitant, lettre au patient, remise de documentation, signature d’un document simple… en adaptant à la personnalité du patient. La simple signature d’une déclaration trop technique n’aurait que peu de valeur probatoire.
Règle 10 – Le médecin n’est tenu de recevoir l’accord des proches que si le patient n’est pas à même de se prononcer sur l’acceptation des soins.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 6 décembre 2007, n° 06-19301, publié
« Attendu que le médecin n’est tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord. […] ».
Faits
Un médecin traitant a prescrit pour son patient des examens, qui ont mis en évidence des lésions sténosantes majeures à l’origine d’une carotidie interne droite. Quatre jours après ces résultats, le médecin traitant a adressé son patient au chirurgien, alors même que l’on était en pleine période d’été, ce qui démontrait une certaine inquiétude. Le 5 août 1998, le patient a été opéré par un chirurgien cardiaque. Or, une hémiplégie s’est installée dès l’après midi du 5 août. L’état de santé n’a cessé de se détériorer jusqu’au décès survenu le 23 novembre 2001.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- l’intervention était nécessaire compte tenu de la gravité du problème cardiaque et de son évolution rapide ;
- l’intervention a été pratiquée par un médecin confirmé et selon les règles de l’art ;
- l’accident survenu doit être qualifié de complication ;
- ce risque grave est connu mais rare ;
- le chirurgien cardiaque n’a pas informé de ce type de risque.
Procédure : Cour d’appel de Bordeaux, 30 juin 2006
- Information donnée au patient
Le médecin a manqué à son devoir d’information en n’indiquant pas le risque encouru, ce qui est une faute. Mais, s’il n’y avait pas urgence immédiate au sens de l’urgence vitale, l’affection cardiaque décelée mettait la vie du patient à plus ou moins longue échéance en danger et le temps qui passait était un facteur de dégradation. Le médecin traitant avait lui-même souhaité cette intervention rapide. Aussi, l’insuffisante information n’a pas modifié l’acceptation du traitement, et la cour d’appel a rejeté cette première demande.
- Information de la famille
Les proches membres de la famille estimaient avoir subi un préjudice personnel pour le pas avoir été avisé de ce risque par le chirurgien. Pour cour, eu égard à la nature des risques encourus, ils auraient dû être avisés par le chirurgien, et leur préjudice moral aurait alors été moindre. Aussi, la cour a retenu la responsabilité du chirurgien vis-à-vis des proches.
Texte
CSP, R. 4127-36 :
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. […]
Analyse : Cour de cassation, 6 décembre 2007
- Principe
Le médecin n’est tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord.
- Analyse
Le patient était en mesure de recevoir l’information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés, de telle sorte que le chirurgien n’avait pas à donner l’information litigieuse à l’entourage familial.
A retenir
Le dossier laissait apparaître une faute, un défaut d’information, et un dommage corporel, l’hémiplégie puis le décès, mais il n’existait pas de lien de cause à effet entre la faute et le dommage : c’est la maladie qui a été la plus forte. Le médecin a commis une faute en n’informant pas le patient, mais en 2007, la Cour de cassation en était à l’analyse pragmatique : la faute n’ayant pas modifié l’acceptation des soins, la responsabilité ne peut être retenue. La responsabilité serait engagée pour le dommage symbolique liée au défaut d’information.
Enfin, le patient étant apte à recevoir l’information, le médecin ne commet pas de faute en n’informant pas les proches. Si le patient le souhaite, il peut bien entendu partager ces informations avec les proches, notamment par un entretien commun avec le médecin.
Règle 11 – Le non-respect du devoir d’information cause toujours un préjudice, même si l’acte médical est hors de critique
1/ Secteur privé
a/ Premier arrêt
Cour de cassation, 1° chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-13591, publié
« Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
« Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation […] ».
Faits
Un homme, souffrant depuis plusieurs années de troubles de la miction, a présenté au début du mois d’avril 2001 une rétention aigüe d’urine et a été traité en urgence à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux par la mise en place d’une sonde vésicale. Le 17 du même mois, il a consulté un chirurgien urologue exerçant en libéral, qui a préconisé une adénomectomie prostatique, pratiquée le 20 avril.
Or, le patient a connu, comme séquelle de cette intervention, une impuissance. Le chirurgien a admis que, dans le contexte, il n’avait pas estimé nécessaire d’informer sur ce risque. Le patient soutient que s’il en avait été informé, il n’aurait pas subi l’intervention, qu’ « il aurait pris du recul » et attendu le retour d’un autre chirurgien qui lui avait été recommandé. Il estime en conséquence avoir perdu une chance d’échapper au risque dont il n’a pas été informé et qui s’est réalisé.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- l’adénomectomie était justifiée ;
- elle a été effectuée dans les règles de l’art ;
- il n’y avait pas d’autre alternative et il fallait intervenir sans tarder en raison du risque d’infection que faisait courir la sonde vésicale ;
- le risque d’impuissance, comme séquelle aléatoire, est connu.
Textes
Code civil, Art. 16
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Code civil, Art. 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Procédure
- Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2007
Le tribunal a retenu une faute, à savoir le défaut d’information et l’existence d’un préjudice, sous forme d’une perte de chance de se soustraire à la survenance du risque, connu, qu’est l’impuissance, évaluée à 30 % du préjudice.
- Cour d’appel de Bordeaux, 9 avril 2008
Pour la cour, il est peu probable que le patient, s’il avait été averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de cette intervention, aurait renoncé à celle-ci et continué à porter une sonde vésicale qui non seulement lui faisait courir des risques importants de contracter une infection grave mais lui interdisait aussi toute activité sexuelle. La prise de recul dont il indique avoir été privé n’aurait fait qu’à aggraver le risque d’infection généré par le port d’une sonde vésicale. Aussi, le défaut d’information, qui est une faute, n’a pas fait perdre au patient une chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé. La cour d’appel a donc annulé le jugement, et rejeté les demandes du patient.
Analyse : Cour de cassation, 3 juin 2010
- Principe
Il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil que toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être accueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Dès lors, le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
- Analyse
Le fait que l’information n’ait pas été donnée sur le risque n’a pas modifié la décision du patient, même si celui-ci soutient le contraire, et les soins apportés par le médecin ont été de qualité. Mais en ne respectant pas ce devoir d’information, imposé par la loi et protecteur de la dignité, le médecin a commis une faute qui cause un dommage moral.
A retenir
La Cour de cassation semblait s’en tenir à une approche pragmatique : le défaut d’information n’engage la responsabilité que s’il a privé le patient d’échapper à la survenance d’un risque. La solution est désormais nette : le défaut d’information, dès qu’il est reconnu fautif, engage nécessairement la responsabilité car c’est une atteinte à un droit fondamental, la protection du corps et de la personne. C’est dire que même si les soins étaient nécessaires et ont été de qualité, le défaut d’information engage la responsabilité. L’indemnisation ne concerne que la compensation de ce dommage moral, appréciée à un montant essentiellement symbolique.
b/ Deuxième arrêt
Cour de cassation, 1° chambre civile, 26 janvier 2012, n° 10-26705, non publié
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés […] ».
Faits
Lors d’une consultation en libéral, un médecin a estimé très probable un cancer du lobe gauche de la thyroïde avec des métastases ganglionnaires, et il a ensuite pratiqué l’exérèse de la glande thyroïde. Mais, le praticien n’avait informé la patiente ni des risques importants de cancer thyroïdien que révélaient les examens pratiqués depuis plusieurs mois, ni de l’éventualité d’une thyroïdectomie totale, avec ses conséquences, et le diagnostic du cancer n’a été donnée dix jours après l’intervention.
Du dossier et de l’expertise il ressort que :
- les examens établissaient un faisceau d’arguments évoquant très fortement un cancer du lobe gauche de la thyroïde avec métastases ganglionnaires ;
- lorsqu’un tel diagnostic est envisagé, la stratégie thérapeutique consiste en une lobo-isthmectomie avec examen anapath extemporané suivie, en fonction du résultat anapath, d’une thyroïdectomie avec curage ganglionnaire si des adénopathies sont mises en évidence ;
- cette stratégie a été appliquée dans tous ses détails avec une rigueur parfaite par le praticien ;
- aucune faute, erreur, négligence ou maladresse ne peut être retenue en pré-per ou post- opératoire et/ou dans la surveillance ;
- l’examen anapath extemporané a confirmé l’existence d’un carcinome thyroïdien papillaire avec métastases massives ganglionnaires ;
- en théorie, le médecin aurait pu remettre l’hémi-thyroïdectomie droite à une date ultérieure ;
- dans la pratique cette fragmentation en deux temps n’est pas faite car elle représente deux interventions chirurgicales successives, donc deux anesthésies, impliquant une reprise chirurgicale dans un tissu post-opératoire récent inflammatoire avec une dissection plus difficile et donc un risque plus important de traumatisme au niveau des récurrents et/ou des parathyroïdes ;
- aussi, cette thyroïdectomie était médicalement justifiée, et carcinologiquement indispensable.
Procédure (Cour d’appel de Toulouse, 23 février 2009)
Il n’y a eu aucune faute dans le geste, mais un défaut d’information, ce qui est une faute. Ceci étant, la patiente n’avait perdu aucune chance de pouvoir choisir entre une technique opératoire et un traitement médicamenteux puisque l’intervention était médicalement indispensable. La patiente rapportant pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec le défaut d’information imputable au médecin, sa demande est rejetée.
Analyse (Cour de cassation, 26 janvier 2012)
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Dès lors, le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
A retenir
La prise en charge est exempte de critique et le défaut d’information n’a pas modifié le cours des choses. Mais le devoir d’information est imposé par la loi, et une indemnisation du préjudice moral est due pour le non-respect de ce devoir. C’est une application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 juin 2010, qui a rompu avec l’approche pragmatique. La responsabilité est engagée du seul fait du défaut d’information. Le praticien aurait pu se trouver dans la situation du « pieux mensonge », l’obligeant à différer l’annonce d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, mais les circonstances ne se retrouvaient pas en l’espèce.
2/ Secteur public
Conseil d’État, 10 octobre 2012, n° 350426, publié
Extrait
« Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles […] ».
Faits
Un patient a subi le 1er mars 2002 au CHRU de Rouen une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la découverte d’une tumeur rectale. Une coloscopie réalisée le 28 janvier 2002, établissait que cette intervention était impérieusement requise pour extraire la tumeur. Un abcès périnéal et une fistule sont apparus huit jours après l’opération. La fistule a été traitée sans succès par des soins locaux et quatre injections de colle biologique jusqu’au début du mois de juillet 2003. Le 24 juillet 2003, le patient subi à l’hôpital Saint-Antoine à Paris une intervention chirurgicale qui a permis la consolidation de son état de santé. Cette intervention impliquait le recours à une poche d’iléostomie et elle comportait des risques de complications graves comprenant, notamment, une atteinte probable des fonctions sexuelles.
Le rapport d’expertise a confirmé que cette intervention était impérieusement requise pour extraire la tumeur. Mais, les médecins du CHRU de Rouen n’établissaient pas que le patient avait été informé, avant l’opération chirurgicale du 1er mars 2002, de ce risque connu, qui s’est réalisé en dehors de toute faute de technique opératoire.
Procédure
Le recours en responsabilité a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen, puis par la cour administrative d’appel de Douai le 16 novembre 2010, les deux juridictions ont estimé que me manquement des médecins à leur obligation d’information n’a pas fait perdre au patient une chance de refuser l’intervention et d’échapper ainsi à ses conséquences dommageables.
Analyse (Conseil d’Etat, 10 octobre 2012)
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour le patient, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles.
A retenir
La Cour de cassation a ouvert la voie, et le Conseil d’Etat la rejoint. S’il existe une option thérapeutique, que le patient a été informé des risques, et que ce risque se réalise, le patient ne peut invoquer la perte de chance de se soustraire à ce risque, du fait du défaut d’information. Mais même lorsqu’il n’existe pas d’option thérapeutique, le défaut d’information est une faute qui crée un préjudice moral.
Règle 12 – Le défaut d’information engage la responsabilité au titre de la perte de chance de voir le risque se réaliser.
Conseil d’Etat, Assemblée, 19 mai 2004, n° 216039, publié
« Considérant, toutefois, que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur obligation […] ».
Faits
Un patient a été hospitalisé le 18 décembre 1991 à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil à la suite d’un infarctus du myocarde rudimentaire. Le 30 du même mois, il a dû subir un double pontage aorto-coronarien aux fins de revascularisation, et au cours de l’intervention, il a été victime d’un arrêt cardiaque prolongé qui a provoqué de graves lésions cérébrales qui l’ont rendu tétraplégique.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- l’indication opératoire état appropriée, susceptible d’apporter de bons résultats, mais elle n’était pas impérative ;
- l’intervention, l’anesthésie puis la réanimation au moment de l’arrêt cardiaque ont été conduites dans les règles de l’art ;
- l’intervention subie présentait des risques connus, notamment de séquelles neurologiques, et cette information n’a pas été donnée au patient.
Principe
Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.
Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur obligation.
La réparation du préjudice résultant pour le patient de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n’a pas été informé et qui s’est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
Analyse
- La faute
L’intervention subie, même conduite dans les règles de l’art, présentait des risques connus, notamment de séquelles neurologiques. Aussi, ces risques devaient être portés à la connaissance du patient, en l’absence d’urgence de nature à dispenser les médecins de leur obligation. L’AP-HP soutient que le patient avait été informé de ces risques, mais elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle lui a donné cette information, et la faute doit être retenue.
- Le préjudice
Compte tenu du rapprochement entre, d’une part, les risques inhérents à l’intervention et, d’autre part, les risques encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, la perte de chance doit être fixée à 30 %.
A retenir
S’il y a eu un acte maladroit, fautif, la réparation est due pour le dommage causé. Or, il résulte un dommage dramatique, une tétraplégie, mais en l’absence de faute, la responsabilité n’est pas engagée. Depuis la loi du 4 mars 2002, un tel dommage serait susceptible d’être pris en charge par l’ONIAM.
Si l’acte n’est pas fautif et qu’est en cause la survenance d’un risque connu, la juridiction doit apprécier si le défaut information a privé le patient de chances de voir ce risque se réaliser. Ici, l’indication opératoire était adaptée mais pas impérative. Le Conseil d’Etat ne retient pas une causalité totale, car sans l’intervention, l’état de santé était voué à se dégrader, et la perte de chance a été évaluée à 30%.
Règle 13 – Transfusions sanguines : le libre consentement à un traitement médical est une liberté fondamentale, mais pratiquer sans consentement un acte indispensable à la survie et proportionné à l’état de santé est une atteinte qui est tolérable.
Conseil d’État, Ordonnance du Juge des Référés, 16 août 2002, n° 249552, non publiée
« Considérant que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-3 du code civil et par celles de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 […] ».
Faits
Une patiente a été hospitalisée le 28 juillet 2002 pour une fracture du membre inférieur gauche au CHU de Saint-Étienne, justifiant une intervention chirurgicale. Elle fait savoir oralement puis a confirmé par écrit qu’en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l’administration de tout produit sanguin.
Au décours de l’intervention chirurgicale, qui a été hémorragique, elle a été admise au service des soins intensifs post-opératoires. L’état de la patiente évoluant dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, les médecins du centre hospitalier ont estimé que le recours à une transfusion sanguine s’imposait pour sauvegarder sa vie, et cet acte a été pratiqué le 5 août 2002. L’état de santé s’est amélioré mais et resté fragile, et la patiente redoutait qu’une nouvelle perfusion soit pratiquée.
Texte
CSP, art. L. 1111-4 :
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Procédure (Tribunal administratif de Lyon, 9 août 2002)
Assistée de sa personne de confiance (CSP. Art. L. 1111-6), la patiente a saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon (Code de justice administrative, Art. L. 521.2) lui demandant d’enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l’administration forcée d’une transfusion sanguine.
Par ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s’abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie, mais il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s’appliquer si la patiente « venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ».
Analyse : Conseil d’Etat, 16 août 2002
- Principe
Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale. Toutefois, les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9, qui protège la liberté de religion.
- Analyse
Les praticiens doivent s’abstenir de procéder à des transfusions sanguines devant le refus opposé par la patiente, au titre du respect du consentement aux soins. Devant une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital, les praticiens doivent tout mettre en œuvre pour convaincre la patiente d’accepter les soins indispensables, et s’assurer que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l’intéressée et proportionné à son état. Si ces deux conditions sont réunies, les praticiens peuvent pratiquer les transfusions nécessaires.
A retenir
Le refus de transfusion sanguine est opposable au médecin au titre du respect du consentement. Le médecin ne peut passer outre qu’en cas de risque vital, après avoir tout fait pour tenter de convaincre le patient, et s’il n’existe aucune solution alternative. Ces décisions mettant en cause deux libertés fondamentales – protection de la personne et liberté de religion – les praticiens doivent procéder à une analyse très attentive de la situation avant de décider.
Au regard de ce qu’est la croyance dans la vie des personnes, cette jurisprudence qui respecte la volonté tant que la personne est en mesure de l’exprimer n’emporte pas l’adhésion.
Responsabiité civile
Règle 14. – Le médecin s’engage àdonner des soins consciencieux, attentifset conformes aux données acquises de la science.
Cour de cassation, chambre civile, 20 mai 1936 (Arrêt Mercier)
« Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle […] ».
Faits
En 1925, une patiente, atteinte d’une affection nasale, s’est adressé à un radiologue, qui lui a prodigué un traitement par les rayons X, à savoir dix applications en deux séries. A la suite de ce traitement, est apparue une radiodermite des muqueuses de la face. Estimant que cette nouvelle affection était imputable à une faute du praticien, la patiente a engagé un recours en responsabilité civile.
Analyse
Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
A retenir
Cet arrêt reste la référence par la définition du devoir du médecin : donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. Toute la responsabilité médicale repose sur la faute. Cette notion est analysée en matière civile et administrative, par référence à la notion générale de « faute », retenue par l’article L. 1142-1-I du CSP et définie en matière pénale, par référence à la notion de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, par l’article 121-3 du Code pénal.
Règle 15 – Le médecin répond des conséquences dommageables des actes de prévention,de diagnostic ou de soins qu’il accomplit en cas de faute.
1/ Secteur privé
Cour de cassation, 1° chambre civile, 28 janvier 2010, n° 09-10992, publié
« Le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit ».
Faits
Une patiente a été opérée le 16 juillet 2002 à la Clinique Saint François en raison de douleurs épigastriques dues à un reflux gastro-oesophagien provoqué par une hernie hiatale. L’intervention laissant comme suites des douleurs intenses, le chirurgien a orientée la patiente vers le CHU de Limoges, où elle a bénéficié d’une intervention réparatrice, le 09 juin 2004. La patiente conserve des séquelles importantes liées à la première intervention, et elle a engagé un recours contre le chirurgien de la clinique.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- le chirurgien a fait une intervention mutilante, inutile, inadaptée à la pathologie et a réuni toutes les conditions opératoires d’un échec ;
- la patiente n’était pas demanderesse d’une intervention chirurgicale, mais simplement d’un soulagement à ses souffrances ;
- la patiente a subi des séquelles préjudicielles, à savoir une persistance du reflux gastro-œsophagien, une aggravation de son retentissement fonctionnel et des troubles fonctionnels secondaires à la vagotomie ;
- une nouvelle intervention chirurgicale s’est avérée nécessaire pour limiter ces séquelles, sans pouvoir les supprimer.
Texte
CSP, Art. L. 1142-1-I
- – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Procédure
- Tribunal de Grande Instance de Châteauroux, 29 Juin 2007
Le tribunal a retenu la faute technique du chirurgien et le manquement à l’information, et a alloué des dommages et intérêts pour les conséquences corporelles de la faute, et pour le dommage moral lié à la sous information.
- Cour d’appel de Bourges, 24 avril 2008
La cour d’appel a retenu la responsabilité du chirurgien, mais pour apprécier les conséquences, elle s’est prononcée en fonction de la violation de son devoir d’information, analysant le préjudice comme une perte de chance d’éviter l’opération chirurgicale et donc d’en subir les conséquences. Aussi, la patiente a perdu une chance d’éviter l’opération chirurgicale, et elle doit être indemnisée pour cette perte de chance.
Analyse (Cour de cassation, 28 janvier 2010)
- Principe
En vertu de l’article L. 1142-1-I du CSP, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit.
- Analyse
Pour limiter la condamnation du chirurgien à l’indemnisation de certains dommages subis par la patiente, la cour d’appel retient qu’en raison de la violation de son devoir d’information par le médecin, celle-ci a perdu une chance d’éviter l’opération chirurgicale. Quel que soit le « désir » du malade, c’est au chirurgien qu’incombe la responsabilité de décider le traitement. Or, les préjudices dont la patiente avait été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive de l’intervention chirurgicale, qui doit être qualifiée de mutilante, non justifiée et non adaptée. Aussi, la cour d’appel ne pouvait limiter l’indemnisation à une perte de chance d’éviter le dommage.
A retenir
L’information que doit délivrer le praticien porte sur les risques, entendus comme les risques de complication… et non pas comme les risques de fautes techniques. S’il y a eu une faute, la réparation est due comme conséquence de cette faute. S’il y a eu en plus défaut d’information, viendra une réparation spécifique, de type moral.
Le droit de la santé a été construit par la jurisprudence à partir des concepts traditionnels du droit : contrat en droit privé, usager du service en droit public. Mais la qualité des soins attendue dans les établissements privés et publics est la même et les coopérations se multiplient. Prenant acte de ces données actuelles, la loi du 4 mars 2002 a créé un fondement législatif unique pour les faits postérieurs au 1° septembre 2001. C’est la notion de faute dans les actes de prévention, de diagnostic ou de soins, définie par l’article L. 1142-1-I du CSP. Cette faute « générale » reste appréciée au regard du devoir du médecin de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, selon la formule de l’arrêt Mercier (n° 14). L’approche théorique changera peu les solutions pratiques, mais elle témoigne d’une autonomie du droit de la santé. En réalité, l’essentiel tient en cette formule : la responsabilité du médecin ne peut être engagée que s’il a commis une faute.
2/ Secteur public
Conseil d’Etat, assemblée, 10 avril 1992, n° 79027, publié
« Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d’expertise la cause de l’accident survenu à Mme V., constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital […] ».
Faits
Une femme a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l’hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), un établissement public, une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale. Au cours de l’opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d’un arrêt cardiaque. La patiente a pu être réanimée, puis elle a été transférée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu’au 4 juillet 1979. Elle demeure atteinte d’importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l’anoxie cérébrale consécutive à l’arrêt cardiaque survenu au cours de l’intervention du 9 mai.
Il résulte du dossier et de l’expertise que :
- l’existence d’un placenta praevia avait été décelée par une échographie ;
- la césarienne pratiquée présentait de ce fait un risque connu d’hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ;
- le médecin anesthésiste a administré à la patiente, avant le début de l’intervention, une dose excessive d’un médicament à effet hypotenseur, et une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ;
- une deuxième chute de la tension artérielle s’est produite à onze heures dix ;
- après la césarienne et la naissance de l’enfant, un saignement s’est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d’une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ;
- à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l’arrêt cardiaque.
Procédure
Le Tribunal administratif de Rouen, par jugement du 4 avril 1986, a rejeté le recours estimant que ces fautes, réelles, ne pouvaient être qualifiées de fautes lourdes, critère alors exigé pour engager la responsabilité d’un hôpital.
Analyse (Conseil d’Etat, 10 avril 1992)
Les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d’expertise la cause de l’accident survenu à la patiente constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. La responsabilité de l’établissement est engagée du fait de fautes médicales, sans qualification de gravité.
A retenir
De tradition, la jurisprudence administrative considérait que les établissements publics supportaient des contraintes qui justifiaient une bienveillance dans l’appréciation des fautes médicales, et la responsabilité n’était engagée que si était prouvée une faute lourde. Ce critère explique que, dans cette affaire, malgré cette accumulation de fautes, la responsabilité n’avait pas été retenue par le tribunal administratif de Rouen. Cette jurisprudence ne correspondait plus aux réalités sanitaires, et par cet arrêt,le Conseil d’Etat l’a abandonnée.
Le seuil de l’erreur ne suffit pas, car il faut atteindre celui de la faute. Celle-ci est appréciée selon la référence courante de l’obligation de moyens, telle qu’elle a été posée par l’arrêt Mercier, celui des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Règle 16 – Dans une clinique privée, l’exécution défectueuse du contrat d’hospitalisation et de soins engage la responsabilité vis-à-vis du patient et vis-à-vis des proches.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 18 juillet 2000, n° 99-12135, publié
« Attendu qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient ; que la cour d’appel, qui a constaté qu’après avoir été ligotée sur son lit en raison de la gravité de sa crise Brigitte X… avait été laissée sans surveillance, aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvant à l’étage où se situait sa chambre, et que seul l’appel d’une autre malade avait permis de lui venir en aide, n’a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
« Attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins liait la clinique à la seule Brigitte X… et que l’action de M. X… tendant à la réparation de son préjudice par ricochet et de celui de sa fille avait nécessairement un caractère délictuel, et d’autre part, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve […] ».
L’histoire
Une patiente souffrant d’une psychose maniaco-dépressive, a été hospitalisée, le 12 novembre 1992, dans un établissement psychiatrique privé. Un mois plus tard, le 10 décembre, elle a fait une première tentative de suicide.
Le 13 février, son état s’est brutalement aggravé, au point que vers 19 heures 30 un médecin, estimant qu’elle était dans un état paroxystique susceptible de l’entraîner au suicide, a prescrit son immobilisation sur son lit par des sangles aux poignets et aux chevilles. Vers 20 heures 45, la malade occupant une chambre voisine a donné l’alerte en raison des cris de la patiente et d’émanations de fumées provenant de sa chambre. Il a alors été constaté que le sommier du matelas du lit sur lequel la patiente était attachée avait pris feu, provoquant des brûlures au 3° degré sur 45 pour cent de son corps. Le traitement des brûlures a nécessité, entre autre, l’amputation des avant-bras puis une hospitalisation dans un établissement pour grands brûlés. Les séquelles étaient très importantes.
Le 27 juillet, la patiente a disparu et son corps a été découvert, noyé dans une pièce d’eau voisine, quatre jours plus tard.
Le procès
Volet pénal
La famille a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile.L’enquête a conclu à une tentative de suicide au moyen d’un briquet dont des débris ont été retrouvés sous la main gauche de la patiente.Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situations, l’instruction pénale n’a pas permis d’identifier, au sein du personnel médical et paramédical de la clinique, à qui pouvaient être imputées avec certitude les fautes ayant participé à la réalisation du dommage du fait de la diffusion des tâches dans l’équipe.Aussi, le juge a prononcé une ordonnance de non-lieu le 30 juillet 1993.
Précision : une ordonnance de non-lieu n’a pas autorité de chose jugée, en matière pénale comme vis-à-vis d’un procès civil.
Volet civil
Le mari de la défunte a engagé un recours en responsabilité civile visant les fautes de surveillance commises par la clinique, la réparation des divers préjudices subis par son épouse, et, sur le terrain délictuel, la réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille.
Cour d’appel de Grenoble, 3 novembre 1998
Responsabilité vis-à-vis de la patiente
La cour a estimé qu’aucune faute de surveillance ne pouvait lui être reprochée au cours de la soirée du 13 février 1993. En l’absence de faute, la responsabilité a été écartée.
Responsabilité vis-à-vis des proches
La responsabilité délictuelle de la clinique ne pouvait être juridiquement recherchée puisque la patiente n’était pas un tiers, mais une partie au contrat.
Cour de cassation, 18 juillet 2000
Action au nom de la victime
- Principe
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.
- Analyse
La patiente, qui a juste titre avait été attachée sur son lit en raison de la gravité de sa crise, a été laissée sans surveillance dès lors qu’aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvait à l’étage où se situait sa chambre, et que seul l’appel d’une autre malade avait permis de lui venir en aide. Ceci caractérise le défaut de surveillance, qui est une faute dans l’exécution du contrat la liant à la patiente et engage sa responsabilité.
Action des proches
- Principe
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse d’un contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve.
- Analyse
L’exécution défectueuse du contrat d’hospitalisation et de soin a causé un dommage aux proches par la perte d’un être cher, ce qui engage la responsabilité.
A retenir
Cet arrêt illustre d’abord la différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Le fait que la patiente, attachée, ait pu se procurer un briquet et la tardiveté de la réaction du personnel établissent une faute de service, ce qui engage la responsabilité civile. Mais sur la plan pénal, un non-lieu a été prononcé car il n’a pas été possible d’individualiser les fautes dont on est certain qu’elles avaient participé à la réalisation du dommage. Il n’est pas nécessaire que le lien de causalité soit exclusif, mais il doit être certain. De tels faits ouvrent deux recours : le patient, d’abord, et s’il est décédé, les proches exercent ce droit dans le cadre de la succession ; les proches ensuite, qui subissent un dommage moral, et sont recevables à agir alors qu’ils sont tiers à la relation médicale.
Règle 17 – La faute médicale est examinée par références aux données acquises de la science et non pas aux données « actuelles ».
Cour de cassation, 1° chambre civile, 6 juin 2000, n° 98-19295, publié
« Attendu qu’à l’encontre de cette décision M. X… invoque des griefs tirés d’un défaut de recherche quant à la thérapeutique la meilleure et à sa conformité aux données » actuelles » de la science et allègue une dénaturation du rapport d’un médecin ;
« Mais attendu, d’abord, que l’obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins ; que la troisième branche du moyen, qui se réfère à la notion, erronée, de données actuelles est dès lors inopérante […] ».
Faits
En 1989, unmédecin, a traité une fracture de l’auriculaire de la main droite par une immobilisation plâtrée. La raideur invalidante de ce métacarpien subsistait après l’enlèvement du plâtre, et le patient se plaignait en outre de douleurs au niveau du poignet droit, qui se sont révélées imputables à une disjonction scapho-lunaire. Le patient a consulté un second médecin, qui a procédé à une correction chirurgicale de l’auriculaire et à une réduction de la disjonction avec un brochage scapho-lunaire associé à une suture ligamentaire. Ces interventions n’ont pas permis d’améliorer l’état de santé, et le patient a mis en cause la responsabilité des deux praticiens en leur reprochant d’avoir fait des choix thérapeutiques erronés.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- les actes pratiqués ont conformes aux bonnes pratiques ;
- en 1989, date des soins prodigués par les deux médecins, les données acquises de la science, tant en ce qui concerne la fracture de l’auriculaire que la disjonction scapho-lunaire, autorisaient le recours soit à une immobilisation plâtrée, soit à une intervention chirurgicale, sans que l’une de ces alternatives thérapeutiques puisse être privilégiée ou au contraire déconseillée quant à ses résultats espérés.
Procédure
La cour d’appel, par un arrêt du 4 septembre 1997 confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, a rejeté le recours du patient, le patient n’apportant pas la preuve d’une faute des médecins au regard des bonnes pratiques.
Analyse (Cour de cassation, 3 juin 2000)
- Argument en défense
La cour d’appel n’a pas recherché s’il n’existait pas de thérapeutique meilleure, en conformité aux données « actuelles » de la science.
- Principe
L’obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins. Aussi, l’argument fondé sur la notion de données « actuelles » est sans pertinence.
A retenir
Le partage des connaissances et des bonnes pratiques va désormais très vite, et le médecin a le devoir déontologique d’améliorer en permanence ses compétences, mais s’agissant de la responsabilité, la référence reste les données « acquises » de la science. Si un praticien sait qu’une autre équipe peut faire bénéficier de soins plus adéquats, il doit proposer au patient le transfert.
1/ Opposabilité des RMO
Conseil d’État, 12 janvier 2005, n° 256001, publié
« Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins est compétente pour connaître des fautes ainsi que de tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre d’un médecin ; qu’aux termes de l’article 32 du code de déontologie, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ;
« que la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que M. X n’avait pas tenu compte pour dispenser ses soins à ses patients des données acquises de la science, telles qu’elles résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l’agence nationale pour le développement de l’évaluation en médecine puis par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, en s’abstenant de prescrire le dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans et le renouvellement tous les trois ans de cet examen, et qu’il avait ainsi méconnu les dispositions des articles 8 et 32 du code de déontologie […] ».
Faits
Un praticien libéral a été poursuivi par la Caisse de sécurité sociale dans le cadre du contentieux du contrôle technique, pour deux griefs. Il lui était reproché d’une part d’avoir coté des actes d’échographie dépourvus de justification médicale et prescrit des dosages sans indication médicale fondée, et d’autre part de ne pas prescrire le dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans, ni le renouvellement tous les trois ans de cet examen
Par décision du 11 février 2003, la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont un mois avec le bénéfice du sursis.
Analyse
- Nécessité médicale des prescriptions
CSP, Art. R. 4127-8
Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Le fait d’avoir, à de nombreuses reprises, coté des actes d’échographie dépourvus de justification médicale et prescrit des dosages sans indication médicale fondé, constitue un manquement aux dispositions de cet article.
- Respect des données acquises de la science
CSP, Art. R. 4127-32
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Un médecin est tenu de dispenser ses soins en fonction des données acquises de la science, telles qu’elles résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l’agence nationale pour le développement de l’évaluation en médecine puis par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Or, en s’abstenant de prescrire le dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans et le renouvellement tous les trois ans de cet examen, le praticien avait ainsi méconnu les dispositions des articles 8 et 32 du code de déontologie.
A retenir
La liberté de prescription est un pilier de la pratique médicale et elle n’est pas remise en cause par les RMO ou documents équivalents. En revanche, la méconnaissance des RMO ou leur mise à l’écart systématique sont des fautes, et il faut de bonnes raisons pour pouvoir s’écarter de ce que proposent les RMO.
2/ Référence internationales.
Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 210590, publié
« Considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la juridiction disciplinaire, à qui il appartient d’apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d’un procédé ou d’un remède, doit examiner l’ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction ; qu’ainsi en se fondant sur ce que ni l’efficacité ni l’innocuité des médicaments prescrits par M. X… à ses patients n’avaient été établies en France, sans rechercher quelle était l’opinion de la communauté scientifique internationale, dont des travaux étaient invoqués devant elle, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a, par un motif qui n’est pas surabondant, entaché sa décision d’une erreur de droit […] ».
Faits
Un médecin prescrivait à ses malades des médicaments tels le vaccin de Friedman, le D.P.G., le Bioparyl et les produits Beljanski, généralement en provenance de pays étrangers, dépourvus d’autorisation de mise sur le marché, dont la composition lui était parfois inconnue, qui n’avaient jamais fait l’objet de tests expérimentaux dans le cadre de la loi du 20 décembre 1988 et dont ni l’efficacité ni l’innocuité n’avaient été établies en France. Ce médecin a fait l’objet d’une plainte disciplinaire et pour sa défense, il soutenait que ces traitements faisaient l’objet de reconnaissance au niveau international. La section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois.
Texte
CSP, Art. R. 4127-39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Analyse
En application de l’article 39 du Code de déontologie médicale, la juridiction disciplinaire est souveraine pour apprécier le caractère suffisamment éprouvé d’un procédé ou d’un remède, mais elle doit examiner l’ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction.
Or, la juridiction ordinale s’est fondée sur le fait que ni l’efficacité ni l’innocuité des médicaments prescrits par le médecin à ses patients n’avaient été établies en France, sans rechercher quelle était l’opinion de la communauté scientifique internationale dont des travaux étaient invoqués devant elle. Aussi, la décision du 15 avril 1999 est annulée et l’affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins.
A retenir
Pour apprécier le caractère suffisamment éprouvé d’un procédé ou d’un remède, la juridiction ordinale doit examiner l’ensemble des données scientifiques, et notamment les références internationales. Le juge ne se prononce pas sur la pertinence du traitement, donnée purement scientifique, mais il vérifie que la méthode de choix a été bonne, ce qui suppose d’inclure les données internationales.
Régle 19 – Dès lors qu’il n’y avait pas de risques connus, la chute d’une patiente ne révèle pas d’un défaut de surveillance, mais en revanche, l’insuffisant examen des suites de cette chute peut engager la responsabilité
1/ Première décision
CAA de Lyon, 12 juillet 2018, n° 16LY02785
Faits
Un patient qui était atteint d’un cancer bronchique parvenu en phase terminale, a été hospitalisé, le 5 mars 2012, pour une détresse respiratoire aigüe au centre hospitalier de Chambéry.
Le 9 mars 2012, son épouse qui lui rendait visite l’a retrouvé sans vie au pied de son lit.
Procédure
La requérante soutient que le centre hospitalier de Chambéry a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance de son époux dès lors qu’elle l’a retrouvé sans vie partiellement dévêtu au pied de son lit. Elle souligne que son époux était atteint de troubles de vigilance du fait des métastases cancéreuses cérébrales dont il était atteint et que cette situation médicale aurait dû conduire les praticiens à lui attribuer un lit équipé de barrières latérales de sécurité qui, relevées, l’aurait empêché de se lever. Elle impute à cette absence de barrières le lever de son époux et les conditions dans lesquelles elle l’a trouvé gisant au sol en partie dénudé.
Analyse
Le patient alors âgé de soixante-quatre ans, est décédé des suites d’un épisode de détresse respiratoire, conséquence du cancer métastasé au stade terminal dont il souffrait et non d’une chute de son lit alors qu’il aurait essayé de se lever pour se rendre aux toilettes. Par suite, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre le décès et l’absence de barrières sur son lit d’hôpital.
Le 9 mars 2012, jour de son décès, bien qu’affaibli et présentant certains troubles de vigilance, le patient a pu tout comme la veille effectuer sa toilette au lavabo en bénéficiant d’une aide partielle. Il conservait donc le 9 mars 2012 une certaine mobilité et était en capacité de réaliser certains gestes de la vie quotidienne soit seul soit si besoin était en demandant de l’assistance au personnel soignant y compris en faisant usage des signaux classiques d’alerte au moyen de la sonnette rattachée à son lit. Dès lors, il ne résulte pas des pièces médicales versées au débat que le patient présentait le jour de son décès des symptômes ou un état de grande faiblesse tels qu’ils auraient nécessité qu’il lui soit interdit matériellement de se lever par la mise en place d’un système de barrières relevées et que soit mis en place un dispositif spécifique médical d’assistance dans tous les gestes de la vie quotidienne prenant notamment la forme d’une sonnette mobile pour alerter le personnel soignant d’un souhait de se rendre aux toilettes tel que mentionné par la requérante.
L’état de santé du patient ne s’opposait pas à ce qu’il puisse se rendre aux toilettes et ne rendait pas indispensable la mise à disposition d’un bassin dans son lit. Les visites du personnel soignant effectuées le 9 mars 2012, jour du décès, successivement à 7 h 00, 9 h 00, 10 h 00, 14 h 00 et 15 h 15, soit pour cette dernière 2h30 avant sa découverte par son épouse au pied de son lit, n’avaient pas donné lieu à des observations particulières quant à l’existence d’une dégradation de l’état général ou d’une perte marquée de sa vigilance. Il n’est pas fait état de chutes antérieures qui auraient pu conduire l’équipe à mettre en œuvre une surveillance accrue ou des mesures particulières destinées à prévenir d’éventuelles chutes ou à l’empêcher de sortir de son lit.
Par suite, compte tenu de l’âge, des antécédents médicaux et de l’état de santé du patient, l’absence de mise en place de barrières latérales de sécurité sur son lit d’hôpital ne peut pas être regardée comme constitutive d’un défaut de surveillance ou de sécurité susceptible d’engager, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 CSP.
2/ Deuxième décision
CAA de Bordeaux, 2 mai 2017, n° 14BX02717
Faits
Une patiente âgée de 87 ans a été hospitalisée le 12 juillet 2006 en vue d’une intervention chirurgicale consistant en une amputation de deux orteils du fait d’une nécrose artéritique.
Dans la nuit du 12 au 13 juillet, elle a été victime d’une chute, qui a entraîné une fracture-luxation du rachis cervical, à la suite de laquelle il lui a été délivré un traitement anti-douleur.
Après son transfert, le 17 juillet 2006, dans le service de chirurgie viscérale, la patiente se plaignant de douleurs au niveau de la nuque, il lui a été prescrit une radiographie qui n’a été réalisée que le 26 juillet 2006.
Le 31 juillet suivant, il a été prescrit à la patiente le port d’un collier cervical jour et nuit.
Les souffrances se sont poursuivies, et le 11 septembre 2016, a été posé un diagnostic identifiant une fracture de la deuxième vertèbre cervicale.
Analyse
Aucun des éléments portés à la connaissance de l’équipe hospitalière notamment quant à l’âge de la patiente, ses antécédents et son état de santé, ne justifiait une contention et une surveillance particulière. La patiente, antérieurement à son hospitalisation, restait seule la nuit à son domicile. D’ailleurs, l’équipe médicale n’avait prescrit ni l’une ni l’autre.
Ainsi, le défaut de mise en place de barrières sur le lit qu’occupait la patiente, équipé d’un dispositif d’appel des infirmiers et aides-soignants, ne constituait pas une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.
La chute relève du comportement de la patiente, et pas d’une faute de l’équipe.
En revanche, le retard de diagnostic de la fracture dont a souffert la victime, avec la prescription d’un collier minerve au lieu d’une grande minerve, relève d’un examen inattentif et d’une surveillance insuffisante, ce qui engage la responsabilité.
3/ Troisième décision
CAA de DOUAI, 20 novembre 2018, N° 17DA00293
Faits
Une patiente, alors âgée de soixante-quatorze ans, a été admise le 17 juin 2015 au centre hospitalier de Sambre-Avesnois pour une décompensation respiratoire. Elle a fait une chute dans sa chambre le 22 juin 2015 à la suite de laquelle une fracture du col du fémur a été diagnostiquée et qui a nécessité une opération le 23 juin 2015 pour la pose d’une prothèse de la hanche.
Son fils fait valoir que sa mère ne pouvait se lever, qu’elle a été laissée debout le temps d’aller chercher une lingette et qu’ainsi, il y a eu défaut de surveillance de celle-ci.
Analyse
Il résulte du dossier médical de la patiente ainsi que du compte-rendu transmis par le centre hospitalier à son médecin traitant le 2 juin 2015, que le matin du 22 juin 2015, lors de sa toilette pour laquelle elle était assistée par une aide-soignante et une infirmière, la patiente qui avait été assise sur la chaise percée des toilettes, a glissé sur les fesses et a chuté mécaniquement alors que l’infirmière s’était écartée brièvement pour prendre le matériel nécessaire pour la nettoyer à la salle de bains.
Le fils soutient que sa mère n’a pu chuter qu’en raison d’un défaut de surveillance, mais il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la patiente nécessitait une surveillance particulière, notamment lorsqu’elle était aux toilettes et donc en position assise. Par suite, la chute, purement accidentelle, ne révèle aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier
Règle 20 – Seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 17 janvier 2008, n° 06-20107, publié
« Attendu que seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité […] ».
Faits
Le 16 février 1998, un chirurgien-dentiste, dont le cabinet est en Martinique, a tenté en vain d’extraire une dent à un patient. Celui-ci, alerté par des sifflements et des saignements de sa narine droite, a décidé, après avoir effectué des examens radiographiques, de rentrer en métropole pour faire extraire cette dent. L’extraction de la dent a alors pu être achevée. A alors été diagnostiquée une perforation du sinus et le patient a recherché la responsabilité du chirurgien-dentiste exerçant en Martinique.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- la communication bucco-sinusale a été le fait du chirurgien-dentiste au cours de la tentative d’extraction du 16 février 1998 ;
- le geste du chirurgien-dentiste doit être considéré comme maladroit ;
- l’infection du sinus maxillaire droit a été déclenchée par la tentative d’extraction ;
- le transfert entre la Martinique et Paris, du fait de la climatisation à bord et les variations d’altitude, a aggravé l’infection.
Procédure
Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Fort-de-France, le 4 novembre 2005, le patient avait pris un risque en décidant de partir se faire soigner en métropole, et de fait, le vol a aggravé l’infection. Aussi, doit être retenu un partage de responsabilité entre le patient et son médecin.
Analyse
Seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité.
La communication bucco-sinusale a été la conséquence de la faute du chirurgien-dentiste, au cours de la tentative d’extraction, mais il est certain que le retour décidé par le patient a aggravé l’infection du sinus.Toutefois, il n’est pas prouvé que la décision de rentrer en métropole présentait un caractère fautif, et la responsabilité du praticien reste entière.
A retenir
Le droit de la responsabilité n’a pas rendu le patient irresponsable, mais sa responsabilité n’est prise en compte que si son comportement traduit une faute. On retrouve la nécessité de la faute, mais qui n’est pas celle du professionnel, compétent et avisé. C’est celle du particulier appréciée comme celle du « bon père de famille », moyennement prudent et diligent. La jurisprudence tient compte du comportement humain face à la maladie, et il faut atteindre un réel degré de gravité pour que soit reconnu la faute, notamment pour des comportements tels que la non-observance du traitement ou l’insuffisance des informations données au médecin sur des antécédents.
Règle 21 – Lorsque lafaute a compromis les chances d’un meilleur état de santé,la réparation est évaluée en proportion de l’ampleur de la chance perdue
1/ Première décision
Conseil d’État, 21 décembre 2007, n° 289328, publié
« Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue […] ».
Faits
Un patient a été opéré en septembre 1995 dans un établissement de santé privé pour une trabléculectomie de l’œil droit, consécutive à un glaucome post-traumatique. Son état s’étant aggravé, le patient s’est rendu au service des urgences du Centre hospitalier de Vienne le dimanche 5 novembre 1995 dans l’après-midi, où il a été examiné par l’ophtalmologiste de garde. Celui-ci lui a prescrit un traitement antibiotique par voie orale et lui a conseillé de revoir son médecin traitant. Les douleurs s’aggravant, le patient est retourné aux urgences dans la nuit, et lui a été prescrit un antalgique par voie veineuse. Il s’est rendu chez son médecin traitant le lundi 6 novembre en début de matinée, et sur les conseils de celui-ci, il a été admis au centre hospitalier le même jour en début d’après-midi, où a été constatée une ulcération centrale de la bulle de filtration entraînant une endophtalmie brutale. Malgré un traitement antibiotique par voie veineuse, le patient a perdu totalement la vision de son œil droit.
Il résulte du dossier et de l’expertise que :
- le diagnostic définitif d’endophtalmie n’a été posé que lors de la troisième consultation aux urgences du centre hospitalier, soit le lundi en début d’après-midi ;
- l’enophtalmie constitue une complication rare mais connue de la chirurgie du glaucome ;
- compte tenu des signes réunies, le diagnostic aurait dû être posé lors de la deuxième consultation, ce qui aurait permis la mise en place d’un traitement approprié d’administration d’antibiotiques par voie veineuse ;
- l’enophtalmie peut conduire, même traitée à temps, à la cécité de l’œil et à supposer que l’infection oculaire soit guérie, le pronostic visuel demeure aléatoire.
Analyse
Sur la responsabilité
- Faute de l’établissement
Ce retard tant diagnostique que thérapeutique constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
- Faute du patient
Le centre hospitalier soutient que le comportement du patient, qui s’est rendu aux urgences le lundi 6 novembre 1995 vers 13 heures alors que son médecin traitant l’avait orienté vers celles-ci dès 8 heures, a été fautif et de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité. Toutefois, cette attitude, à la supposer fautive, n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité l’établissement public, qui est engagée à raison des erreurs commises lors de la consultation aux urgences dans la nuit du 5 au 6 novembre, soit avant que le patient ne se rende chez son médecin traitant.
Sur le préjudice
- Principe
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
- Analyse
L’enophtalmie peut conduire, même traitée à temps, à la cécité de l’œil et le pronostic visuel demeure aléatoire. Dans ces conditions, le retard fautif n’a entraîné pour le patient qu’une perte de chance d’échapper à la cécité totale de son œil droit. La réparation qui incombe à l’établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En l’espèce le préjudice indemnisable a été évalué à 30 % du dommage corporel.
A retenir
Lafaute commise par les praticiens du centre hospitalier a compromis les chances d’obtenir une amélioration de l’état de santé. Le préjudice n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu, et la réparation doit être évaluée en proportion de l’ampleur de la chance perdue. Le retard du patient à se rendre au service des urgences, qui serait une faute s’il y avait non-observance de la prescription médicale, n’est pas pris en compte car la faute du service hospitalier était antérieure.
2/ Deuxième décision
Conseil d’État, 14 janvier 2009, n° 297118, non publié
« Considérant que toutefois, dans la mesure où il n’est pas établi avec certitude qu’une compensation globulaire plus précoce aurait empêché la survenue de l’arrêt cardiaque, ces fautes ont seulement privé Mme d’une chance d’éviter le dommage qui s’est réalisé ; que la réparation à la charge du centre hospitalier du Belvédère devra, dès lors, être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue […] ».
Faits
Le 3 mai 1999, une femme a subi une césarienne, au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan.A 9 h 30, au décours de cette intervention, a été constatée une hémorragie, et un traitement médicamenteux a été prescrit et mise en œuvre. A 10 h 30, une infirmière et une sage-femme ont informé le gynécologue-obstétricien, qui l’a lui-même constaté, que l’hémorragie persistait malgré les traitements médicamenteux administrés.A 11h 30 ont été prises les décisions de commander du sang et de faire réaliser une analyse biologique. A 12 h 20, les produits sanguins commandés n’étaient toujours pas parvenus et il a été décidé du transfert de la patiente au CHU de Rouen afin qu’y soit pratiquée une embolisation. Après le transfert et avant que commence cette intervention, la patiente a été victime d’un arrêt cardiaque, lequel a entraîné une anoxie cérébrale. Elle demeure depuis dans un état quasi-végétatif chronique.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- l’indication et la conduite de la césarienne sont exempte de critiques et la survenance de l’hémorragie ne résulte pas d’une maladresse ou d’une négligence ;
- l’hémorragie a été constatée sans retard à 9 h 30 et le traitement médicamenteux mise en œuvre était adapté ; l’état de la patiente ne justifiait alors ni qu’il soit décidé d’adresser des prélèvements sanguins pour analyse au CHU de Rouen, ni de commander des culots globulaires à la banque de sang de cet établissement ;
- à 10 h 30, la persistance de l’hémorragie établissait l’inefficacité du traitement, et la commande des produits sanguins en vue d’une transfusion s’imposait dès lors que les produits ne sont pas disponible sur place ;
- la commande des produits n’a été effectuée qu’à 11 h 30, ce qui établit un retard d’environ une heure ;
- à 12 heures, les produits n’étaient pas arrivés alors que le délai d’acheminement habituel est d’une demi-heure, et il n’a été décidé qu’à 12 h 20 de transférer la patiente au CHU de Rouen ;
- il n’est pas certain qu’une compensation globulaire plus précoce aurait empêché la survenue de l’arrêt cardiaque ;
- l’arrêt cardiaque est une conséquence de la perte sanguine par l’effet de l’hémorragie utérine, insuffisamment compensée par l’administration de culots globulaires et de plasma ;
- l’arrêt cardiaque a été pris en charge dans des conditions exemptes de citriques ;
- l’arrêt cardiaque est à l’origine de séquelles cérébrales.
Procédure
- Tribunal administratif de Rouen, 7 décembre 2004
Le tribunal a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de l’arrêt cardiaque dont Mme Carla a été victime le 3 mai 1999, et l’a condamné à réparer l’entier dommage.
- Cour administrative d’appel de Douai, 4 juillet 2006
La cour a annulé ce jugement, estimant qu’il n’y avait pas eu de faute dans la prise en charge initiale de l’hémorragie, que les retards étaient essentiellement liés aux contraintes de la commande des produits, et que rien n’établissait qu’une commande plus précoce aurait pu éviter la survenance de l’arrêt cardiaque.
Analyse (Conseil d’Etat, 14 janvier 2009)
- Faute
Le Conseil d’Etat relève trois fautes. D’abord, l’équipe médicale devait, compte tenu de l’interdiction légale de disposer au centre hospitalier d’une banque de produits sanguins, faire preuve d’une vigilance particulière sur les risques encourus par la patiente du fait de la persistance de son hémorragie, laquelle ne pouvait que se prolonger. Ensuite, la décision de commander les produits sanguins en vue d’une transfusion a été tardive. Enfin, eu égard à la vigilance particulière qui s’impose face à une hémorragie persistante, les praticiens ont également commis une faute en attendant 12 h 20 pour décider le transfert de la patiente au CHU de Rouen, alors que les produits sanguins commandés, dont le délai d’acheminement normal n’excédait pas une demi-heure, ne lui étaient toujours pas parvenus.
- Préjudice
Dans la mesure où il n’est pas établi avec certitude qu’une compensation globulaire plus précoce aurait empêché la survenue de l’arrêt cardiaque, ces fautes ont seulement privé la patiente d’une chance d’éviter le dommage qui s’est réalisé. Dans ces conditions, la réparation doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
A retenir
La certitude des fautes s’accompagne d’une incertitude quant à la possibilité d’éviter le dommage compte tenu de l’importance de cette hémorragie post-opératoire. Dans cette affaire, un expert a été désigné pour donner des éléments d’appréciation sur la perte de chance.
3/ Troisième décision
Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 306354, mentionné dans les tables
« Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue […] ».
Faits
Une femme, prise en charge au centre hospitalier de Guéret, y a donné naissance par césarienne, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1994, à son second enfant. Celui, du fait des circonstances de la naissance, reste atteint d’une infirmité motrice cérébrale majeure le rendant totalement dépendant.
Le dossier et l’expertise mettent en évidence que :
- le 26 vers 23 heures, à la rupture de la poche des eaux, la sage-femme a constaté une coloration teintée du liquide amniotique ;
- le 27 à 4 h 15, sont apparus des ralentissements du rythme cardiaque fœtal ;
- l’association de ces signes établissait l’existence d’une souffrance fœtale justifiant de prendre immédiatement la décision d’extraire l’enfant ;
- l’obstétricien n’a été appelé par la sage-femme qu’à 5 h 15 et il n’a pris la décision de pratiquer une césarienne qu’à 5 h 30 ;
- en cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l’extraction de l’enfant est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation de séquelles cérébrales ;
- il est impossible d’affirmer que les lésions auraient pour origine les souffrances fœtales subies au cours du travail ou que les séquelles auraient été moins sévères si l’extraction avait été réalisée plus rapidement.
Procédure
Selon la Cour administrative d’appel (18 juillet 2006), confirmant le tribunal administratif de Limoges (6 février 2003), le retard dans la prise de cette décision était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Il est impossible d’affirmer que les lésions ont pour origine les souffrances fœtales subies au cours du travail ou que les séquelles auraient été moins sévères si l’extraction avait été réalisée plus rapidement. Ainsi, l’existence d’un lien de causalité entre l’état de l’enfant et la faute commise ne pouvait être regardée comme établie, et les demandes d’indemnisation ont été rejetées.
Analyse
- Principe
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
- Faute
Il n’est pas certain que le dommage ne serait pas advenu si l’équipe avait réagi à temps. Mais il s’agit de savoir si, au moment où la décision appropriée aurait dû être prise, l’enfant avait une chance d’échapper aux séquelles dont il est atteint, de telle sorte que le retard a fait perdre cette chance.
La couleur teintée du liquide amniotique à la rupture de la poche des eaux ne révélait pas, à elle seule, une souffrance fœtale aiguë imposant l’extraction de l’enfant, mais les autres signes de souffrance apparus à partir de 4 h 15 auraient dû conduire la sage-femme à appeler immédiatement l’obstétricien de garde afin qu’il procède à l’extraction ou, en cas d’impossibilité, qu’il décide de pratiquer une césarienne en urgence. Ce retard d’une heure à appeler l’obstétricien constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, dès lors que dans le cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l’extraction de l’enfant est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation de séquelles cérébrales.
Ainsi, il n’est pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du retard fautif, et il n’est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise, ou que le délai de 35 minutes qui aurait en toute hypothèse séparé cette décision de l’extraction de l’enfant aurait suffi à l’apparition des mêmes lésions. Dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à Anthony une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint.
- Préjudice
Eu égard à l’importante probabilité qu’avait la souffrance installée à 4 h 15 d’évoluer, même prise en charge à temps, vers de telles séquelles, l’ampleur de cette perte de chance a été évaluée à 30 %.
A retenir
La perte de chance n’est pas une éventualité. Il faut apprécier, à travers le dossier, s’il est certain que la faute a causé une perte de chance d’éviter la survenance du préjudice.
Conseil d’État, 30 mars 2011, n° 327669, publié
« Considérant que si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité ;
« que dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue […] ».
Faits
Un patient a subi le 20 novembre 2001, au CHU de Bordeaux, une endartériectomie de la carotide gauche. Dans les heures suivant cette intervention, il a présenté une thrombose de la carotide gauche qui s’est manifestée dès 0 h 30 le lendemain par un accident ischémique transitoire. Une nouvelle opération en vue de remédier à la thrombose n’a été pratiquée qu’à 7 h 30, et il en est résulté de multiples et graves séquelles, dont une incapacité permanente partielle estimée à 80%.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- la thrombose postopératoire dont le patient a été atteint est une complication connue, qui constitue la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention ;
- l’intervention chirurgicale est exempte de critique, qu’il s’agisse de son indication ou sa conduite ;
- le retard dans la prise en charge postopératoire est constitutif d’une faute ;
- la thrombose postopératoire est l’origine d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné pour le patient des conséquences graves ;
- le retard a causé une perte de chance, évaluée à 80 %, d’éviter les conséquences de l’aléa thérapeutique.
Procédure
- Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine qui, 15 septembre 2004 et du 19 avril 2006
La CRCI a estimé que le dommage devait être indemnisé par le CHU de Bordeaux à hauteur de 80 % et par l’ONIAM à hauteur de 20 %. La famille a estimé insuffisantes les offres d’indemnisation définitives et a engagé le contentieux.
- Tribunal administratif de Bordeaux, 27 février 2008
Le tribunal a retenu comme fautif le retard dans la prise en charge post-opératoire et condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser aux requérants une somme correspondant à 80 % de l’évaluation des préjudices. Le tribunal a mis l’ONIAM hors de cause, dès lors qu’une faute avait été reconnue.
- Cour administrative de Bordeaux, 24 février 2009
La Cour a annulé ce jugement en tant qu’il mettait l’ONIAM hors de cause et a mis à la charge de ce dernier les 20 % des préjudices, part du préjudice non lié à la faute.
Analyse
- Principe
L’article L. 1142-1-II du CSP fait obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage,
Dans l’hypothèse où un accident médical, non fautif, est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif.
Ainsi, un tel accident ouvre droit à réparation par l’ONIAM, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance.
- Analyse
Le retard dans la prise en charge postopératoire, constitutif d’une faute, a causé une perte de chance, évaluée à 80 %, d’éviter les conséquences de l’aléa thérapeutique. La thrombose postopératoire dont le patient a été atteint constitue la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention qu’il a subie, à l’origine d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné pour lui des conséquences graves. Ainsi, l’ONIAM doit indemniser la part du dommage subi résultant de l’aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge du CHU, responsable de la perte de chance.
A retenir
Lorsqu’une faute a causé un dommage, celui-ci est pris en charge par l’assureur de l’établissement, et l’ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, ne doit pas en supporter la charge. Par ailleurs, lorsque la faute a causé une perte de chance, l’établissement supporte la part de dommage liée à cette perte de chance. La part restante du dommage, en tant que conséquence d’un aléa médical, est mise à la charge de l’ONIAM.
Règle 23 – L’aléa, risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé, n’engage pas la responsabilité du médecin
1/ Première décision
Cour de cassation, 1° chambre civile, 8 novembre 2000, n° 99-11735, publié
« Attendu que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient […] ».
Faits
Un patient atteint d’une hydrocéphalie a fait l’objet d’une intervention chirurgicale, réalisée par un neurochirurgien exerçant en libéral dans une clinique, consistant à dériver le liquide céphalo-rachidien suivant la technique lombo-péritonéale. Immédiatement après l’intervention, le patient a présenté une paralysie irréversible des membres inférieurs associée à une incontinence urinaire et anale.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- l’intervention était justifiée ;
- elle a été pratiquée par une équipe expérimentée et selon les règles de l’art ;
- l’état du patient résulte d’un infarctus du cône médullaire ;
- il n’y avait pas de facteur de risque particulier ;
- cet infarctus a été spontané mais il était lié au contexte de l’opération.
Procédure
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 décembre 1998, a exclu toute faute commise par le praticien. Elle a néanmoins jugé que le médecin était tenu d’une obligation de sécurité, compte tenu des caractéristiques de la complication qui était sans relation avec l’échec des soins ou les résultats des investigations et sans rapport connu avec l’état antérieur du patient ou avec l’évolution prévisible de cet état. Elle découlait d’un fait détachable de l’acte médical, mais sans l’exécution duquel il ne se serait pas produit. De telle sorte, la cpur d’appel a condamné le médecin à réparer le préjudice résultant de la survenance de cet aléa thérapeutique.
Analyse (Cour de cassation, 8 novembre 2000)
Principe
L’aléa thérapeutique se définit comme étant la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé. En l’absence de faute, la responsabilité du praticien n’est pas engagée.
Analyse
Le dossier permet de retenir la qualification d’un aléa : est survenu un risque, d’origine accidentelle, qui était inhérent à l’acte médical et ne pouvait être maîtrisé. En l’absence de faute, la responsabilité du médecin ne peut être retenue.
A retenir
Les juridictions, sensibles à la situation de patients qui ne pouvaient être indemnisés en l’absence de faute prouvée, avaient admis un régime d’obligation de sécurité. La Cour de cassation a mis fin à ces tentatives par une définition stricte de l’aléa – risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé – en soulignant que l’aléa n’engage pas la responsabilité du médecin. Depuis, a été créé le régime de prise en charge par l’ONIAM pour les accidents médicaux ayant causé un dommage important.
2/ Deuxième décision
Cour de cassation, 1° chambre civile, 18 septembre 2008, n° 07-13080,publié
« Mais attendu qu’ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d’intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d’Achille utilisées par M. Y… étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d’appel a pu en déduire que le dommage survenu s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n’est pas contractuellement responsable ; que le moyen n’est pas fondé […] ».
Faits
Lors d’une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d’Achille à l’aide du tendon du muscle plantaire grêle, une patiente a subi une lésion du nerf tibial postérieur.
Il ressort du dossier et de l’expertise que:
- il s’agissait d’un geste thérapeutique nécessaire et dont la réalisation est exempte de critique ;
- le tendon plantaire grêle sur lequel le praticien était intervenu était situé à au moins cinq centimètres du nerf tibial postérieur lésé au cours de l’intervention ;
- au point de vue médical, et vu la conformité aux bonnes pratiques c’est une qualification d’aléa.
Procédure
Saisi par la patiente, la cour d’appel, par un arrêt du 14 novembre 2006,s’appuyant sur les conclusions des experts, a retenu que traumatisme du nerf n’était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, et a rejeté le recours.
Analyse
Moyens du pourvoi
Selon la patiente, la cour d’appel ne pouvait écarter l’existence d’une maladresse fautive commise par le chirurgien sans rechercher si elle présentait une anomalie ou une fragilité particulière pouvant expliquer la lésion survenue.
Réponse de la Cour
Il ne s’agissait pas d’un acte exploratoire, mais d’un acte thérapeutique nécessaire. De plus, l’organe lésé était à proximité du lieu de l’intervention et la technique utilisée par le chirurgien était conforme aux données acquises de la science. Dans ces conditions, le dommage survenu s’analyse en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n’est pas responsable.
A retenir
La lésion accidentelle est considérée comme un risque inhérent à l’intervention chirurgicale car celle-ci portait sur un organe situé à proximité et les techniques utilisées par le praticien étaient conformes aux données acquises par la science.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 18 septembre 2008, n° 07-12170, publié
« Mais attendu qu’ayant relevé que la coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n’impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et déduit, tant de l’absence de prédispositions du patient, que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d’un geste maladroit de M. Y…, la cour d’appel a pu retenir que celui-ci avait commis une faute […] ».
Faits
Au cours d’une coloscopie pratiquée par un chirurgien, un patient a subi une perforation de l’intestin.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- la perforation a été commise par l’instrument que le chirurgien manipulait ;
- la conformation de l’intestin du patient ne présentait pas d’anomalie ayant rendu l’atteinte inévitable ;
- ce risque de perforation est connu et considéré comme une complication à partir du moment où le praticien est expérimenté et exerce selon les bonnes pratiques, ce qui était le cas.
Procédure
Le patient a engagé un recours en responsabilité civile contre le praticien qui, pour sa défense, invoquait l’existence d’un risque inhérent à la technique utilisée, contestant toute notion de faute. La cour d’appel, par un arrêt du 1er décembre 2006, confirmant le jugement de première instance, a retenu la responsabilité du chirurgien, en établissant la faute par déduction, dès lors que la perforation a été le fait de l’instrument manipulé par le chirurgien alors que la conformation de l’intestin du patient ne renait pas l’atteinte inévitable.
Analyse
Moyens du pourvoi
La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical et la charge de la preuve pèse sur le patient. Aussi, la faute ne peut se déduire du seul préjudice, lequel peut être en relation avec l’acte médical pratiqué sans l’être pour autant avec une faute. Dès lors, la réalisation, lors d’une intervention médicale, d’un risque inhérent à la technique utilisée ne peut être imputée à faute du praticien. Déduire de la survenance du dommage la maladresse du médecin fait peser sur lui une présomption de faute, ce qui est contraire au régime de la faute prouvée.
Réponse de la Cour
La coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n’impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés. Ainsi,la lésion accidentelle n’était pas inhérente à l’acte. A partir de cette donnée de fait, il se déduit tant de l’absence de prédispositions du patient que des modalités de réalisation de la coloscopie que la perforation a été la conséquence d’un geste maladroit du chirurgien.
A retenir
La jurisprudence admet, dans des conditions bien limitées, que la faute soit établie par présomption, lorsque la lésion accidentelle n’est pas inhérente à l’acte. A l’inverse, si la complication est inhérente à la technique utilisée, la présomption ne joue pas. Dans cette affaire, il s’agissait d’un acte à visée exploratoire qui n’impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et le patient ne montrait pas de prédispositions. La perforation n’était donc pas inhérente à l’acte, et la faute est déduite de ces faits.
Règle 25 – Une clinique est tenue d’organiser une permanence médicale
1/Première décision
Cour de cassation, 1° chambre civile, 15 décembre 1999, n° 97-22652, publié
« Mais attendu, d’abord, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état […] ».
Faits
Une femme a accouché le 17 mars 1986 à 23 h 12 à la clinique générale d’Annecy d’un enfant qui n’a eu aucun mouvement respiratoire spontané. Le médecin accoucheur a désobstrué l’enfant et l’a ventilé au masque, mais l’intervention d’un anesthésiste s’est révélée nécessaire pour procéder à une intubation. Ce médecin anesthésiste, qui n’était pas sur place, n’a pu intervenir que 15 minutes après la naissance et il a rétabli les mouvements cardio-respiratoires. Mais la souffrance cérébrale due à l’anoxie a provoqué chez l’enfant une arriération mentale et une infirmité motrice cérébrale, l’incapacité totale et définitive étant de 100 %.
Procédure
Selon la Cour d’appel de Chambéry (4 novembre 1997), la clinique n’avait pas organisé une permanence de médecins anesthésistes réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant la naissance, délai au-delà duquel la souffrance cérébrale consécutive à une anoxie provoque des dommages graves chez le nouveau-né, ce qui est une faute dans son organisation. La circonstance que les médecins aient eux-mêmes des obligations n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de sa responsabilité. Aussi, la responsabilité est partagée.
Analyse
Moyens du pourvoi
La clinique soutient que les médecins des établissements de santé privés sont tenus d’organiser les soins et de les évaluer, et que le lien de causalité entre le défaut d’organisation reproché à la clinique et le préjudice de l’enfant n’est pas caractérisé, ou n’a pu en causer l’intégralité.
Principe
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état.
Décision
La clinique n’avait pas organisé une permanence de médecins, ce qui est une faute dans son organisation, qui engage sa responsabilité entière vis-à-vis des patients. Les médecins ont eux-mêmes des obligations, et leur responsabilité peut être engagée pour faute prouvée. Mais cette responsabilité éventuelle des médecins n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de sa responsabilité. Dans le mesure où le retard du médecin anesthésiste, imputable au défaut d’organisation de la clinique, a entraîné pour l’enfant un manque d’oxygène provoquant la souffrance cérébrale et ses séquelles, la faute de la clinique est en relation avec l’entier préjudice de l’enfant.
A retenir
Dans une approche simple, la clinique répond de l’organisation générale et des fautes commises par les salariés, alors que les médecins libéraux qui y travaillent répondent individuellement de leurs fautes dans la pratique médicale. Mais, compte tenu des obligations souscrites auprès du patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés, ce qui suppose de mettre à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état.
2/ Deuxième décision
Cour de cassation, 1° chambre civile, 13 novembre 2008, n° 07-15049, publié
« Mais attendu, d’abord, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état ;
« que la cour d’appel a constaté que les dispositions du règlement intérieur étaient insuffisamment contraignantes et trop imprécises quant aux horaires, pour que soit garantie aux malades la continuité des soins ; que ce manque de rigueur dans l’organisation a permis à chacun des deux médecins en cause de considérer qu’il appartenait à l’autre d’intervenir et a conduit à une vacance totale de la permanence pendant une heure et demi au moins ; qu’elle a pu en déduire, sans se contredire, que la clinique avait commis dans son organisation une faute qui avait contribué au dommage ; qu’ensuite, la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n’était pas de nature à exonérer l’établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute ; que le moyen n’est pas fondé […] ».
Faits
Une parturiente a été admise dans une clinique où exerce son praticien, gynécologue-obstétricien. Le 3 juin 2002, à 15 h 30, elle a été admise au bloc obstétrical car elle se plaignait de douleurs, et la sage-femme a avisé le médecin de garde, qui était présent au sein de la clinique, et le gynécologue-obstétricien, qui consultait en ville à son propre cabinet. Entre 17 h 10 et 17 h 30, la sage-femme a fait état d’une certaine amélioration de l’état de la parturiente, et le médecin de garde n’est pas intervenu, persuadé qu’il était préférable attendre l’arrivée du gynécologue-obstétricien dont il pensait que la garde débutait à 18 h. Or, le gynécologue-obstétricien estimait lui n’avoir à prendre la relève qu’à 20 h. Il a été rappelé par la sage-femme vers 18 h 30 puis vers 19 h n’est arrivé à la clinique qu’à 19 h 30, heure à laquelle il a procédé, par césarienne, à l’accouchement qui mit au monde, à 19 h 50, un petit garçon. Hélas, l’enfant avait souffert d’une encéphalopathie anoxique périnatale et il est resté atteint de graves séquelles.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- la sage-femme avait fourni à 15 h 30 des éléments inquiétants qui justifiaient un examen par un médecin et les indications faussement rassurantes de 17 h 10 / 17 h 30 ne remettaient pas en cause la nécessité de cette visite, eu égard aux risques liés à cette phase d’accouchement ;
- le diagnostic du décollement rétroplacentaire aurait pu alors être posé ;
- l’intervention souhaitable à 15 h 30 était indispensable à partir de 17h, la situation d’attente que décrivait la sage-femme ne remettant pas en cause la nécessité d’un examen immédiat ;
- les séquelles dont est atteint l’enfant sont exclusivement liées au retard ;
- ces séquelles auraient pu être évitées.
Procédure
Pour la cour d’appel d’Orléans (12 mars 2007), toutes les parties ont commis des fautes. Le gynécologue-obstétricien, en s’abstenant d’assurer lui-même ou de faire assurer par le médecin de garde, la prise en charge urgente que l’état de sa patiente nécessitait, a fait preuve d’une négligence grave et a manqué aux devoirs de sa profession.Le médecin de garde avait la possibilité d’intervenir à temps pour faire le diagnostic du décollement rétroplacentaire et d’intervenir suffisamment tôt pour éviter l’issue dramatique de cette grossesse. La légèreté dont il a fait preuve en pareille situation a participé à la réalisation du dommage. Le manque de rigueur de la clinique dans l’organisation des gardes a autorisé chacun des deux médecins en cause à considérer qu’il appartenait à l’autre d’intervenir et a conduit à une vacance totale de la permanence pendant 1 h 30 au moins.Au vu de ces éléments, le préjudice a été réparti à hauteur de 50 % pour le gynécologue-obstétricien, 30 % pour le médecin de garde et 20 % pour la clinique.
Analyse
Moyens du pourvoi
La clinique a formé un pourvoi et soutient qu’elle avait imposé aux praticiens exerçant à titre libéral dans l’établissement l’obligation d’organiser un système de garde et d’assurer la continuité des soins, satisfaisant ainsi, en l’absence de pouvoir de direction de la clinique sur ces praticiens exerçant à titre libéral, à l’obligation de moyens qu’elle assumait à l’égard des patients. Par ailleurs, les fautes médicales étaient prouvées. D’abord, le gynécologue obstétricien, médecin traitant de la patiente avait été alerté par le personnel soignant, salarié de la clinique, avant 17 h des symptômes que présentait la patiente. Il aurait dû se rendre à la clinique ou s’assurer que le médecin de garde était en mesure de le faire. Ensuite, le médecin de garde, qui était présent à la clinique, avait été informé dès 17 h 10 de ces mêmes symptômes et qu’il s’était également et fautivement abstenu d’intervenir à temps, est lui aussi en faute.
Réponse de la Cour
- Principe
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état.
- Décision
Les dispositions du règlement intérieur étaient insuffisamment contraignantes et trop imprécises quant aux horaires pour que soit garantie aux malades la continuité des soins. Ce manque de rigueur dans l’organisation a permis à chacun des deux médecins en cause de considérer qu’il appartenait à l’autre d’intervenir et a conduit à une vacance totale de la permanence pendant une heure et demi au moins. Aussi, la clinique avait commis dans son organisation une faute qui avait contribué au dommage.
La circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur responsabilité au titre du contrat de soins n’est pas de nature à exonérer l’établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute.
A retenir
La clinique ne manquait pas d’argument pour contester sa responsabilité dès lors que d’une part, le règlement intérieur et les contrats prévoyaient l’obligation des médecins d’organiser la permanence des soins, et que d’autre part, le dossier montrait les fautes des deux médecins bien tenus informés par la sage-femme. Mais le système mis en place était peu rigoureux, et a été la cause d’une absence médicale de 1 h 30, au moment crucial.
Règle 26. – Le médecin salarié ou agent public n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard du patient que s’il agit en dehors de la mission qui lui a été confié par son employeur, ce qui caractérise une faute intentionnelle ou détachable.
1/ Secteur privé
Cour de cassation, 1° chambre civile, 12 juillet 2007, n° 06-12624 06-13790, publié
« Mais attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; qu’ayant relevé que l’acte de radiothérapie pratiqué sur Mme X… par M.Y… au centre de traitement de l’hôpital Saint-Louis accompli sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en exécution de la mission confiée participait bien à ses fonctions salariées au sein de ladite association, et que n’était allégué aucun dépassement des limites de la mission ainsi fixée, la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, quant à l’existence d’une consultation préalable au cabinet privé de M. Y… , laquelle n’était pas de nature à influer sur la solution du litige, en a exactement déduit que seule se trouvait engagée la responsabilité de l’association Croix rouge française ; que le moyen n’est pas fondé […] ».
Faits
Une patiente a, pour les besoins du traitement d’une maladie thyroïdienne, consulté un praticien radiothérapeute dans son cabinet privé. Ce médecin l’a ensuite dirigée vers l’hôpital Saint-Louis à Toulon, appartenant à l’association Croix rouge française, où il exerçait en qualité de salarié pour y pratiquer des actes de radiothérapie, et un traitement par radiothérapie orbitaire a été réalisé par celui-ci les 23 et 27 janvier 1989 au sein de cet établissement. A l’issue de la séance du 27 janvier, le médecin a constaté qu’il y avait eu un surdosage de la dose d’irradiation prescrite. Il en est résulté une double cécité totale, fin 1995, qui a amené la patiente à cesser son activité professionnelle. La patiente a engagé un recours en responsabilité civile contre le médecin et son assureur, Le Sou médical, d’une part, l’association Croix rouge française et son assureur, la société Generali France assurances, d’autre part.
Texte
Code des assurances, art. L. 121-12
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur […].
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Procédure
Tribunal de grande instance de Toulon, 5 juillet 2001
Le tribunal de grande instance a retenu l’existence d’un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice subi, et a condamné le médecin et son assureur, Le Sou Médical, à réparer le dommage.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 décembre 2005
La cour d’appel a déclaré l’association Croix rouge française seule responsable des dommages subis par la patiente du fait du médecin, son salarié et a condamné l’association et son assureur. Elle a ensuite condamné Le Sou médical, assureur de responsabilité de médecin, à garantir la société l’assureur de la Croix rouge de toute la condamnation, du fait de la faute commise par le médecin salarié.
Analyse
Le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. Ceci étant, l’immunité édictée par l’article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes.
Vis-à-vis du patient, seule est engagée la responsabilité de la Croix-Rouge, qui répond des fautes de ses salariés. Dans la mesure où ce médecin est assuré en responsabilité civile, l’assureur de la Croix-Rouge dispose d’une action récursoire contre l’assureur du médecin. Aussi, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est confirmé.
A retenir
Le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. Le patient n’a pas de recours contre le salarié de l’établissement, et c’est l’assureur de l’établissement qui doit la garantie.L’article L. 121-12 alinéa 3 interdit à cet assureur d’exercer un recours contre le salarié.Mais si le salarié a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile, l’assureur de l’employeur peut exercer un recours contre l’assureur du salarié.
2/ Secteur public
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 février 2007, n° 06-82264,publié
« Attendu que l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions […] ».
Faits
Une parturiente en fin de période de grossesse s’est présentée pour accoucher au centre hospitalier de Pontoise le 28 août 1996. Elle a été prise en charge par la sage-femme, qui a constaté l’existence d’un écoulement de liquide clair, appelant une surveillance particulière à ce stade.
Dans la nuit du 28 au 29 août 1996, la sage-femme a noté la nette coloration du liquide amniotique, l’existence d’une fièvre maternelle à 40° et une tachycardie du fœtus à 200. A 2 h 45, elle a appelé le médecin chef de clinique de garde, gynécologue-obstétricien, qui assurait par astreinte à domicile le service de garde de la maternité. Le médecin ne s’est pas déplacé et a prescrit par téléphone l’administration d’un ocytocique puis d’un médicament antalgique et antipyrétique.
L’état clinique a continué à se dégrader très rapidement, et la sage-femme a du rappeler le médecin pour lui dire qu’une césarienne était indispensable et urgente. Le médecin est arrivé à l’hôpital à 4h 15, en vue d’entreprendre l’accouchement par césarienne, mais il était trop tard. L’enfant est né à 4 heures 30, sous la seule prise en charge de la sage-femme, et il est décédé, le lendemain 30 août 1996, des suites d’une septicémie.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- les signes notés par la sage-femme dans la nuit du 28 au 29 août 1996 (nette coloration du liquide amniotique, fièvre maternelle à 40° et tachycardie du fœtus à 200) étaient caractéristiques d’une maladie materno-fœtale grave ;
- le décès de l’enfant pouvait être évité ;
- la sage-femme a eu raison d’appeler, à 2 h 45, du fait de la réunion de ces signes, le gynécologue-obstétricien chargé de la garde et qui était d’astreinte à domicile ;
- il est anormal que le praticien ne se soit pas déplacé en urgence, car il n’y avait aucun doute sur la gravité de la situation ;
- d’une manière générale, il est contraire aux règles de la pratique médicale de faire une prescription sans examiner le patient.
Procédure
Tribunal correctionnel, 13 décembre 2004
Par jugement du 13 décembre 2004, le tribunal correctionnel a sur le plan pénal, condamné le médecin pour homicide involontaire de l’enfant, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis. Sur le plan civil, il a condamné le médecin à verser la moitié du préjudice moral, estimant que le médecin, en refusant de se déplacer en connaissance de cause, avait commis une faute détachable du service.
Cour d’appel de Versailles, 23 février 2006
Le médecin soutient que les fautes dont il a été déclaré coupable avaient été commises dans l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier, et qu’elles engagent la responsabilité du centre hospitalier.
Pour la cour d’appel, le médecin s’était abstenu de se transporter de son domicile au centre hospitalier pour prendre lui-même en main la situation de péril de la mère et de l’enfant, ce en connaissance de cause, car tous les signes cliniques avaient été donnés par la sage-femme à 2 heures 45. Il savait que la survie de l’enfant était compromise, et s’est abstenu en connaissance de cause, commettant un « manquement inexcusable à ses obligations d’ordre professionnel et déontologique ». Cette faute est d’une telle gravité qu’elle ne peut être assimilée à une faute de service et il s’agit bien d’une faute détachable.
Analyse
Le principe
En application de la loi des 16-24 août 1790, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
Décision
Pour la Cour de cassation, quel que soit leur gravité, les fautes commises restent du registre des fautes de service. Le fait que la faute soit d’une exceptionnelle gravité ne suffit pas à la déclarer détachable, cette faute conservant la qualification d’infraction involontaire et étant commise dans le cadre des fonctions confiées.
A retenir
Une faute médicale d’une exceptionnelle gravité, commise dans le cadre de la mission confiée et sanctionnée au pénal comme infraction non-intentionnelle, ne peut être considérée comme détachable des fonctions. Dans un tel cas, et même après une condamnation pénale, la condamnation civile au paiement des dommages et intérêts reste à la charge de l’établissement employeur.
En l’espèce, le médecin avait pris le risque évident d’un décès pour l’enfant, mais on ne peut soutenir qu’il avait agir avec l’intention de causer cette mort. La Cour de cassation soutient ce régime très restrictif de la faute détachable car, en réalité, la condamnation civile personnelle du praticien placerait la victime dans une situation plus difficile, lui faisant perdre l’interlocuteur solvable qu’est l’assureur de l’établissement.
La faute du praticien n’est pas impunie dès lorsqu’il peut y avoir des sanctions personnelles sévère, en matière pénale ou disciplinaire.
Règle 27 – Le médecin répond des fautes commises par le personnel paramédical de la cliniquequand celui-ci l’assiste lors d’un acte.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 13 mars 2001, n° 99-16093, publié
« Mais attendu que s’il est exact qu’en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce, il n’en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; qu’il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli […] ».
Faits
Un praticien gynécologue obstétricien, exerçant en libéral dans une clinique, a, le 15 septembre 1994, procédé à une intervention chirurgicale sur une patiente, dans les locaux de cette clinique et avec l’aide d’une panseuse, salariée de la clinique. Celle-ci était notamment chargée de la manipulation de la table mobile d’opération appartenant à cette clinique. Or, un élément de cette table s’est détaché et a écrasé le pied droit du médecin. Le médecin a recherché la responsabilité de la clinique du fait de la faute de sa salariée.
Procédure
La Cour d’appel de Paris (19 mars 1999), confirmant le jugement, a condamné la clinique, en qualité d’employeur de la panseuse, à réparer le préjudice subi par le médecin du fait des fautes de la panseuse.
Analyse
Moyen du pourvoi
La clinique a formé un pourvoi, soutenant que la panseuse était placée, au cours de l’intervention chirurgicale, sous la seule autorité du praticien.
Réponse de la Cour
En vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les salariées de l’établissement de santé où il exerce. Mais, si le praticien est victime lui-même, il peut rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son encontre par un salarié de cette dernière.
A retenir
Le praticien qui exerce en libéral dans une clinique peut avoir recruté son propre personnel infirmier. Si l’employeur est la clinique, celle-ci assume sa responsabilité pour les fautes commise par les infirmières dans la pratique générale de soins. Mais, lorsque le personnel salarié de la clinique assiste le médecin dans sa pratique des actes, une faute commise par le personnel engage la responsabilité de celui-ci. La seule limite, comme au cas d’espèce, est lorsque la faute du salarié a causé un préjudice au médecin.
Règle 28. – La compétence de l’anesthésiste pour la surveillance post-opératoire ne met pas fin à l’obligation générale de prudence et de diligence du chirurgien.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 30 mai 1986, n° 85-91432, publié
« Attendu, cependant, que si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu, à cet égard, d’une obligation générale de prudence et de diligence ; qu’en s’abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, le docteur Z… n’aurait pas dû s’assurer que le malade restait sous la surveillance d’une personne qualifiée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision […] ».
Faits
Un patient a subi dans une clinique privée une amygdalectomie pratiquée par un chirurgien, assisté d’un médecin anesthésiste. Le chirurgien a quitté la clinique sans délai, laissant un malade conscient, sinon réveillé, dans la salle d’opération et sachant que son confrère anesthésiste allait faire de même quelques minutes plus tard. Or, le patient été victime d’un arrêt cardio-respiratoire dans les temps immédiats qui ont suivi l’intervention, alors que l’infirmière chargée de le surveiller l’avait laissé seul dans sa chambre. Le patient est décédé quelques semaines plus tard.
Procédure (Cour d’appel de Versailles, 4 mars 1985)
Le chirurgien avait cessé d’exercer son pouvoir général de direction du processus opératoire, et l’anesthésiste assurait dès ce moment la responsabilité de surveiller l’opéré dans sa chambre, de le réanimer s’il y avait lieu et, en tout cas, de donner toutes instructions nécessaires à une personne qualifiée pour prévenir tout incident jusqu’au réveil. Le chirurgien n’était même pas tenu, sinon par un souci de convenance envers la famille de l’opéré, de rendre visite à celui-ci dans sa chambre. Il n’avait pas non plus à intervenir auprès de l’anesthésiste pour que celui-ci reste personnellement à son chevet pendant un temps suffisant, cette question relevant de l’anesthésiste et l’appréciation de ces questions lui échappait en tant que chirurgien.
Analyse
Si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu, à cet égard, d’une obligation générale de prudence et de diligence. Or, quand il a quitté la clinique, le chirurgien aurait dû s’assurer que le malade restait sous la surveillance d’une personne qualifiée. Aussi, l’arrêt de la cour d’appel est cassé.
A retenir
Cet arrêt a posé une règle essentielle dans les relations entre le chirurgien et l’anesthésiste. Le chirurgien, après avoir établi les prescriptions nécessités par l’intervention qu’il vient de pratiquer, n’a pas à s’immiscer dans la surveillance post anesthésiste mais il doit s’assurer que les mesures sont prises pour que cette surveillance soit effective. Si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu, y compris sur cette phase, d’une obligation générale de prudence et de diligence.
Conseil d’État, 10 octobre 2011, n° 328500, publié
« Considérant que si le CHU d’Angers soutient que la patiente était porteuse saine du pneumocoque lors de son admission à l’hôpital, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire regarder l’infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu’il ressort de l’expertise que c’est à l’occasion de l’intervention chirurgicale que le germe a pénétré dans les méninges et est devenu pathogène ; que les dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit apportée […] ».
Faits
Le 26 septembre 2001, une jeune femme, âgée de 19 ans, présentant un neurinome de l’acoustique gauche, a été opérée au CHU d’Angers. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, elle a éprouvé des céphalées violentes, des myalgies diffuses, des dorsalgies et des rachialgies. Une ponction lombaire alors pratiquée a révélé une méningite à pneumocoques, dont elle est décédée le 6 octobre.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- l’intervention pratiquée le 26 septembre 2001 au CHU d’Angers était une exérèse du neurinome de l’acoustique gauche en translabyrinthique ;
- l’évolution post-opératoire immédiate avait été satisfaisante ;
- le patient a éprouvé, dans la nuit du 3 au 4 octobre, des céphalées violentes, des myalgies diffuses, des dorsalgies et des rachialgies. Une ponction lombaire alors pratiquée a révélé une méningite à pneumocoques ;
- la cause du décès, intervenu le 6 octobre, est la méningite à pneumocoques ;
- l’infection a été provoquée par l’intervention du 26 septembre et constitue un risque connu de ce type d’interventions ;
- il est très difficile de prévenir un tel type d’infection.
Texte
CSP, art L. 1142-1-I:
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001.
Conseil d’Etat, 10 octobre 2011
Principe
L’article L. 1142-1-I du CSP fait peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit apportée.
Analyse
C’est à l’occasion de l’intervention chirurgicale que le germe a pénétré dans les méninges et est devenu pathogène. La faute n’est pas identifiée, mais joue la présomption de responsabilité, qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause extérieure.
Le centre hospitalier soutient d’abord que la patiente était porteuse saine du pneumocoque lors de son admission à l’hôpital. Mais cette circonstance est juridiquement indifférente dès lors que le germe est devenu pathogène à l’occasion de l’infection. Ensuite, le centre hospitalier fait valoir qu’il était très difficile de prévenir cette infection. Mais pour autant, cette infection, qui constitue un risque connu de ce type d’intervention, ne présente pas le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère. Aussi, le CHU d’Angers est reconnu pleinement responsable.
A retenir
Les établissements de santé supportent une responsabilité sans faute pour toutes les infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit apportée. Ne sont pas considérés comme constituant cette cause étrangère le fait que le germe était présent dans l’organisme avant les soins, ou qu’il était très difficile d’éviter la survenance de l’infection.
Ω Ω Ω
Article 42. – Infection nosocomiale : La gravité des lésions d’un blessé, nécessitant une réanimation respiratoire prolongée et ayant fait survenir une infection pulmonaire, n’est pas une cause étrangère pouvant exempter l’hôpital de sa responsabilité.
Conseil d’État, 17 février 2012, n° 342366, mentionné dans les tables
« Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif retenant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement des dispositions précitées, la cour administrative d’appel, après avoir relevé que les lésions subies par M. C avaient fortement diminué ses défenses immunitaires et provoqué des troubles de la déglutition augmentant les risques d’infection respiratoire, a estimé que la réanimation respiratoire prolongée, nécessitée par l’état de l’intéressé, avait rendu inévitable la survenue d’infections pulmonaires ; que la cour en a déduit qu’à supposer que le décès de M. C ait été provoqué par une infection nosocomiale, l’établissement devait être regardé, compte tenu de l’état initial fortement dégradé de la victime, comme rapportant la preuve d’une cause étrangère au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu’en statuant ainsi, alors que la réanimation respiratoire ne pouvait être regardée comme une circonstance extérieure à l’activité hospitalière, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé […] ».
L’histoire
Le 20 mai 2002, un homme a été admis au centre hospitalier d’Agen dans un état de coma réactif à la suite d’un accident de karting lui ayant causé un traumatisme crânien. L’état clinique laissait apparaître une grave altération de l’état neurologique et un traumatisme thoraco-pulmonaire associant de multiples fractures, une contusion bilatérale des bases pulmonaires et des brûlures du troisième degré de l’hémithorax droit. Le 21 mai, il a été transféré au CHU de Bordeaux où il a été pris en charge au sein du service de réanimation puis, à compter du 24 août, au sein du service de neurochirurgie. Le 12 septembre, il a été transféré dans le service de pneumologie de l’hôpital d’Agen avec un très mauvais pronostic. Le 19 septembre, il est décédé dans cet établissement sur un tableau neurologique et infectieux.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- l’admission était due à un traumatisme crânien grave et l’état clinique laissait apparaître une grave altération de l’état neurologique ;
- le bilan à l’entrée montrait aussi un traumatisme thoraco-pulmonaire associant de multiples fractures, une contusion bilatérale des bases pulmonaires et des brûlures du troisième degré de l’hémithorax droit ;
- le prise en charge assurée le 20 mai 2002, au centre hospitalier d’Agen, puis à compter du 21 mai, au CHU de Bordeaux, service de réanimation puis, à compter du 24 août, au sein du service de neurochirurgie, a été adaptée et conforme aux bonnes pratiques ;
- l’infection du patient par les bactéries staphylocoque doré et serratia marcescens est survenue au cours de son séjour dans le service de réanimation, pendant la longue période avec intubation et ventilation ;
- le décès survenu le 19 septembre résulte des séquelles neurologiques et aussi des complications infectieuses.
Le procès
Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2008
Ce décès était pour partie imputable à une infection nosocomiale contractée au sein du CHU de Bordeaux, a condamné celui-ci, estimant la perte de chance à 20 %.
Cour administrative de Bordeaux, 21 janvier 2010
Les lésions subies par le blessé avaient fortement diminué ses défenses immunitaires et provoqué des troubles de la déglutition augmentant les risques d’infection respiratoire, et par ailleurs, la réanimation respiratoire prolongée, nécessitée par son état, avait rendu inévitable la survenue d’infections pulmonaires. Ainsi, l’état initial fortement dégradé de la victime constitue une cause étrangère au sens du I de l’article L. 1142-1 CSP. Aussi, la cour a annulé le jugement et rejeté la demande d’indemnisation.
Conseil d’Etat
Principe
La réanimation respiratoire ne peut être regardée comme une circonstance extérieure à l’activité hospitalière.
Analyse
L’expertise établit que l’infection du patient est survenue au cours de son séjour dans le service de réanimation. L’infection est ainsi d’origine nosocomiale. Cette infection, qui trouve son origine dans les mesures de réanimation, avec intubation et ventilation, n’est pas causée par un événement présentant un caractère d’extériorité. Aussi, le CHU de Bordeaux n’apporte pas d’éléments établissant l’existence d’une cause étrangère.
Préjudice
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Selon les experts, l’état neurologique et respiratoire était fortement dégradé, mais en l’absence d’infection, le patient aurait eu une importante chance de survie. Dès lors, la perte de chance a été fixée à 50 %.
A retenir
L’infection est apparue à l’occasion de la réanimation, et cette infection ne résulte pas d’une faute. Mais, même si elle était très difficile à prévenir, elle ne peut être considérée comme une cause étrangère.
Ω Ω Ω
Article 43. – La responsabilité de l’établissement est engagée pour toutes les conséquences d’une infection nosocomiale.
Conseil d’État, 28 juillet 2011, n° 320810, mentionné dans les tables
« Considérant qu’en jugeant que le décès de Mme Linette C lors de l’intervention pratiquée le 26 avril 2001 au centre hospitalier de Cahors en vue du remplacement de sa prothèse de la hanche ne pouvait être regardé comme la conséquence directe de l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Gaudens, alors qu’il résultait de ses constatations que cette intervention avait été rendue nécessaire par la présence sur la prothèse d’un foyer d’infection par le staphylocoque doré et alors qu’aucune faute n’avait été relevée ni dans l’indication, ni dans la réalisation du geste chirurgical, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit […] ».
L’histoire
Une femme, âgée de 64 ans, victime le 10 juin 2000 d’un accident de la circulation, a été admise au centre hospitalier de Saint-Gaudens. Le 14 juin, elle a été transférée, à sa demande, dans une clinique privée où les médecins ont diagnostiqué une luxation cervicale avec compression médullaire et une infection par un staphylocoque doré, à l’emplacement d’une perfusion posée au centre hospitalier de Saint-Gaudens. Cette infection a entraîné une septicémie et différentes complications nécessitant une hospitalisation prolongée au CHU de Toulouse-Purpan. En raison de l’apparition d’un foyer infectieux au niveau d’une prothèse de la hanche droite, posée en 1977, la patiente a subi, les 7 mars et 26 avril 2001, deux interventions chirurgicales au centre hospitalier de Cahors, en vue du remplacement de la prothèse. Alors qu’elle était en salle de réveil, elle est décédée d’un arrêt cardiorespiratoire demeuré inexpliqué.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- les médecins du centre hospitalier de Saint-Gaudens n’ont pas décelé la luxation cervicale dont la patiente était atteinte lors de son admission, le 10 juin 2000, car n’ils n’ont pas pratiqué les examens requis par l’état de la patiente ;
- le défaut de diagnostic a rendu plus difficile le traitement de cette affection, entraînant pour la patiente des troubles dans ses conditions d’existence ;
- au cours du séjour, la patiente a contracté une infection par un staphylocoque doré ;
- l’intervention pratiquée le 26 avril 2001 au centre hospitalier de Cahors en vue du remplacement de sa prothèse de la hanche a été rendue nécessaire par la présence sur la prothèse d’un foyer d’infection par le staphylocoque doré ;
- dans cet établissement, aucune faute n’avait été relevée ni dans l’indication, ni dans la réalisation du geste chirurgical.
Le procès
Tribunal administratif de Toulouse, 1° mars 2005
La famille a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Gaudens au titre, d’une part, du défaut de diagnostic de la luxation cervicale et, d’autre part, de l’infection nosocomiale. Le tribunal administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier sur ces deux terrains.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 décembre 2007
La cour administrative d’appel a annulé le jugement, estimant que le défaut de diagnostic de la luxation cervicale ne résultait pas d’une faute médicale et que l’infection nosocomiale ne pouvait être regardée comme la cause directe du décès.
Conseil d’Etat
Principe
Le fait qu’au cours de son séjour dans un centre hospitalier, une patiente ait contracté une infection par un staphylocoque doré révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Analyse
Le remplacement de la prothèse effectué le 26 avril 2001 au centre hospitalier de Cahors a été rendue nécessaire par la présence sur la prothèse de l’infection par le staphylocoque doré et aucune faute n’avait été relevée dans la prise en charge. Aussi, cette intervention doit être regardée comme la conséquence directe de l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Gaudens. La responsabilité de ce centre hospitalier peut être recherchée à raison des préjudices résultant du décès de la patiente à l’issue d’une opération rendue nécessaire par l’infection nosocomiale et dont l’issue fatale n’est pas la conséquence d’une faute des chirurgiens.
A retenir
L’arrêt cardio-respiratoire survenu au centre hospitalier de Cahors est resté inexpliqué, et le dossier ne montre aucune faute. Le but de l’intervention était le remplacement de la prothèse de la hanche, conséquence directe de l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Gaudens, et la responsabilité de cet établissement est retenue comme cause du décès.
Règle 30 – Le régime d’hospitalisation libre peut inclure une surveillance stricte, mais hors l’urgence, pas de mesure de contraintes physiques.
Conseil d’État, 12 mars 2012, n° 342774, mentionné dans les tables
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur lors de l’hospitalisation de Mlle C : Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ; qu’il résulte de ces dispositions que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte, pour juger que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’avait pas commis de faute en n’adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance de Mlle C, la circonstance que l’intéressée, qui avait elle-même demandé son hospitalisation, relevait du régime de l’hospitalisation libre […] ».
Faits
Le2 avril 2006, une patiente âgée de 31 ans, présentant de graves troubles psychiatriques, a été admise en hospitalisation libre dans l’unité psychiatrique du CHU de Clermont-Ferrand. Le 28 du même mois, elle a quitté l’établissement et s’est jetée d’un viaduc. A la suite de cette chute, elle présente une paraplégie complète.
Il résulte du dossier et de l’expertise que :
- la patiente présentait une pathologie psychotique qui a conduit à une prise en charge adaptée à sa pathologie ;
- à la suite de l’aggravation de cet état – agitation et délire – l’équipe médicale a encouragé à la mise en œuvre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, mais l’entourage s’y est opposé ;
- dans ce contexte, ont été arrêtées des mesures renforçant la surveillance ;
- la patiente ne manifestait aucun élément dépressif ou mélancolique, et rien ne laissait présager de quelconques idées suicidaires.
Texte
CSP, L. 3211-2 :
« Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause »
Procédure
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (7 octobre 2008) a estimé le CHU intégralement responsable de la survenue du dommage, au titre du défaut de surveillance.
La Cour administrative d’appel de Lyon (29 juin 2010) a annulé ce jugement et rejeté les demandes, écartant toute faute.
Analyse
Les méthodes coercitives de surveillance sont incompatibles avec le régime de l’hospitalisation libre.
La patiente, qui avait elle-même demandé son hospitalisation, relevait du régime de l’hospitalisation libre. En n’adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance d’emblée, le CHU n’a pas commis de faute. Devant l’aggravation de l’état de santé, et l’absence d’éléments permettant d’apprécier un risque dépressif ou mélancolique, voire suicidaire, le CHU a renforcé la surveillance, telle qu’elle était possible en hospitalisation libre et il n’a pas de commis de faute sur ce plan non plus.
A retenir
La patiente était en régime d’hospitalisation libre au sein du CHU, et son état aurait nécessité des soins dans le cadre plus contraignant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, mais la patiente comme la famille ont refusé. L’équipe médicale a renforcé les mesures de surveillance, mais elle ne pouvait user de mesures de contrainte.
Règle 31 – S’agissant des contaminations Hépatite C, la loi du 4 mars 2012 a institué deux régimes : pour la période antérieure à la loi, un régime de présomption de contamination, liée à un degré de vraisemblance ; pour la période postérieure, un régime d’indemnisation de plein droit, géré par l’ONIAM.
Conseil d’État, 19 octobre 2011, n° 339670, publié
« Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions […] ».
Faits
A la suite d’un grave accident de la circulation survenu le 3 novembre 1986, un enfant âgé de 15 ans a subi plusieurs interventions chirurgicales aux centres hospitaliers d’Auxerre et de Dijon, à l’occasion desquelles des produits sanguins lui ont été administrés. Il a gardé d’importantes séquelles et a appris en 1999 qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- le patient a, à la suite de l’accident, subi plusieurs interventions chirurgicales et séjourné en unité de soins intensifs ;
- il a présenté au printemps 1987 un taux de transaminases cinq fois supérieur à la normale, révélant une infection par le virus de l’hépatite C ;
- l’un des donneurs des produits sanguins transfusés au CHU de Dijon, où l’intéressé avait séjourné au mois de novembre 1986, n’a pas pu être contrôlé.
Texte
Article 102 de la loi du 4 mars 2002
« En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
Procédure
Le patient ayant commis des fautes de conduites, la juridiction judiciaire n’a mis à la charge du conducteur responsable de l’accident que la réparation du tiers des dommages, y compris ceux résultant de la contamination de la victime qu’elle a imputée aux transfusions pratiquées en 1986. Afin d’obtenir un complément d’indemnité au titre de sa contamination, le patient a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité de l’Etablissement français du sang (EFS).
Le Tribunal administratif de Besançon (20 juillet 2006) a estimé établie l’origine transfusionnelle de la contamination et a condamné l’EFS à indemniser.
La Cour administrative d’appel de Nancy (3 décembre 2009) a jugé que le lien de causalité entre la contamination et les transfusions n’était pas établi, et a annulé le jugement.
Analyse
Principe
La présomption est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est le cas lorsque le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits.
Selon la loi, le doute profite au patient. Aussi, la circonstance qu’il ait été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne ferait obstacle à la présomption légale que dans le cas où la probabilité d’une origine transfusionnelle serait manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Décision
Le Conseil d’Etat retient qu’en 1987, un taux de transaminases cinq fois supérieur à la normale révélait une infection par le virus de l’hépatite C, et il note l’absence de contrôle de l’un des donneurs des produits sanguins transfusés au CHU de Dijon, où le patient avait séjourné au mois de novembre 1986. Certes, le patient avait par ailleurs subi plusieurs interventions chirurgicales et séjourné en unité de soins intensifs, mais pour écarter l’hypothèse d’une origine transfusionnelle, il faudrait prouver que l’hypothèse d’une origine nosocomiale était manifestement plus vraisemblable, ce qui n’est pas le cas.
A retenir
La loi du 4 mars 2002 (Art. 102) a institué pour les contaminations par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une présomption d’imputabilité qui est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Le doute profite au patient.
Conseil d’État, 27 janvier 2010, n° 313568, publié
Considérant qu’en cas de contamination du bénéficiaire d’une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui ont prélevé l’organe et procédé à la transplantation n’est susceptible d’être engagée que s’ils ont manqué aux obligations qui leur incombaient afin d’éviter un tel accident […].
L’histoire
Une patiente a bénéficié le 20 octobre 1997 à l’hôpital cardiologique de Lyon d’une transplantation cardiaque. Or, cette patiente a été contaminée par le virus de l’hépatite C dont était porteur le donneur de l’organe prélevé par le CHU de Besançon.
Il résulte du dossier et de l’expertise que :
- préalablement au prélèvement de plusieurs organes, dont le cœur ultérieurement greffé, sur un donneur en état de mort cérébrale, le laboratoire de virologie du CHU de Besançon a pratiqué un bilan biologique d’ensemble, qui a consisté, pour la recherche des marqueurs biologiques de l’infection par le virus de l’hépatite C, en un seul test de dépistage ;
- le résultat d’analyse transmis par le CHU de Besançon aux Hospices Civils de Lyon faisait état d’analyses de biologie médicale négatives pour les maladies infectieuses transmissibles, à l’exception de l’infection par le virus de l’hépatite B pour laquelle les analyses étaient positives ;
- tenant compte de l’urgence vitale de réaliser la greffe, en l’absence d’alternatives thérapeutiques pour la patiente, et de la circonstance que le risque prévisible pour cette dernière pouvait être regardé comme faible du fait d’un taux de transaminases discrètement élevé, les médecins de cet établissement ont procéder à la greffe ;
- les médecins n’ont pas informé la patiente, ni sa famille, du risque de contamination par le virus de l’hépatite B.
Le procès
Il résulte des textes applicables que si aucune contre-indication n’est décelée, la sélection clinique d’un organe est complétée avant tout prélèvement d’éléments par l’exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic d’un ensemble de maladies infectieuses transmissibles, dont le virus de l’hépatite C. Par ailleurs, pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d’un document comportant un compte rendu d’analyses, et le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
Lorsque le résultat fait ressortir un risque de transmission d’infection, la transplantation est interdite. Toutefois, en cas d’urgence vitale appréciée en tenant compte de l’absence d’alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l’état des connaissances scientifiques n’est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l’intérêt du receveur, il est possible de déroger à cette interdiction. La décision ne peut être prise qu’après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n’est pas en état de recevoir cette information, sa famille
Responsabilité des Hospices civils de Lyon
Sur la pratique de la greffe
- Principe
En cas de contamination du bénéficiaire d’une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui ont prélevé l’organe et procédé à la transplantation n’est susceptible d’être engagée que s’ils ont manqué aux obligations qui leur incombaient afin d’éviter un tel accident.Leur responsabilité ne peut donc être engagée sans faute. En effet la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur de produits de santé défectueux ne s’applique pas aux organes prélevés en vue d’une transplantation, ceux-ci ne constituant pas des produits au sens de cette directive.
- Analyse
Eu égard cependant à l’urgence vitale de réaliser la greffe, en l’absence d’alternatives thérapeutiques pour la patiente, et à la circonstance que le risque prévisible pour cette dernière pouvait être regardé comme faible, en l’état des informations dont disposaient les Hospices Civils de Lyon, du fait d’un taux de transaminases discrètement élevé, la décision des médecins de cet établissement de procéder à la greffe n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutive d’une faute. La patiente n’a d’ailleurs pas été contaminée par le virus de l’hépatite B mais par le virus de l’hépatite C pour lequel les résultats transmis étaient négatifs. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité des Hospices civils de Lyon était engagée sans faute en raison des dommages subis par la patiente du fait de sa contamination.
Sur l’information
Les médecins n’ont pas informé la patiente du risque de contamination par le virus de l’hépatite B, contrairement aux textes en vigueur, subordonnant, même en cas d’urgence, la transplantation d’un organe présentant des risques d’infection à une information préalable du receveur potentiel ou, s’il n’est pas en état d’être informé, de sa famille. Ce défaut d’information est constitutif d’une faute. Toutefois, eu égard au caractère impératif et urgent de la transplantation cardiaque, il ne peut être regardé comme établi que, dûment informée, la patiente aurait renoncé à la transplantation. Dès lors, la responsabilité des HCL n’est pas engagée.
Responsabilité du CHU de Besançon
Préalablement au prélèvement de plusieurs organes, dont le cœur ultérieurement greffé par les HCL, sur un donneur en état de mort cérébrale, le laboratoire de virologie du CHU de Besançon a pratiqué un bilan biologique qui a consisté, pour la recherche des marqueurs biologiques de l’infection par le virus de l’hépatite C, en un seul test de dépistage.
Or, compte tenu des anticorps présents dans l’organisme du donneur et de la faible sensibilité du test utilisé, une telle méthode de détection ne présentait pas une fiabilité suffisante, et par ailleurs, aucune situation d’urgence lors du prélèvement n’était de nature à justifier l’absence de recours à une seconde méthode de dépistage permettant de vérifier les résultats de la première. Aussi, est retenue la responsabilité du CHU de Besançon.
A retenir
Un greffon, parce qu’il est directement rattaché à la personne, et même s’il est physiquement séparé de cette personne, ne peut être considéré comme un produit de santé, et le régime de la responsabilité sans faute ne joue pas. La faute a ici été admise pour des résultats pas assez fiable des examens effectués par l’établissement ayant effectué le prélèvement.
Sur un autre plan, l’affaire illustre le pragmatisme de la responsabilité juridique : le fait que le greffe ait sauvé de vie de la patiente n’interdit pas l’engagement d’un recours pour le préjudice causé…
Conseil d’État, 12 mars 2012, n° 327449, publié
Cour de Justice de l’Union Européenne, arrêt n° C-495/10, 21 décembre 2011
« Considérant qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l’application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise […] ».
L’histoire
Un enfant âgé de 13 ans a été victime, au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée le 3 octobre 2000 au CHU de Besançon, de brûlures causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé.Il ne fait pas de doute que l’indemnisation est due. Mais la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux(n° 85/374/CEE, du 25 juillet 1985) établit un principe de responsabilité sans faute, selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Aussi, s’est posée la question de savoir si l’hôpital restait responsable, ou si le patient devait exercer son recours contre le producteur, et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 octobre 2010, a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une interprétation de la directive.
Le procès
Cour de Justice de l’Union Européenne, 21 décembre 2011
La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. Ce texte ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue un régime prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou le prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de la directive.
Conseil d’Etat, 12 mars 2012
Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. En application de la directive du 25 juillet 1985, le centre hospitalier peut ensuite exercer uneaction en garantie à l’encontre du producteur.
A retenir
Les établissements et professionnels de santé sont responsables des dommages causés par les produits et matériels qu’ils utilisent. C’est une hypothèse de responsabilité sans faute : il suffit de démontrer le lien de causalité. Mais dans un deuxième temps, un recours peut être effectué contre producteur.
Responsabilité Pénale
Règle 34 – L’article L. 121-3 du Code pénal, qui fonde la responsabilité pénale du médecin, distingue l’acteur,ayant le rôle essentiel et déterminant, tenu par une faute simple, et le décideur, pour qui doit être prouvé une faute caractérisée.
1/ Première décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2006, n° 05-86700, Publié
« Attendu qu’en cet état, si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que Véronique Y… avait causé directement le dommage, la censure n’est pas pour autant encourue, dès lors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la prévenue, qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal […] ».
Faits
Un praticien spécialiste en endocrinologie, gynécologie médicale et pathologie de la reproduction voyait régulièrement en consultation, depuis octobre 1998, une patiente pour un hirsutisme, une surcharge pondérale et des affections gynécologiques. En décembre 2008, il avait posé un diagnostic d’hyperglycémie.
Le 25 janvier 2000, ce médecin a reçu en urgence la patiente, alors âgée de 21 ans, qui se plaignait d’une soif intense l’obligeant à boire quatre litres d’eau par jour. Les symptômes notés étaient une mycose externe et vaginale importante et une surcharge pondérale. Il a prescrit par ordonnance des examens sanguins de dosage de la glycémie, mais pas de vérification du taux d’acétone dans les urines. Il a toutefois insisté auprès de la patiente pour qu’elle effectue ses analyses dès le lendemain matin, mais n’a pas mentionné l’urgence sur l’ordonnance. Il n’a pas procédé a un contrôle immédiat de la glycémie capillaire, alors qu’un tel appareil de lecture automatique équipant son cabinet. Il a reçu, via son secrétariat, un fax l’informant d’une communication téléphonique émanant d’un médecin qui « voulait lui parler des résultats de la patiente » mais ce fax est resté sans suite. Il n’a pas reçu de nouvelles de la patiente, qui devait lui faire connaitre les résultats du bilan, et elle n’a pas cherché à joindre.
Au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 2000, la patiente est décédée à son domicile, des suites de l’inhalation bronchique de liquides et d’aliments pendant une crise de coma diabétique.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- en présence des symptômes que présentait la patiente dans la matinée du 25 janvier 2000, on pouvait craindre l’évolution de son état dans le sens d’un coma diabétique, propre à devenir mortel s’il ne faisait pas l’objet d’un traitement adapté ;
- ceci rendait urgentes des investigations permettant de mettre en évidence les mesures thérapeutiques nécessaires, à savoir la vérification des paramètres vitaux de la personne et des examens sanguins relatifs au taux de glycémie ;
- le médecin n’a pas procédé à un contrôle immédiat de la glycémie capillaire ou de vérification de la présence de corps cétoniques dans les urines, diligences qui auraient pu donner une première information fiable ;
- l’état de la patiente imposait au médecin de suivre de près la suite qui serait donnée à ses prescriptions ;
- la mort survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2000, est imputable à un coma diabétique ayant provoqué l’absorption de liquides et d’aliments par l’arbre respiratoire.
Procédure
Une instruction judiciaire a été ouverte et le médecin a été poursuivi sous la prévention d’homicide involontaire.Pour la cour d’appel de Rennes (27 octobre 2005), le médecin n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont elle disposait, ce qui constitue les fautes d’imprudence et de négligence caractérisant le délit d’homicide involontaire.
La cour rappelle que le médecin connaissait bien la patiente et son état de santé. Il était possession, le 25 janvier 2000, d’un tableau clinique laissant apparaître un risque sérieux de coma diabétique, et il devait appréhender la situation dans sa totalité. Or, le bilan prescrit était incomplet, et la mention de l’urgence n’était pas signalée. De même, le médecin n’a pas recouru à la pratique immédiate d’un « dextro », alors qu’il disposait du matériel nécessaire. L’urgence de la situation rendait nécessaire un suivi, de telle sorte que le retard dans la communication des résultats devait d’autant plus l’alerter qu’il reconnait avoir insisté auprès de la patiente pour qu’elle effectue ses analyses dès le lendemain matin 26 janvier. En l’absence de manifestation de la patiente elle-même ou de transmission directe des résultats de l’analyse en provenance du laboratoire, le médecin devait s’enquérir des résultats des analyses qu’elle avait prescrites.
De même, dans ce contexte d’urgence, la réception du fax l’informant d’une communication téléphonique émanant d’un médecin qui « voulait lui parler des résultats de la patient » ne devait pas rester sans suite, alors qu’à supposer ce fax peu explicite, il était possible de joindre la patiente.
En s’abstenant de procéder à ces diligences, le praticien s’est privé des moyens de poser le diagnostic exact et complet de l’état de la patiente et de prendre les mesures thérapeutiques nécessaires en un temps où elles auraient été encore efficaces. Ces abstentions sont la cause directe du décès.
Analyse
C’est à tort que la cour d’appel a retenu que le médecin avait causé directement le dommage, alors qu’était en cause le fait de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le dommage, ce qui place dans le registre de la causalité indirecte. Dans ce cadre, le médecin a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, et la culpabilité doit être retenue.
A retenir
La base de la responsabilité pénale du médecin est l’infraction d’homicide involontaire (Code pénal, art. 221-6), ou de blessure involontaire quand la faute a causé un préjudice corporel (Code pénal, art. 222-19). C’est une faute « involontaire » car elle est constituée sans intention de nuire, par le simple fait d’une imprudence, d’une négligence ou d’une inattention. Au regard de la protection due à la personne humaine, cette législation est cohérente mais elle fait planer sur la pratique médicale un vrai risque pénal.
La loi du 10 juillet 2000 (Code pénal, art. 121-3) connue sous le nom de loi Fauchon, du nom du sénateur qui en était le rapporteur, a tempéré ce risque. Pour l’auteur direct, celui dont les décisions sont la cause essentielle et déterminante, le principe reste la faute simple, définie par l’aliéna 3 comme le manquement aux diligences normales. Pour l’auteur indirect, celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, il faut prouver une faute caractérisée, définie par l’alinéa 4.
Le but de cette loi est d’apporter une marge complémentaire aux professionnels qui sont amenés à prendre des décisions, et qui donc contrôlent moins la situation que lorsqu’ils sont eux-mêmes acteurs. Dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé que le médecin était poursuive comme « acteur », sous le régime de la faute simple. La Cour de cassation analyse que le rôle du médecin était de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage, et relevait ainsi de la faute caractérisée exposant le patient à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
2/ Deuxième décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2005, n° 04-85503, non publié
Extrait
« Attendu que, pour déclarer Jean-Dominique X… coupable d’homicide involontaire, de même que Pierre-Yves Y… et Philippe Z…, la cour d’appel, après avoir rappelé la teneur des rapports d’expertise, retient que l’arrêt momentané, en début de matinée, de l’hémorragie, provoqué par un caillot situé sur le site ulcéreux n’aurait pas dû conduire les trois médecins à la décision commune de différer l’intervention, sans demander l’avis du médecin réanimateur et sans tirer les conséquences du dossier de la réanimation de la nuit, dont la lecture révélait que le malade n’avait pas cessé de saigner et qu’était largement dépassé le nombre de culots globulaires devant faire poser une indication opératoire ; que les juges ajoutent que les praticiens, en présence d’un traitement médicamenteux administré en réanimation qui avait épuisé ses ressources thérapeutiques, n’ont pas su profiter d’un répit temporaire pour opérer le patient, non encore décompensé, malgré les saignements prolongés, mais dont l’hypoxie s’accentuait, et qu’ils ont ainsi persisté dans une expectative porteuse d’un danger extrême ; que l’arrêt conclut à l’existence de fautes essentielles et déterminantes qui ont directement causé le décès, dû à l’état d’hypoxémie ayant provoqué l’arrêt cardio-respiratoire à l’origine d’une décérébation irréversible, le processus mortel étant engagé avant même la décision de procéder à l’intervention chirurgicale […] ».
Faits
Un patient âgé de 41 ans, a été admis, le 18 mars 1998, à 17 heures, au centre hospitalier de Vienne en raison d’une hémorragie digestive aiguë. Il a été admis en réanimation mais deux récidives hémorragiques sont survenues le soir vers 20 heures 30 et le lendemain matin, vers 8 heures. Vers 8 heures trente, un gastroentérologue a effectué une fibroscopie gastrique qui révélé un ulcère au niveau du deuxième duodénum, qui ne saignait plus.
Compte tenu des résultats apparemment rassurants de cette endoscopie et de l’état du malade qui, à ce moment n’apparaissait pas inquiétant, le gastroentérologue, un chirurgien spécialiste appelé sur place et le chirurgien de garde ont décidé de ne pas intervenir immédiatement et de poursuivre la réanimation dans l’espoir d’un prolongement du répit.
A 10 h puis à 11 h, le gastroentérologue et le chirurgien spécialiste ont examiné le malade et ont maintenu leur décision de temporiser. Vers 12 h 15, l’état du patient s’est brusquement aggravé. A 13 h 45, le chirurgien spécialiste a décidé d’intervenir. Au moment de l’installation sur la table d’opération, le patient a présenté un arrêt cardio-respiratoire qui a été récupéré après 15 minutes de massage cardiaque. L’intervention a permis d’obtenir, à 14 h 35, l’hémostase définitive de la lésion hémorragique. Le patient n’a jamais repris connaissance et il est décédé le 13 avril 1998.
Il ressort du dossier et des expertises que :
- l’arrêt momentané, en début de matinée, de l’hémorragie, a été provoqué par un caillot situé sur le site ulcéreux ;
- le dossier de la réanimation de la nuit révélait que le malade n’avait pas cessé de saigner et qu’était largement dépassé le nombre de culots globulaires devant faire poser une indication opératoire ;
- devant l’arrêt de l’hémorragie, les trois médecins aurait du consulter le réanimateur de la nuitet devaient quoiqu’il en soit tirer toutes les conséquences du dossier, à savoir que le traitement médicamenteux administré en réanimation avait épuisé ses ressources thérapeutiques ;
- le matin se présentait un répit temporaire permettant d’opérer le patient, non encore décompensé mais dont l’hypoxie s’accentuait, ce qui plaçait dans une expectative porteuse d’un danger extrême ;
- de telle sorte, la décision chirurgicale aurait dû être prise, au plus tard, le 19 mars en début de matinée, au vu des résultats de l’endoscopie ;
- le processus mortel étant engagé avant même la décision de procéder à l’intervention chirurgicale ;
- si l’hémorragie avait été arrêtée plus tôt, le choc cardio-respiratoire aurait pu être évité.
Procédure
Pour la Cour d’appel de Grenoble (18 juin 2004), l’expertise établit l’existence de fautes essentielles et déterminantes qui ont directement causé le décès, dû à l’état d’hypoxémie ayant provoqué l’arrêt cardio-respiratoire à l’origine d’une décérébration irréversible. La faute conjuguée des trois médecins revêt une certaine intensité et une particulière évidence, constitutives d’une faute caractérisée, au sens de l’article 121-3 du Code pénal, tant par la gravité des carences qu’elle révèle que par celle du risque de mort auquel était exposé le patient, risque qu’à raison de leur profession, ils ne pouvaient ignorer.
Analyse
La cour de cassation a entériné l’arrêt de cour d’appel.
A retenir
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, confirmé par la Cour de cassation, est surtout intéressant par la qualification de la « cause directe », au sens de l’article 121-3. La cause est directe lorsqu’elle est l’élément essentiel et déterminant. Devant la gravité des faits, la cour d’appel avait démontré que la faute pouvait être qualifiée de « caractérisée », au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3, ce qui était une formule inadaptée dès lors que l’on situe dans le registre de la causalité directe. La faute simple, définie par l’alinéa 3, suffit.
Règle 35 – En matière pénale, le lien de causalité entre la faute et dommage doit être certain, et le doute profite au médecin poursuivi, qui ne peut être pénalement sanctionné.
1/ Première décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2008, n° 08-80202, publié
« Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt énonce que si, selon les experts, le décès est en rapport avec l’injection de tranxène, il existe une incertitude sur le point de savoir si la complication résulte d’une hypersensibilité de la malade à ce produit ou d’une interaction avec d’autres produits du même type qui lui auraient été précédemment prescrits ; que les juges ajoutent que l’absence d’analyse biologique préopératoire et l’ injection postopératoire de tranxène par la prévenue, en l’absence d’intervention d’ un anesthésiste- réanimateur, ne suffisent pas à établir à la charge du médecin une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès […] ».
Faits
Une femme s’est rendue dans une clinique privée pour y subir une liposuccion pratiquée par un médecin généraliste.Après l’intervention, la patiente a présenté des signes d’angoisse. Le médecin lui a fait administrer vingt milligrammes de tranxène par voie intraveineuse. Peu de temps après l’injection de ce produit, la patiente est tombée dans le coma et n’a pu être réanimée.
Il ressort du dossier et de l’expertise que :
- l’absence d’une expertise biologique préopératoire n’était pas contraire aux bonnes pratiques ;
- l’injection intraveineuse postopératoire de tranxène ne peut, en elle-même, être considérée comme une faute ;
- l’intervention subie par la patiente aurait dû être réalisée avec le recours à un anesthésiste-réanimateur qualifié, car l’attention particulière à la surveillance clinique de la patiente apportée par le médecin s’était avérée insuffisante, les effets secondaires nécessitant une prise en charge par un médecin anesthésiste qualifié ;
- le décès était en rapport avec l’administration d’une injection par voie intraveineuse de vingt milligrammes de tranxène prescrit pour le traitement d’une angoisse survenue quelques heures après la liposuccion ;
- cette complication résultait soit d’une hypersensibilité de la malade à ce type de produits, soit d’une interaction entre le produit administré et le traitement antérieur par anxiolytique pris par le malade ;
- les examens n’avaient pas révélé la présence chez la victime de produits autres que ceux en rapport avec les traitements appliqués au cours de l’acte chirurgical.
Procédure
Pour la Cour d’appel de Basse-Terre (20 novembre 2007), le décès est en rapport avec l’injection de tranxène, mais il existe une incertitude sur le point de savoir si la complication résulte d’une hypersensibilité de la malade à ce produit ou d’une interaction avec d’autres produits du même type qui lui auraient été précédemment prescrits. De plus l’absence d’analyse biologique préopératoire et l’injection postopératoire de tranxène par la prévenue, en l’absence d’intervention d’un anesthésiste- réanimateur, ne suffisent pas à établir à la charge du médecin une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès.L’absence de certitude sur le lien de causalité entre les fautes, possibles, et le décès, interdit de caractériser l’infraction.
Analyse
LaCour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel.
A retenir
Le dossier laisse apparaitre plusieurs fautes et il existe un dommage incontestable le décès, lié à la prise en charge médicale. Mais la cause du décès reste marquée d’un doute, et notamment sur les raisons de la complication. Le lien de causalité doit être certain, et la moindre incertitude impose le jugement de relaxe.
2/ Deuxième décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 mai 2007, n° 06-84034, non publié
« Attendu que, pour relaxer A…, l’arrêt retient notamment que les experts n’ont pas établi qu’un diagnostic exact, à la date où le prévenu est intervenu, aurait permis de sauver la jeune fille ;
« Attendu qu’en l’état de ce seul motif, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d’où il résulte que si la négligence du prévenu a pu priver la victime d’une chance de survie, il n’est pas démontré qu’elle soit une cause certaine du décès, la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l’incompétence du praticien, a justifié sa décision […] ».
Faits
Le 24 octobre 1998, une jeune fille âgée de 15 ans, qui se plaignait de douleurs abdominales, a été reçue en consultation par l’interne du service de gynécologie de l’hôpital de Creil. La mère de l’adolescente a expliqué qu’elle avait elle-même constaté l’apparition au niveau de la vulve de sa fille d’une excroissance dure et violacée de plusieurs centimètres qui s’était rétractée dans la cavité vaginale. L’interne, à l’issue d’un examen visuel et d’un toucher rectal, a conclu à l’absence d’anomalie. Trois mois plus tard, des prélèvements et un examen au scanner, réalisés à l’initiative d’un autre médecin, ont conduit à diagnostiquer une tumeur cancéreuse, dont la jeune fille est décédée le 30 novembre 1999, en dépit des soins qui lui ont été prodigués.
Du dossier et du rapport d’expertise, il ressort que :
- le type de tumeur en cause, situé au niveau de l’utérus, est extrêmement rare ;
- l’interne a entendu les doléances de la patiente, a procédé à un examen visuel, puis à un toucher rectal, conformément aux instructions données par son chef de service ;
- aucune anomalie décelable à l’œil nu n’a été détectée, non plus qu’aucun corps étranger au toucher rectal ;
- l’interne ne disposait pas de moyens d’investigation poussée pour établir le diagnostic ;
- il est impossible d’affirmer qu’en octobre 1998 la tumeur avait une taille décelable ;
- il est impossible d’affirmer qu’on aurait pu établir le diagnostic avec des moyens d’investigation poussée.
Procédure
- Tribunal correctionnel
L’interne a été déclaré coupable d’homicide involontaire. Le tribunal correctionnel a pris en compte les difficultés du diagnostic, mais a estimé qu’un examen aurait pu être plus attentif et que devant la gravité des symptômes décrits par le patient, l’interne aurait dû en référer à des médecins seniors. Ainsi, ce comportement a été fautif, et une prise en charge précoce « augmente les chances de guérison ».
- Cour d’appel d’Amiens, 3 avril 2006
Il résulte de la combinaison des articles 121-3 et 221-6 du code pénal que la loi exige, cumulativement la démonstration de la faute, un résultat dommageable consistant en la mort d’une victime de telle sorte qu’une simple perte de chances ou d’une durée de survie, si la mort résultait inéluctablement d’autres causes que la faute, ne permettrait pas de retenir le délit d’homicide volontaire et une causalité certaine entre ces deux éléments.
L’interne a effectué un examen visuel, puis un toucher rectal après avoir entendu les doléances de la patiente, conformément aux instructions données par son chef de service. Aucune anomalie décelable à l’œil nu n’a été détectée, non plus qu’aucun corps étranger au toucher rectal. Ainsi, il n’est pas démontré que l’interne ait commis une faute caractérisée ayant exposé la jeune fille à un risque d’une particulière gravité.
Le tribunal, en énonçant qu’une prise en charge précoce « augmente les chances de guérison » n’a pas caractérisé de manière certaine la relation du décès avec les fautes imputées à l’interne. En effet si la tumeur n’était pas décelable, elle n’aurait pu être mieux décelée par le recours à un médecin référent sans examen lourd que l’absence d’anomalie n’eût pas fait prescrire. D’ailleurs, les experts n’ont pas établi qu’un diagnostic positif à cette période aurait sauvé la jeune fille. Ainsi, les éléments constitutifs du délit ne sont pas établis.
Analyse
Moyens du pourvoi
L’interne de service non seulement s’est abstenu d’effectuer des examens cliniques complets et approfondis, mais encore n’a pas fait appel au médecin de garde et au chef de service pour leur faire part des symptômes extrêmement alarmants décrits par la jeune fille, qui l’avait amenée à consulter. La prise en compte de ces informations aurait provoqué sinon un diagnostic précoce du moins des investigations complémentaires de la part de médecins spécialistes. La cour d’appel a exigé une « causalité directe » entre la faute qualifiée et le dommage puis « une relation du décès en lui-même avec la faute ». Or, il suffisait que les agissements de l’interne aient seulement permis la réalisation du dommage, en privant la victime d’un traitement curatif, pour caractériser le lien de causalité entre la faute commise par l’interne et le dommage.
Réponse de la Cour
Les experts n’ont pas établi qu’un diagnostic exact, à la date où l’interne est intervenu, aurait permis de sauver la jeune fille. Ainsi, si la négligence de l’interne a pu priver la victime d’une chance de survie, il n’est pas démontré qu’elle soit une cause certaine du décès, la cour d’appel a justifié sa décision.
A retenir
La pratique professionnelle s’intéresse naturellement au débat sur la faute. Mais pour que la responsabilité pénale soit engagée, doit être établie la certitude d’un lien de causalité entre le dommage et nombre de procédures pénales buttent sur ce point. Dans cette affaire, et avant même d’ouvrir le débat sur la faute, il fallait examiner le lien de causalité.
La victime peut reprendre la procédure sur le terrain civil, lequel admet la responsabilité en cas de perte de chance. La procédure visera le fonctionnement du service hospitalier, et non plus seulement les comportements individuels. Le fait qu’avec ses signes graves, et surtout inexpliqués, la jeune fille ait quitté l’hôpital sans préconisation particulière, sous les seules constations cliniques de l’interne, mériterait un examen attentif. Dans le même temps, il faut noter que la cour d’appel avait été très affirmative pour écarter la faute de l’interne.
Si les faits dépendaient de l’application de la loi du 4 mars 2002, la prise en charge par l’ONIAM ne serait pas acquise. En effet, dans cette affaire il s’agit davantage de l’évolution d’une maladie que d’un accident médical.
Règle 36 – La perte de chances laisse un doute sur la causalitéqui empêche la condamnation pénale, mais peut engager la responsabilité civile.
1/ Première décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2007, n° 06-86331, publié
Attendu que, pour déclarer Eric X… responsable des conséquences dommageables du décès de Michèle Z…, l’arrêt, se fondant sur les conclusions des experts, énonce que le chirurgien a commis une imprudence en choisissant d’appliquer à cette patiente obèse, avant la réalisation de l’objectif de réduction de sa surcharge pondérale au moyen d’un régime diététique initialement fixé par l’endocrinologue auquel il l’avait adressée, un traitement chirurgical qui ne pouvait être envisagé que comme un ultime recours ; qu’en outre, les juges retiennent que le chirurgien n’a pas appelé l’attention des anesthésistes sur le risque particulier de complication thromboembolique encouru par la patiente et ne rapporte pas la preuve de la délivrance à celle-ci de l’information qu’il lui devait sur le traitement proposé et les risques prévisibles qu’il comportait ; qu’ils ajoutent que les fautes ainsi relevées ont contribué de façon directe à la production du dommage et justifient la condamnation du chirurgien à la réparation du préjudice des ayants droit de la victime […].
Faits
Une femme a été admise le 12 janvier 2010, à l’âge de 56 ans, à la clinique Lambert de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) où elle a été opérée par un praticien spécialisé en chirurgie plastique et réparatrice, sous anesthésie péridurale, d’une lipectomie abdominale quasi-circulaire et d’une diastasis des grands droits tendant à reséquer un excédent cutané et graisseux et à retendre la paroi abdominale. Elle est décédée le 13 janvier 2000, des suites d’une embolie pulmonaire.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- dans le but de cette réduction de sa surcharge pondérale, un endocrinologue avait proposé un régime diététique ;
- l’intervention chirurgicale était imprudente et son choix technique très discutable ;
- l’absence de prévention d’une maladie thrombo-embolique est regrettable car le risque existait, compte tenu des facteurs de morbidité ;
- selon les bonnes pratiques, la chirurgie ne pouvait être envisagée que si toutes les autres options avaient échoué, en quelque sorte comme un ultime recours, ce qui n’était pas le cas ;
- on ne trouve aucune information sur les risques, et ce manque d’information a affecté la phase anesthésique, alors que cette opération envisagée était chargée de risques pour la patiente ;
- le chirurgien, qui a manifestement empiété sur le domaine de compétence des anesthésistes, avait bien connaissance du risque que comportait une intervention du point de vue thrombo-embolique, et il n’a effectué aucune mise en garde vis à vis des anesthésistes sur la situation particulière de la patiente à traiter.
Procédure
Selon la Cour d’appel de Versailles (29 juin 2006), le chirurgien a commis une imprudence en choisissant d’appliquer à cette patiente obèse, avant la réalisation de l’objectif de réduction de sa surcharge pondérale au moyen d’un régime diététique initialement fixé par l’endocrinologue auquel il l’avait adressée, un traitement chirurgical qui ne pouvait être envisagé que comme un ultime recours. De plus, le chirurgien n’a pas appelé l’attention des anesthésistes sur le risque particulier de complication thromboembolique encouru par la patiente et ne rapporte pas la preuve de la délivrance à celle-ci de l’information qu’il lui devait sur le traitement proposé et les risques prévisibles qu’il comportait. On relève ainsi des fautes, qui sans revêtir la qualification pénale, ont causé une perte de chance de survie. Aussi, la culpabilité pénale est écartée et la responsabilité civile est retenue.
Analyse
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.
A retenir
Cette affaire est une illustration de la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale ne peut pas être retenue pour deux raisons : l’incertitude sur le lien de causalité et l’insuffisante gravité de la faute.
D’abord, le lien de causalité entre la faute et le préjudice est qualifié de perte de chance, alors que pour prononcer une condamnation pénale, il faudrait une certitude. Il faudrait prouver que la faute a fait perdre toute chance d’éviter le préjudice.
Ensuite, vient la question de la gravité de la faute, que l’on trouve dans cette formule de la cour d’appel : « sans revêtir une qualification pénale, des fautes… ». Ce point situe dans l’analyse juridique fine, mais il faut la connaître. La référence pour la faute médicale est celle de l’arrêt Mercier : des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquis de la science. L’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal se situe dans cette apporche, avec les fautes pour imprudence, négligence ou inattention, mais il est demandé au juge un degré complémentaire de qualification, ne pouvant prononcer une condamnation que si l’auteur « n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
Ainsi, il reste une différence de degré entre la faute civile et la faute pénale, dans une appréciation qui dépend beaucoup du juge. Dans cette affaire, la cour a ainsi estimé qu’il y avait une faute civile, mais pas de faute pénale.
2/ Deuxième décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 novembre 2010, n° 09-87375, publié
Sur le plan pénal
« Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l’arrêt, après avoir énoncé que, selon les experts, Mme X… a développé une complication, appelée Hellp syndrome, à l’évolution parfois brutale, voire foudroyante, dont la prise en charge aussi précoce que possible en milieu spécialisé ne permet pas toujours d’éviter l’évolution fatale, retient qu’il n’est pas établi avec certitude que les agissements de MM. Y… et Z… ont fait perdre toute chance de survie à Mme X… ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et d’où il résulte qu’il n’existe pas de relation certaine de causalité entre les agissements reprochés et le décès, la cour d’appel a justifié sa décision […].
Sur le plan civil
« Attendu que les juges retiennent que le retard de diagnostic ne peut être considéré comme la cause directe et certaine du décès et qu’il n’existe aucune certitude quant à l’existence d’une chance de survie ;
« Mais attendu qu’en prononçant ainsi après avoir relevé que, compte-tenu du pronostic toujours incertain du Hellp syndrome, les retards à la prise en charge ont probablement fait perdre à la patiente une chance de survie, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, dès lors que la disparition de la probabilité d’un événement favorable constitue une perte de chance […] ».
Faits
Une patiente dont le terme de la grossesse était fixé au 27 novembre 1998, avait été admise, le 14 novembre 1998, à 13 h 15 dans une clinique, de niveau I, équipée uniquement pour la prise en charge des grossesses à bas risque. Lors de son admission, elle a présenté un syndrome pré-éclamptique brutal, et le médecin gynécologue a décidé d’une césarienne, pratiquée, en urgence, à 14 h 15. Le médecin anesthésiste a mis en place une surveillance infirmière renforcée.
A 19 h, il a été appelé par l’infirmière pour une tachycardie, et s’est déplacé à 19 h 30. Il a de même été appelé à 22 h 30, 23 h et 1 h pour une baisse puis un arrêt de diurèse, et il s’est déplacé à 1 h 45. Au vu du résultat du bilan biologique qu’il a fait pratiquer à 3 h 30, il a organisé le transfert de la malade dans un service de réanimation de l’hôpital Bicêtre, où la patiente est arrivée le 15 novembre à 4 h 40.
La réanimation s’est avérée impuissante, et le décès est intervenu le 18 novembre.
Le dossier a été examiné par trois expertises.
Première expertise
- La patiente a développé une complication, soit un Hellp syndrome, dont l’évolution est parfois brutale, voire foudroyante, et une prise en charge aussi précoce que possible en milieu spécialisé ne suffit pas toujours à éviter une évolution fatale ;
- le transfert aurait dû intervenir dès le début de la surveillance postopératoire, lorsqu’est survenu l’équivalent d’une crise d’éclampsie, caractérisée par les tremblements et la cyanose des extrémités ;
- les agissements des médecins, soit un retard de diagnostic et un défaut de surveillance postopératoire, ont fait perdre une chance de prise en charge plus précoce d’une pathologie grave ;
- une réanimation intervenue quelques heures plus tôt aurait permis, de façon indubitable ou au moins très probable, d’assurer la survie.
Deuxième expertise
- Rien ne démontrait scientifiquement l’hypothèse selon laquelle une reconnaissance précoce de ce syndrome permettrait d’éviter à tout coup une issue fatale, et pas même une réduction de la mortalité ;
- les comptes-rendus du service de réanimation de l’hôpital Béclère établissent le caractère foudroyant et surtout quasi-simultané de tous les effets, nerveux, hépatiques et cardiaques, du Hellp syndrome ;
- le seul traitement efficace est l’accouchement par césarienne ;
- le Hellp syndrome des suites de couche échappe aux thérapeutiques devenues impuissantes pour ne laisser place qu’aux mesures de réanimation classiques, à cause de son évolution propre, souvent aléatoire et mal maîtrisable ;
- si le retard au diagnostic a probablement constitué une perte de chance, il est bien difficile de le certifier et d’évaluer l’importance exacte de cette perte de chance, compte tenu du pronostic toujours incertain des Hellp syndromes des suites de couches.
Troisième expertise
- Il existe une perte de chance mal évaluable d’éviter le décès ;
- en l’état des données de la science, à l’époque des faits, le retard au diagnostic de Hellp syndrome ne peut pas être considéré comme la cause certaine, ni directe du décès.
Procédure
Tribunal correctionnel de Versailles
Les deux médecins ont commis des fautes caractérisées au cours du suivi opératoire et ils auraient dû décider plus tôt du transfert. Ces fautes ont fait perdre à la patiente toute chance de survie. Sur le plan pénal, les deux médecins ont été déclarés coupables, et sur le plan civil, l’indemnisation totale est mise à la charge de leurs assureurs.
Cour d’appel de Versailles, 15 septembre 2009
Il n’existe aucune certitude quant à l’existence même d’une chance de survie de la patiente. L’évolution propre du Hellp syndrome échappe à toute thérapeutique et ne laisse place qu’aux palliatifs de la réanimation, qui elle-même était compromise, au vu des comptes-rendus de l’hôpital Béclère. Le lien de causalité entre la mort et les « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » doit être certain, et la mort s’entend par la perte de toute chance de survie. Or, la certitude d’une issue mortelle, soit la perte de toute chance de survie, causée à la patiente par les agissements de deux médecins n’est pas rapportée.
Sur le plan pénal
Le jugement du tribunal correctionnel de Versailles est infirmé et les deux prévenus sont relaxés des fins de la poursuite.
Sur le plan civil
L’existence d’une perte de chance de survie, que les agissements ou abstentions des deux médecins auraient entraînée, n’est pas établie. Le lien de causalité entre l’action ou l’inaction des médecins et le décès n’est pas établi non plus. Les experts n’apportent aucune démonstration sur les conséquences d’une prise en charge plus précoce de quelques heures, sur les effets du Hellp syndrome. Il n’existe aucune certitude quant à l’existence d’une chance de survie, et la responsabilité civile est écartée. Le recours civil est également rejeté.
Analyse
Sur le plan pénal
Il n’existe pas de relation certaine de causalité entre les agissements reprochés et le décès, et la relaxe est confirmée.
Sur le plan civil
La disparition de la probabilité d’un événement favorable constitue une perte de chance. Compte-tenu du pronostic toujours incertain du Hellp syndrome, les retards à la prise en charge ont probablement fait perdre à la patiente une chance de survie. La responsabilité civile doit être retenue, dans la proportion – faible – de cette perte de chance.
A retenir
Cet arrêt rappelle la seule définition de la perte de chance, à savoir la disparition de la probabilité d’un événement favorable. Dans cette affaire, il n’y a eu qu’une perte de chance, ce qui interdisait une condamnation pénale, mais permettait de retenir la responsabilité civile, dans la proportion de cette perte de chance.
Règle 37– L’interne exerçant par délégation et sous la responsabilité du praticien senior, il n’engage pas sa responsabilité pénale pour des décisions qui auraient dû être prises par le senior, et le senior, qui n’assure pas un contrôle des actes de l’interne, engage sa responsabilité pénale.
1/ Première décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mai 2006, n° 05-82591, publié
« Attendu que, pour condamner l’interne l’arrêt retient que, s’étant rendu, dès 19 heures 30, avec le chirurgien senior au chevet du patient, après l’alerte donnée par le médecin anesthésiste, et ayant constaté l’hémorragie, il avait eu conscience de la nécessité de pratiquer immédiatement une intervention chirurgicale destinée à résorber l’hématome ; que les juges en concluent que l’inaction du prévenu, pendant plusieurs heures, alors qu’il ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait le patient, était constitutive d’une faute caractérisée à l’origine de la mort de la victime ;
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la décision de reprise chirurgicale appartenait au médecin senior en sa qualité de chef de service, et non pas à lui-même, qui exerçait ses fonctions en qualité d’interne, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relevait, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision […] ».
Faits
Un patient, âgé de 45 ans, a été opéré au centre hospitalier de Mamao le 12 janvier entre 8 h et 18 h 45 d’une thyroïdectomie par le chirurgien senior, assisté d’un interne. Il a ensuite été placé en salle de réveil sous la surveillance du médecin anesthésiste.
Peu après son réveil, vers 19 h 20, le malade a fait une importante hémorragie (500 cc). Le médecin anesthésiste a aussitôt prévenu, et à plusieurs reprises, le chirurgien et l’interne, qui n’ont pas pris de décision. A 2 h 30, sont survenus des troubles respiratoires et cardiaques graves. La ré-intervention a été alors décidée, pour être pratiqué entre 4 h et 6 h 45.
Le patient est décédé à la suite d’une complication hémorragique cervicale avec hématome compressif le 17 janvier 1998, le compte-rendu hospitalier faisant mention d’un état de mort cérébrale dès le 14 janvier.
Du dossier et de l’expertise, il ressort que :
- le patient a été opéré de cette thyroïdectomie le 13 janvier 1998 ;
- le risque de complication hémorragique de cette intervention et en particulier le risque grave d’hématome compressif de la trachée malgré la présence de drains redons fonctionnels sont connus ;
- la complication hémorragique apparu en salle de réveil vers 19 heures nécessitait un drainage chirurgical d’urgence ;
- le retard apporté à par l’équipe chirurgicale ORL de garde, à voir l’interne et le chirurgien senior, qui avait été immédiatement alertée et qui est restée sans réaction malgré les informations sur l’évolution très défavorable, a favorisé l’arrêt cardiaque anoxique.
Texte
CSP, Art. R. 6153-3
L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
L’interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l’étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu’à l’élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
Procédure
Poursuivis du chef d’homicide involontaire, l’interne et le chirurgien ont été relaxés par le tribunal correctionnel. Le ministère public et des parties civiles ont interjeté appel, et la cour d’appel de Papeete (24 mars 2005), les a déclarés tous les deux coupables.
Le chirurgien
La ré-intervention en urgence s’imposait dès 19 h 30, et le chirurgien, qui ne pouvait ignorer le danger pour le patient, a commis une faute caractérisée.
L’interne
Lors de son interrogatoire, l’interne avait déclaré : « Compte tenu que le redon avait donné 500 cc de sang, j’ai fait comprendre au chirurgien senior que de mon point de vue, il fallait reprendre ce malade, c’est-à-dire le réopérer ; je lui ai demandé ce que l’on faisait compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une décision difficile à prendre et c’est là qu’il m’a indiqué qu’il faillait surveiller le malade ».
Pour condamner l’interne, la cour d’appel retient que l’interne s’était rendu, dès 19 heures 30, avec le chirurgien au chevet du patient, après l’alerte donnée par le médecin anesthésiste, et qu’ayant constaté l’hémorragie, il avait eu conscience de la nécessité de pratiquer immédiatement une intervention chirurgicale destinée à résorber l’hématome. Ainsi, son inaction, pendant plusieurs heures, alors qu’il ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait le patient, était constitutive d’une faute caractérisée à l’origine de la mort de la victime.
Analyse
La décision de reprise chirurgicale appartenait au chirurgien, en sa qualité de chef de service, et non pas à l’interne, qui exerce par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, et l’interne est relaxé.
A retenir
L’interne exerce par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cela ne fait pas disparaitre sa responsabilité pénale, qui est d’application générale, notamment pour les faits et gestes qui ne relèvent que de lui. Mais ici était en cause un retard à rependre une décision, question débattue entre le chirurgien et l’interne, et cette décision revenait au senior.
2/ Deuxième décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, n° 08-80679, publié
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le praticien, auquel il incombait de contrôler l’acte pratiqué par l’interne, n’avait pas commis une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision […] ».
Faits
Une patiente a été admise le 1er novembre 1997, à l’hôpital de Pontoise, pour une cœlioscopie, en vue de rechercher l’origine de douleurs pelviennes. La cœlioscopie a été pratiquée par un praticien gynécologue de l’hôpital, assisté d’une interne. Or, l’incision sous-ombilicale effectuée par l’interne dès le début de l’intervention a causé une plaie chirurgicale de l’aorte. L’hémorragie qui s’en est suivi a causé la mort immédiate de la patiente.
Du dossier et l’expertise ressortent les points suivants :
- l’incision cutanée pratiquée par l’interne sous le contrôle du praticien, premier geste de la cœlioscopie, a été responsable d’une plaie de l’aorte ;
- l’aorte étant directement sous la peau, l’excès de pénétration de la pointe de la lame a pu facilement passer inaperçu ;
- cette complication exceptionnelle n’apparaissait pas dans la littérature consacrée aux complications et accident de cœlioscopie ;
- le médecin a été alerté par le saignement inhabituel et par le signalement par une infirmière d’une chute brutale de CO2, relayée par l’anesthésiste, mais ce saignement inhabituel a été attribué à la blessure d’un vaisseau pariétal ;
- le médecin avait la conviction que l’accident ne pouvait être d’origine chirurgicale ;
- il n’a diagnostiqué l’hémorragie interne par plaie vasculaire qu’après la reconnaissance de l’accident au bout de 25 minutes ;
- la mort de la patiente est due à une hémorragie secondaire à une plaie chirurgicale de l’aorte ;
- il n’est pas possible d’affirmer qu’une reconnaissance plus précoce aurait permis de sauver la patiente qui a été immédiatement dans un état catastrophique ;
- le retard du traitement lié à la découverte tardive de l’origine de l’accident constitue une perte de chance de survie.
Procédure
Tribunal correctionnel
L’interne et le médecin ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, l’interne pour avoir directement causé la mort de la patiente et le médecin pour l’avoir indirectement causée en commettant une faute caractérisée. Le tribunal a relaxé l’interne et déclaré le médecin seul coupable.
Cour d’appel de Versailles, 5 décembre 2007
Le praticien, qui avait fait sa thèse sur les cœlioscopies, avait depuis acquis une expérience de ces interventions. Il est exact qu’alerté par le saignement inhabituel et par le signalement de l’infirmière, il n’a pas réalisé immédiatement qu’il était en présence d’une hémorragie interne due à l’acte chirurgical pratiqué par son interne, sous son contrôle. Ainsi, il a tardé dans son diagnostic.
Toutefois, il n’est pas établi que le praticien, bien que connaissant sa patiente, aurait dû penser que compte tenu de sa morphologie, l’aiguille ait pu atteindre l’aorte immédiatement sous la peau de l’abdomen, cette complication exceptionnelle n’apparaissait d’ailleurs pas dans la littérature consacrée aux complications et accident. En outre, il a pu être rassuré par la mise en place d’un point transfixiant au saignement qui a masqué l’hémorragie. Dès lors, le retard de diagnostic pouvant lui être reproché s’explique et ne peut être considéré comme fautif au regard des données de la connaissance médicale. Ainsi, il n’est pas établi une faute pénale caractérisée.
Analyse
La cour d’appel n’a examiné que les conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic, et la Cour de cassation ne remet pas en cause la notion d’erreur non fautive. En revanche, la cour d’appel devait analyser les conditions dans lesquelles le praticien a contrôlé l’acte pratiqué par l’interne. Un contrôle négligent est une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente, pouvant en fonction des circonstances de l’espèce, engager la culpabilité du senior.
A retenir
Le geste technique de l’interne, qui a été fatal, n’est pas dans le contexte de cette situation rare considéré comme une faute de l’interne. L’erreur de diagnostic du praticien senior n’a pas non plus été reconnue fautive, et sa responsabilité est écarté pour son rôle direct. Mais l’affaire devait aussi être examinée sous l’angle de la causalité indirecte, car il incombe au praticien senior de contrôler les actes pratiqués par l’interne. Aussi, la responsabilité du senior est engagée si, ayant conscience du danger, il a commis une faute caractérisée entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente. Dans le cas d’espèce, cela parait peu probable, mais l’intérêt de l’arrêt de distinguer les deux types de fautes pouvant être reprochées à un senior lorsqu’il intervient en lien avec un interne.
Secret professionnel
1/ Première décision (Arrêt Watelet)
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 décembre 1885
« Attendu que l’article 378 du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs.
« Attendu que cette disposition est générale et absolue et qu’elle punit toute révélation du secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir, à la charge du révélateur, l’intention de nuire ; que c’est là ce qui résulte, tant des termes de la prohibition que de l’esprit dans lequel elle a été conçue.
« Attendu qu’en imposant à certaines professions, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur en entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire ; que ce but de sécurité ou de protection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies ; que ce délit existe dès lors que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire […] ».
Faits
Le Docteur Watelet fut à partir de 1883 le médecin du peintre orientaliste Jules Bastien-Lepage. Ce dernier était atteint d’une tumeur des testicules, justifiant une prise en charge chirurgicale par le Docteur Watelet. Or, le peintre est décédé, d’une mort rapide, en 1884, alors qu’il était en Algérie au cours d’un voyage que son médecin lui avait autorisé. La rumeur s’est alors installée, amplifié par une campagne de presse, laissant entendre que le peintre était en réalité atteint d’une maladie vénérienne, que la prise en charge médicale avait été défectueuse et que le Docteur Watelet avait envoyé son malade loin de la métropole en cherchant à s’exonérer de toute responsabilité.
Ainsi attaqué, le Docteur Watelet avait riposté dans un article paru dans le journal Le Matin du 13 décembre 1884 pour rétablir les faits : le peintre était atteint d’un cancer des testicules et, sachant l’atteinte irréversible, le médecin avait approuvé ce voyage en Algérie pour convalescence.
Procédure
La famille Bastien-Lepage n’avait pas réagi publiquement à cette polémique. C’est le ministère public, de sa propre initiative, qui a engagé des poursuites pénales contre le Docteur Watelet pour violation du secret professionnel. Le médecin fut condamné par le tribunal correctionnel de la Seine et cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel de Paris.
Analyse
- Moyens du pourvoi
Le Docteur Watelet soutenait plusieurs séries d’arguments. D’abord, les faits avaient déjà été débattus et rendus publics par la presse. Il n’avait donc rien appris, ni dévoilé. Ensuite, il n’avait pas révélé une confidence faite pas son patient mais il avait simplement indiqué le diagnostic dont souffrait le patient, diagnostic qu’il avait lui-même découvert. Enfin, il avait agi sans intention de nuire, et d’ailleurs la famille n’avait pas entendu déposer plainte ou se constituer partie civile.
- Réponse de la Cour
La répression pénale du secret est générale et absolue : elle punit toute révélation du secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir, à la charge du révélateur, l’intention de nuire. C’est ce qui résulte des termes de la prohibition et de l’esprit dans lequel elle a été conçue.
En imposant à certaines professions, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur en entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire.
Ce but de sécurité ou de protection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies. Ainsi, ce délit existe dès lors que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire.
A retenir
La formule reste la référence : la protection du secret est générale et absolue, et il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de nuire. Le but de la loi est d’assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice médical. Elle répond à un raisonnement séculaire : pas de soin sans confidence, pas de confidences sans confiance, pas de confiance sans secret.
2/ Deuxième décision (Arrêt Gubler)
Cour européenne des Droits de l’homme, 18 mai 2004, n° 58148/00
Faits
Le Docteur Gubler, médecin personnel du président Mitterrand pendant les deux septennats et qui avait été évincé dans la dernière période, avait en préparation un ouvrage expliquant que le diagnostic du cancer avait été posé quelques mois après la première élection de 1981, et qu’il avait organisé une prise en charge secrète, en masquant cette réalité par la publication de bulletins de santé mensongers.
Du fait du décès du président, le 8 janvier 1996, la publication du livre avait été mise en attente. Mais dans les 48 heures du décès, de premières informations sont parues dans la presse, faisant état d’un cancer, qui n’aurait pas été traité de la meilleure manière, et créant un débat considérable. Dans ces conditions, l’éditeur a décidé de publier le livre écrit par le docteur Gubler le 17 janvier 1996.
Procédure
Procédure de référé
Saisi en référé par la famille qui dénonçait une violation du secret médical et une atteinte à l’intimité de la vie privée, le président du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 18 janvier 1996, a interdit la diffusion du livre dans l’attente d’un procès au fond, décision qui a ensuite été confirmée en appel et en cassation.
Procédure pénale
Saisi par le procureur de la République, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 5 juillet 1996, a déclaré le docteur Gubler coupable du délit de violation du secret professionnel, jugement dont il n’a pas été fait appel.
Procédure au fond
Dans le cadre d’une procédure au fond, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 23 octobre 1996 prononcé l’interdiction définitive du livre, jugement confirmé en appel et en cassation.
Analyse (Cour européenne)
- Mesure provisoire
La publication du livre, dans les jours qui ont suivi le décès, constituait une atteinte au secret médical et une atteinte au droit à l’intimité de la vie privée qui justifiait l’interdiction provisoire du livre, dans l’attente d’un jugement au fond.
- Mesure définitive
Avec le recul du temps, passé le temps du deuil et de l’intimité, l’intérêt public du débat lié à l’histoire des deux septennats accomplis par le président Mitterrand l’emportait sur les impératifs du secret et de l’intimité. Il faut tenir compte du large débat qui s’était créé dans la société française suite à ces informations, et du droit des personnes d’obtenir des informations justes sur un sujet d’intérêt général. Ainsi, dans ces circonstances exceptionnelles, « la sauvegarde du secret médical ne constituait plus l’impératif prépondérant ».
A retenir
Passé le temps du deuil, et parce qu’il y avait un débat national sur les conditions d’exercice du pouvoir, la Cour admet la diffusion d’informations par le propre médecin traitant.
Règle 39 – Le secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du médecin, même si ce n’est pas le médecin traitant, et ce pas seulement des données strictement médicales.
1/ Première décision
Conseil d’État, 17 juin 2015, n° 385924
Faits
Confrontée à une question gynécologique peut-être infectieuse, une dame s’est rendue au cabinet médical où exercent deux praticiens, mariés, avec lesquels existait une relation amicale, pour consulter l’épouse. En attendant la consultation, elle s’est trouvée, dans le secrétariat commun du cabinet, en présence de l’époux, à qui elle a parlé des résultats d’un examen et qui motivait sa visite. Quelques jours après cet échange, ce praticien a pris sur lui d’informer l’ex-ami de cette dame des résultats de l’examen dont celle-ci lui avait fait part, en l’invitant à consulter lui aussi un médecin.
Procédure
Analyse
Cette dame connaissait personnellement le médecin, et elle s’était adressée à lui en fonction de sa qualité de médecin. Alors même qu’il existant entre eux des relations amicales anciennes, que cet échange avait eu lieu en dehors de son cabinet et que la dame n’était pas venue le consulter lui, mais son épouse, le secret médical couvrait ces informations confiées à un médecin, même s’il n’était pas le médecin traitant. En en révélant la substance à l’ex-ami, le médecin a méconnu l’obligation du secret. Le fait qu’il aurait eu une intention prophylactique en communiquant ces informations est inopérant.
2/ Deuxième décision
Conseil d’État, 15 décembre 2010, n° 330314, mentionné dans les tables
« Considérant que, même si comme l’a relevé la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, ce certificat ne porte par lui-même aucune indication relevant du diagnostic médical, M. B a divulgué, par un certificat non-anonymisé remis à des tiers des éléments relatifs à l’état de santé de M. A ; que la circonstance que des personnes, du cercle de la famille et du service de secours, ont été témoins de ce dont le praticien avait eu connaissance, ne saurait davantage justifier qu’il soit libéré du secret professionnel qui pèse sur lui […] ».
Faits
Un médecin de garde à Aubusson a été requis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Creuse pour une intervention au domicile d’une personne, dont il était par ailleurs le médecin traitant. A la suite d’un différend survenu entre la personne secourue et le SDIS, ce dernier a sollicité du praticien une attestation sur les circonstances de l’intervention. Le médecin a établi le 26 janvier 2006 ce certificat descriptif qu’il a remis au SDIS.
Le patient a saisi la juridiction disciplinaire ordinale pour violation du secret médical. Statuant en appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le 3 juin 2009, a rejeté la plainte, confirmantla décision de la chambre disciplinaire de première instance du Limousin, au motif que le certificat ne portait pas d’indication diagnostic et qu’il n’avait faire que décrire des faits vus par d’autres témoins.
Textes
CSP, art. L. 1110-4 :
« Le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne ».
CSP, art. R. 4127-4 :
« Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Analyse
Ce certificat ne porte par lui-même aucune indication relevant du diagnostic médical, mais le médecin a divulgué, par un certificat non-anonymisé remis à des tiers, des éléments relatifs à l’état de santé du patient. La circonstance que des personnes, du cercle de la famille et du service de secours, ont été témoins de ce dont le praticien avait eu connaissance, ne saurait davantage justifier qu’il soit libéré du secret professionnel qui pèse sur lui. Ainsi la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a méconnu la portée des dispositions de l’article R. 4127-4 CSP.
A retenir
Le secret concerne toutes les informations venues à la connaissance du médecin à l’occasion de son exercice professionnel. Il n’est pas limité au diagnostic ou au traitement, et n’entre pas en jeu le fait que d’autres personnes, non tenues par le secret, ait divulgué ces informations. Il en est de même sur ces informations relèvent de la rumeur.
Conseil d’Etat, 28 mai 1999, n° 189057, publié
« Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la diffusion dans un organe de presse, qui procédait à une enquête sur l’hypnose, de la photographie d’une patiente, prise dans le cabinet du praticien, même avec le consentement de l’intéressée, est de nature à dévoiler l’identité de cette patiente qui est partie intégrante des informations couvertes par le secret médical ; que, par suite, en regardant le comportement de M. X…, qui a autorisé et organisé la réalisation de la photographie litigieuse dans son cabinet, comme constitutif d’une violation du secret médical […] ».
Faits
Un praticien, sexologue, avait autorisé un journaliste à prendre une photographie de l’une de ses patientes dans son cabinet, avec bien sûr l’accord de celle-ci, en vue de sa publication dans un hebdomadaire qui procédait à une enquête sur l’hypnose,
Analyse
La diffusion dans un organe de presse de la photographie d’une patiente, prise dans le cabinet du praticien, même avec le consentement de l’intéressée, est de nature à dévoiler l’identité de cette patiente qui est partie intégrante des informations couvertes par le secret médical. L’autorisation donnée par un médecin, même avec le consentement de l’intéressée, de diffuser dans un organe de presse, dans le cadre d’une enquête sur l’hypnose, la photographie d’une patiente prise dans le cabinet du praticien constitue en l’espèce une violation du secret médical.
A retenir
Un médecin ne peut accepter que soit diffusée dans la presse la photographie d’une patiente prise dans son cabinet, et l’accord de la patiente ne peut remettre en cause l’obligation du secret. Nul ne peut délier le médecin du secret.
Règle 41 – Le médecin cité dans une affaire en sa qualité de médecin traitant doit opposer le secret, et ni le patient, ni la juridiction, ne peuvent le délier de son obligation.
Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 1998, n° 97-83656, publié
« Qu’en effet, l’obligation au secret professionnel, établie par l’article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue […] ».
Faits
A l’occasion d’un procès d’assises, avait été cité comme témoin le médecin traitant de l’accusé. Celui-ci s’était retranché derrière l’article 226-13 du Code pénal dès lors que les questions concernent les traitements, les soins ou l’état de santé de son ancien patient. La cour lui en avait donné acte, et la défense contestait cette décision de la cour, soutenant que le patient avait délié le médecin du secret et que le silence ainsi admis avait gravement préjudicié aux droits de la défense sur un élément essentiel du dossier personnel de l’accusé.
Analyse
L’obligation au secret professionnel, établie par l’article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état, et sous cette seule réserve, elle est générale et absolue. Ainsi, la cour d’assises ne pouvait que prendre acte du refus du médecin.
A retenir
Le silence du médecin est un devoir car il ne peut témoigner sur ce qu’il a appris lors de sa pratique professionnelle, sauf s’il est mis en cause lui-même, et alors dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire. Pour connaitre les faits, les juridictions pénales étudient les dossiers d’enquête et se font éclairer par les expertises judiciaires.
Règle 42 – Le juge ne peut pas contraindre un médecin à transmettre des informations couvertes par le secret.
Cour de cassation, 1° chambre civile, 15 juin 2004, n° 01-02338, publié
« Mais attendu que si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s’y sont opposés ; qu’il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance […] ».
Faits
Pour garantir le remboursement de prêts consentis par une banque, un homme a adhéré le 18 mars 1996 au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès d’une compagnie d’assurance, couvrant les risques invalidité et décès. Cet homme est décédé le 26 juin 1996.
La compagnie d’assurance a sollicité, une mesure d’expertise médicale. Le juge des référés a désigné un médecin expert, avec mission de rechercher les antécédents médicaux de l’assuré et de dire si l’affection ayant entraîné le décès était la suite ou la conséquence d’un syndrome pathologique existant antérieurement à l’adhésion. L’expert, pour remplir sa mission, a demandé au médecin du travail de transmettre le dossier de la personne décédée, ce que le médecin du travail a refusé.
A la demande de l’expert, le juge des référés a ordonné sous astreinte la communication par le médecin du travail, du dossier médical. Le médecin demandé la rétractation de cette ordonnance en invoquant le secret médical.
Procédure
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (17 mai 2000)a rejeté cette requête, énonçant que la personne était contractuellement tenue lors de la souscription de répondre avec exactitude, loyauté et sincérité au questionnaire médical, sous peine d’encourir l’annulation du contrat prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances. L’opposition à la levée du secret médical émanant de sa veuve ou de ses héritiers tendait à faire échec à l’exécution de bonne foi du contrat en mettant l’assureur dans l’impossibilité de se faire une opinion sur la sincérité des réponses au questionnaire médical par la recherche des antécédents médicaux de l’assuré préalablement à son adhésion.
Aussi, pour la cour d’appel, le juge des référés n’avait pas excédé ses pouvoirs en ordonnant la communication à l’expert judiciaire du dossier médical détenu par le médecin du travail. Ce dernier n’était pas fondé à se retrancher derrière le secret médical dès lors que cette remise était effectuée entre les mains d’un médecin expert commis par justice.
Analyse
Si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s’y sont opposés.
L’ordonnance du juge des référés doit être annulée. Le tribunal dans son pouvoir global d’appréciation, appréciera si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et il en tirera toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance.
A retenir
Cet arrêt est dans la ligne ouverte par l’arrêt Watelet, à savoir un secret général et absolu. Le juge ne peut pas imposer à un médecin, qui était intervenu comme thérapeute, de témoigner sur des faits couverts par le secret. De même, la production de documents médicaux lors d’une procédureconstitue une violation du secret.