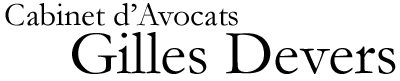Livre 1
Le Droit Pour Tous
Chapître 1 :
Des fiches pratiques pour tout comprendre
Quelle est la place de l’Etat ?
L’Etat est la référence en droit international et interne. L’Etat est souverain dans ses frontières, et il ne peut subir d’ingérence. Tous les Etats sont juridiquement égaux.
Comment définir juridiquement un Etat ?
Un Etat existe par la réunion de trois critères : une population, un territoire, un pouvoir organisé. Lorsqu’une collectivité estime que ces trois critères sont réunis, elle se revendique comme Etat et sollicite la reconnaissance par les autres Etats. Les grands mouvements de création d’Etats ont été la décolonisation au cours des années 1960 et l’éclatement du bloc soviétique au cours des années 1980. Le nombre d’Etats admis à l’ONU est de 193.
La souveraineté de l’Etat
Un Etat ne peut accepter de limitation à sa souveraineté que par voie d’accords, appelés les traités internationaux : un Etat s’engage vis-à-vis d’autres Etats. Le principe est qu’un Etat n’est jamais contraint de signer un traité. Seulement, ne pas signer les traités revient à s’isoler sur le plan international, et le droit international est toujours très proche de la diplomatie.
Quelle différence entre un Etat unitaire ou un Etat fédéral
Ce sont là deux modes d’organisation administrative qui ne traduisent pas un degré plus ou moins élevé de la démocratie.
Dans l’Etat unitaire, le cadre national est la seule référence d’organisation interne. Le pouvoir central dispose d’une autorité de principe sur tout le territoire et sur tous les sujets, et il organise en interne la déconcentration, en installant sur place ses représentants, et la décentralisation, en confiant des compétences autonomes à des collectivités locales. L’Etat français s’est construit à partir du pouvoir central, contre les féodalités et il en est résulté un Etat centralisé, même s’il a engagé depuis 1982, une politique de décentralisation.
Dans l’Etat fédéral, on trouve la combinaison d’un Etat central exerçant les fonctions régaliennes – diplomatie, armée, police, justice – et définissant les grandes orientations économiques et sociales, et de larges compétences sont reconnues aux Etats fédérés. Des Etats tels l’Allemagne, les Etats-Unis ou le Canada, ont adopté la structure fédérale.
Quels sont les mérites respectifs de la décentralisation et déconcentration ?
Le pouvoir d’Etat doit se conjuguer avec des processus qui, par souci d’efficacité et de démocratie, rapprochent la décision du citoyen.
Par la déconcentration, le pouvoir central installe ses représentants sur l’ensemble du territoire, pour assurer une plus grande proximité entre la structure centrale et le citoyen. L’exemple même est le préfet, représentant de l’Etat dans le département. Mais c’est aussi le cas du recteur d’académie ou du directeur d’agence régionale d’hospitalisation.
Par la décentralisation, le pouvoir politique transfère ses compétences à des autorités locales. C’est une amputation de ses pouvoirs, au profit de structures locales élues. Les communes, les départements, les régions sont des expressions de la décentralisation. Ces collectivités locales reposent sur des élections, qui assurent leur large autonomie.
Le système français est complexe : commune, département, région, Etat, Europe… Et il cumule les structures déconcentrées (département et région, dirigées par des préfets) et les structures décentralisées (Conseil départemental, conseil régional). Le maire cumule les deux fonctions : il est surtout un élu local, mais il exerce aussi des missions au nom de l’Etat, comme l’état-civil.
Comment définir le principe démocratique ?
La démocratie confère le pouvoir au peuple dans son entier, par la règle de la majorité. Toute personne doit participer à la délibération commune dans les mêmes conditions de droit. Le suffrage universel, c’est la capacité reconnue à chaque citoyen de voter. Le suffrage universel doit être défendu comme un principe intangible. En France, les femmes n’ont acquis ce droit qu’en 1945.
Quels sont les principaux modes de scrutin
Il existe deux modes de scrutin. Dans le système majoritaire, est élu celui qui obtient la majorité des voix, ce qui conduit à une sous-représentation de l’opposition. C’est, en France, le système retenu pour les élections législatives. Le scrutin majoritaire encourage à la pratique d’accords avant les élections, et devant les électeurs, car il faut négocier les accords qui permettent de dégager des majorités nettes. A l’inverse, dans le système proportionnel, les sièges sont répartis en proportion des voix obtenues, ce qui est plus juste, mais conduit à des assemblées plus divisées, et donc moins efficaces à court terme.
Les deux modes de scrutins conduisent à des représentations très différentes. Prenons un score de 51 / 49 %, sur tout un territoire. Au scrutin majoritaire, si c’est le même parti qui se retrouve systématiquement avec 51 %, il obtiendra tous les sièges. Avec un scrutin proportionnel, on obtiendrait pratiquement autant de sièges à l’une et l’autre liste.
Il est possible de combiner les deux systèmes en conciliant l’efficacité du système majoritaire et la justice du système proportionnel. C’est la solution retenue en France pour le scrutin municipal. La première moitié des sièges est attribuée à la liste gagnante, et la seconde est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes. La liste gagnante dispose d’une majorité confortable d’au moins les trois quarts des sièges, mais l’opposition n’est pas absente et peut ainsi s’exprimer tout au long du mandat. La démocratie y gagne et l’efficacité n’est pas remise en question.
Quel est le régime du référendum ?
Avec le référendum, corps électoral est appelé à se prononcer directement pour accepter ou rejeter un texte. Le système est vanté, car l’électeur s’exprime directement, mais ce système est en réalité très réducteur, car face à un texte important, la réponse est davantage le débat, avec beaucoup d’options, que l’alternative oui ou non. En outre, le référendum est très souvent détourné de son objet pour devenir un plébiscite pour ou contre le pouvoir qui le propose.
Qu’entend-on par Etat de droit
L’Etat de droit, qui garantit les libertés publiques, résulte de la combinaison de deux données : une structure hiérarchique des normes juridiques et le contrôle de légalité des textes et des décisions prises par le juge. La mise en œuvre est complexe mais le principe est simple : les institutions respectent la hiérarchie des normes – constitution, traité, loi, décret, arrêté. Le traité prend place dans le respect de la constitution, la loi respecte la constitution et les traités, et ainsi de suite pour le décret et l’arrêté. De plus, pour s’assurer que ce respect est effectif, toute décision faisant grief peut être soumise à l’examen du juge, par tout citoyen, et le juge doit vérifier que la mesure litigieuse respecte toutes les normes du droit.
Qu’est-ce que la constitution ?
La constitution est le texte-cadre dans lequel s’exerce le pouvoir d’Etat. La constitution est adoptée dans des conditions solennelles, à l’occasion d’étapes marquantes de la vie politique. En règle générale, la constitution est adoptée à la suite d’un référendum.
Quelle est le régime de notre Constitution ?
Notre constitution, la V°, a été adoptée en 1958 avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, sur fond de crise algérienne. La ligne directrice est de renforcer l’autorité de l’exécutif en donnant la primauté aux autorités gouvernementales et en limitant le rôle du Parlement, avec une place décisive confiée au président de la République. Le système s’est trouvé considérablement renforcé en 1962 lorsqu’il a été décidé, par référendum, de modifier la Constitution en faisant élire le président de la République au suffrage universel direct.
Quels types de règles contient la Constitution ?
La Constitution traite d’abord de l’organisation des pouvoirs publics : rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, responsabilité de la défense nationale, statut de l’institution judiciaire… La Constitution de la V° République a permis bien des évolutions politiques. Elle a permis d’instaurer un nouveau régime en 1958, d’affronter la crise algérienne en 1962, de tenir pendant le mouvement revendicatif de 1968, d’assurer l’alternance politique en 1981, de gérer les périodes cohabitations politiques.
La Constitution, ce sont aussi des textes fondamentaux…
Oui. La Constitution contient trois textes, qui sont le cadre pour tous les autres textes parce qu’ils sont au sommet de la hiérarchie de l’état de droit : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte sur l’environnement de 2004.
Comment est contrôlée l’application de ces textes ?
Par le jeu du contrôle de constitutionnalité, les lois sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel et à partir de ces textes très généraux, s’élabore un corps de règles actuelles et précises L’activité du législateur est ainsi encadrée. Le déclic a été la réforme de la Constitution de 1974 permettant à l’opposition politique de saisir le Conseil constitutionnel, dès lors que sont regroupés 60 députés ou sénateurs. Ainsi, l’opposition poursuit son action sur le terrain juridique et soumettant au Conseil constitutionnel les textes votés par la majorité. Il y a eu ensuite une importante évolution en 2008, en permettant à des citoyens, à l’occasion d’un procès en cours, de contester la constitutionnalité d’une loi, ce qui interrompt le cours du procès pour cette vérification. C’est le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité.
La Constitution peut-elle être modifiée ?
Oui, et la Constitution de la V° République l’a été souvent, soit par référendum, soit par un vote des deux chambres réunies, sous le nom de « Parlement ». Le texte actuel est très différent de celui adopté en 1958.
Quelle place ont les traités internationaux ?
Un traité est un engagement d’Etat à Etat, signé dans le respect de la souveraineté nationale. Les premiers lieux d’élaboration sont l’ONU et les grandes conférences internationales. Viennent ensuite les systèmes internationaux intégrés. Parmi eux, l’Europe, avec deux institutions européennes, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.
Quel est le régime de l’Union européenne ?
L’Union européenne est une structure volontaire des Etats, organisant un travail en commun, dans le respect de la souveraineté des Etats. Depuis 1957, le droit européen a été évolutif, allant dans le sens d’une plus forte imbrication des Etats.
L’Union européenne, c’est à ce jour le regroupement volontaire de vingt-sept Etats à travers cinq structures :
- le Conseil de l’Union européenne, qui regroupe dans un cadre collégial tous les chefs de gouvernement européens,
- la Commission européenne, à Bruxelles, organe permanent chargé de la mise en œuvre des politiques décidées par le Conseil et le Parlement,
- le Parlement qui siège à Bruxelles et à Strasbourg,
- la Cour de justice installée à Luxembourg.
- un haut-représentant pour les affaires étrangères.
Les parlementaires sont élus, le même jour, par tous les citoyens européens. La composition de la Commission résulte de désignations faites par des gouvernements, puis validées par le Parlement.
Le Conseil de l’Europe est moins connu…
Le Conseil de l’Europe, créé en 1951, qui regroupe à ce jour quarante-six Etats, a pour objet la défense des principes démocratiques et des droits fondamentaux. Le Conseil de l’Europe est un organe d’influence, mais qui dispose d’une mécanisme très efficace, avec un texte, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et une juridiction, la Cour européenne des Droits de l’Homme, dont le siège est à Strasbourg. Cette juridiction peut être saisie par tout citoyen estimant que des droits fondamentaux ont été violés en droit interne. De plus, la jurisprudence de la Cour peut être invoquée devant tout juge national.
Quel est le régime et l’importance de la loi ?
La loi se définit comme l’acte du Parlement, c’est-à-dire le texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux assemblées, qui constituent la représentation nationale.
L’initiative d’un nouveau texte peut être parlementaire : c’est une proposition de loi. Le plus souvent l’origine est gouvernementale : c’est un projet de loi. Les projets de loi sont adoptés en conseil des ministres puis inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement. De fait, l’immense majorité des lois est d’origine gouvernementale.
Comment sont votées les lois ?
Les textes sont étudiés en commission avant d’être votés, article par article, en séance publique. La plus large part du travail des assemblées a ainsi lieu en commission, avec des parlementaires spécialisés qui procèdent à une analyse détaillée et cherchent à faire prévaloir les positions de leur groupe politique. Lorsque le texte est examiné en séance publique, l’essentiel du débat a déjà eu lieu et chaque groupe ne désigne que quelques députés pour rendre compte des conclusions adoptées.
Une fois voté par l’Assemblée Nationale, le texte est soumis au Sénat, qui procède de la même manière. Si le Sénat n’adopte pas le projet dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale, celle-ci est à nouveau saisie et procède à un réexamen, adoptant un texte qui à son tour peut être renvoyé au Sénat. Ce jeu de la « navette » se poursuit jusqu’à l’obtention d’un accord. Le gouvernement peut interrompre le processus en saisissant une commission mixte paritaire composée à égalité de représentants de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Si cette commission ne parvient pas à trouver le consensus, le texte est soumis à l’Assemblée Nationale qui décide en dernier lieu.
Où intervient le Conseil constitutionnel ?
Une fois voté, le texte est soumis à un délai de carence de dix jours pendant lequel le président de la République, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale ou le président du Sénat, ou encore un groupe de soixante parlementaires peut saisir le Conseil constitutionnel, s’il est estime que certaines dispositions votées leur paraissent contraires au droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut valider la loi, ou l’annuler, totalement ou partiellement. Si un texte partiellement invalidé reste équilibré parce que les dispositions majeures n’ont pas été remises en cause, il peut être publié au Journal officiel. Si le texte est annulé sur des points essentiels, il est retiré.
Les décrets et les arrêtés ?
Les décrets et les arrêtés sont des textes d’application.
Les décrets sont signés que par le président de la République ou le premier ministre. Il s’agit des décrets d’application ou de nomination. Ces décrets peuvent aussi être des mesures de nomination individuelle, et un grand nombre relève de la compétence du président de la République. Mais l’essentiel des décrets, dits décrets réglementaires, sont des mesures d’application d’une loi, signées par le premier ministre, et cosignés par les ministres concernés.
Les arrêtés sont les dispositions réglementaires prises par tout chef d’administration dans son administration : ministre dans un ministère, préfet dans un département, recteur dans une académie, directeur dans un hôpital. De même le maire dans la commune. Pour qu’une autorité puisse signer un arrêté, elle doit y être autorisée par une loi ou un décret, et l’arrêté doit respecter le cadre défini par la Constitution, les traités, les lois, et les décrets, en application du principe de hiérarchie des normes.
Comment dans cet ensemble situer les circulaires ?
Les circulaires sont des textes interprétatifs, émanant de l’autorité hiérarchique, qui expliquent ou rappelle quel est l’état du droit, ou donne des consignes pour son application. En revanche, elles ne peuvent innover s’agissant des règles de droit elles-mêmes, car seuls les lois, décrets et arrêtés ont une portée normative. Emanant de l’autorité hiérarchique, les circulaires doivent être respectées comme une consigne par les agents du service, mais elles n’ont qu’une valeur indicative vis-à-vis des tiers.
Les circulaires sont attendues, par les agents des services comme par les administrés, car elles ont le mérite de donner une lecture claire du droit. Le travers est que sous réserve d’explication, les circulaires comprennent parfois des éléments qui excèdent le cadre défini par les textes, et qui ont en réalité une portée normative. Il faut alors déterminer si l’autorité signataire avait compétence pour prendre de telles mesures, et si ces mesures respectent les règles de l’Etat de droit.
Les ordonnances ?
Le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement. Celui-ci statue alors à sa place, et se prononce sous forme d’ordonnances. Une ordonnance a valeur de loi. Le recours aux ordonnances est un signe de fragilité du pouvoir qui redoute le débat devant les assemblées parlementaires, et préfère se faire habiliter.
Les amendements ?
Un amendement relève de la technique parlementaire. Il s’agit d’un texte émanant d’un député ou d’un sénateur, qui tend à enrichir le texte de loi, et qui est examiné lors de la discussion générale sur une loi. Il se trouve qu’un certain nombre d’amendements, du fait de leur teneur ou du contexte politique, acquièrent une célébrité, mais ils n’ont pas d’existence juridique autonome : il s’agit de la loi.
Les codes
Le code est un mode de regroupement des lois et décrets, Mais, le fait qu’un un texte soit codifié ne modifie pas sa valeur d’origine : il garde sa valeur législative ou réglementaire.
Au sein des codes, les lois sont reconnaissables par la lettre L. qui précède le numéro de l’article. Les décrets sont également codifiés : on distingue les décrets les plus importants, dit décrets en Conseil d’Etat, car le Conseil d’Etat a été consulté avant leur publication, qui sont précédés de la lettre R et les décrets simples, publiés directement par le premier ministre, pour lesquels est retenue la lettre D. Progressivement, tous les codes sont refondus avec une numérotation d’ensemble, les dispositions en L et en R se correspondant. Ainsi, pour un article L. 4311, le décret d’application se trouve au numéro R. 4311.
Qu’est-ce que le contrôle de la légalité ?
Cette structure hiérarchique des textes est une garantie pour le respect des droits et libertés. Toute texte doit s’inscrire dans « l’Etat de droit » : un traité, pour être applicable, ne peut comprendre de dispositions contraires à la Constitution. De même, une loi doit respecter la constitution et les traités. Le décret doit respecter les trois étages supérieurs, et l’arrêté l’ensemble des normes.
Quels recours existent pour faire respecter l’Etat de droit ?
Le plus pratiqué est le contentieux de la légalité : tout citoyen ou personne morale intéressée peut attaquer un décret ou un arrêté devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif.
Vient ensuite le contentieux de la constitutionnalité, qui est double.
Le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours en annulation contre une disposition législative qui leur apparaît contraire à la constitution.
Pour leur part, des citoyens peuvent, à l’occasion d’un procès, contester le constitutionnalité de la loi qu’on leur oppose, par le moyen d’une question préalable de constitutionnalité par laquelle ils demandent au juge de saisir le Conseil constitutionnel.
Quelles procédures en droit européen ?
Il y a deux voies principales.
Si à l’occasion d’un procès, une personne estime que le droit européen de l’Union européenne est méconnu par un texte interne, elle peut déposer devant le tribunal français une « question préjudicielle », qui autorise le tribunal français à interroger directement la Cour de justice de l’Union européenne pour vérifier si le droit européen est bien respecté.
Par ailleurs, lorsque les voies de recours internes ont été pratiquées une personne qui estime que ses droits fondamentaux ont été atteints, peut saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Sur le plan du droit international ?
Le plus efficace est le recours individuel formé devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU, chargé de l’application du Pacte des droits civils et politiques de 1966. C’est une action qui ressemble à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais qui permet de saisir une instance totalement internationale.
Il faut encore signaler la possibilité de saisir les rapporteurs spéciaux de l’ONU, qui rendent des avis consultatifs mais très écoutés.
Comment définir le rôle de la justice ?
L’Etat doit veiller à ce que les droits ne soient pas seulement proclamés, mais deviennent effectifs. C’est la question de l’accès au droit par le recours au juge. Il peut s’agir de litiges entre citoyens et les autorités publiques, qui abuserait de leur pouvoir, ou de litiges entre particuliers : dans les deux cas, la partie qui estime que ces droits sont laissés doit pouvoir saisir un tribunal, c’est-à-dire un juge indépendant et impartial.
Comment définir l’action du juge ?
Un tribunal doit être indépendant et impartial : indépendant, car il ne doit pas être lié à un organe administratif ; impartial, car le statut de ses membres doit les garantir de tout risque d’implication personnelle dans le procès. Ce sont des critères universellement reconnus. Juger, c’est décider mais en sachant se placer à distance. Le juge doit établir la réalité des faits, déterminer les règles de droit applicables, dire qu’elle est l’application du droit et prendre les mesures nécessaires pour rectifier les violations du droit.
Comment sont organisés les tribunaux en France ?
Pour des raisons historiques, la France connaît deux ordres de juridiction complémentaires, chacun ayant son domaine de compétence : les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.
Pour les affaires de droit privé, c’est-à-dire opposant des personnes physiques, ou les personnes morales de droit privé, telles que les associations, les syndicats ou les sociétés, la compétence revient aux juridictions judiciaires : tribunal de grande instance, cour d’appel et Cour de cassation.
Lorsqu’est en cause l’Etat, une administration publique ou une collectivité locale, la compétence revient aux juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’Etat.
Cette dualité est une source de complexité…
Globalement, c’est bien géré par les professionnels, et souvent cette répartition de compétences ne pose pas de problème : par exemple les affaires d’urbanisme relèvent du droit public et donc du tribunal administratif alors que les affaires de famille relèvent du tribunal de grande instance du juge aux affaires familiales. Il y a donc des juges distincts pour des affaires distinctes. Pas de problème.
Ceci dit, cette dualité de juridiction reste une source de complexité car nombre de questions mêle les structures de droit privé et celles de droit public. C’est par exemple le cas pour l’enseignement ou la santé.
Et puis ce ne sont pas les mêmes magistrats, pas les mêmes procédures… et deux cours supérieures, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, avec des interprétations de la loi qui connaisse des différences sensibles selon le type de tribunal, ce qui n’est pas satisfaisant.
Quelles implications dans le secteur de la santé ?
Les établissements de santé se répartissent en trois groupes :
- les établissements publics – les centres hospitaliers – dont le contentieux dépend des juridictions administratives ;
- les professionnels libéraux et les cliniques privées, soumises au juridictions judiciaires ;
- les établissements privés participant au service public hospitalier, dits « PS-PH », qui connaissent les avantages et contraintes du service public, mais restent des établissements privés et dépendent des juridictions judiciaires.
Les établissements de santé et les professionnels pratiquent tous en fonction des mêmes diplômes, du même cadre législatif et les mêmes données scientifiques. La même qualité de soins est attendue de partout. Aussi, le fait qu’il y ait des tribunaux distincts selon la structure juridique de l’établissement n’est pas satisfaisant, et surtout, il y a des divergences très nettes entre les jurisprudences civiles et administratives, ce qui n’est pas acceptable.
Par exemple ?
Pour les mêmes faits, le montant des indemnisations est nettement plus favorable devant les juridictions civiles qu’administratives. La différence parfois du simple au double.
S’agissant de la fin de vie, le Conseil d’Etat a mis en place une jurisprudence permettant au juge d’intervenir dans les décisions médicales, alors que la Cour de cassation y est opposée. Ainsi dans la période cruciale de la fin de vie, les juges s’immiscent dans la pratique médicale dans les hôpitaux publics, alors que dans les établissements privés ils en restent à un contrôle a posteriori dans le cadre de la responsabilité. La même loi conduit à des jurisprudences inversées.
Les juridictions civiles admettent des situations de présomption de faute en matière chirurgicale, ce que les juridictions administratives refusent… et tant d’autres situations : d’ailleurs, les professionnels n’évoquent pas une jurisprudence judiciaire devant les tribunaux administratifs, et inversement.
Où se situent les juridictions pénales ?
Le pénal est confié aux juridictions judiciaires, saisies par le procureur de la République, qui intervient dans le procès au nom de la société. Le tribunal de grande instance, formation civile, complétée par le procureur de la République, prend alors le nom de tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est compétent à l’égard de tout citoyen, comme personne privée, ou comme salarié ou agent de la fonction publique.
Le procès pénal est d’abord l’affaire du procureur de la République, dans une logique d’accusation de la personne poursuivie. La sanction pénale suppose la preuve de la culpabilité. C’est l’application de la règle de la présomption d’innocence : une personne est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un jugement devenu définitif. Cette peine est prononcée au nom de la société, en fonction du trouble causé et des gages de réinsertion qu’offre le délinquant : prison, amende, peine prononcée avec ou sans sursis, peine de substitution telle que le travail d’intérêt général…
Un exemple ?
Une infirmière, agent de la fonction publique hospitalière, a par un surdosage médicamenteux causé la mort d’un patient. Elle sera poursuivie devant le tribunal correctionnel, qui est une formation d’une juridiction judiciaire, alors même qu’elle a le caractère d’agent public. En revanche, la faute étant liée à son statut professionnel, l’indemnisation restera à la charge de l’hôpital, et c’est le tribunal administratif qui sera compétent pour verser les dommages et intérêts à la famille.
Qu’en est-il des règles de procédure ?
La justice ne peut être rendue sans le respect de règles de forme que l’on appelle la procédure, et qui visent à garantir les droits de la défense.
La personne poursuivie doit être avisée suffisamment à l’avance, connaître les griefs, disposer du temps nécessaire pour s’organiser, être assistée d’un avocat, connaître les pièces qui fondent l’accusation, soulever des moyens de droit et exposer les arguments de fait auxquels le tribunal devra répondre… Elle doit également disposer de garanties dans la tenue de l’audience avec la possibilité de se taire – c’est le droit au silence – d’être entendue, de faire citer ses témoins, et ce dans le cadre d’une audience publique. Elle doit pouvoir exercer des voies de recours. Pas d’affirmation du droit sans une procédure équitable.
Qu’est-ce que l’appel ?
C’est la voie de recours ordinaire. Toute personne qui est en désaccord avec un jugement peut faire appel, devant la cour d’appel dans les affaires de droit privé, et devant la cour administrative d’appel dans les affaires de droit public. L’appel prive le jugement de tout effet et conduit à un réexamen d’ensemble par la cour. Seules les décisions de faible importance sont rendues en dernier ressort, sans possibilité d’appel.
Qu’est-ce que le pourvoi en cassation ?
Après l’appel, vient le pourvoi en cassation, devant la Cour de cassation pour les affaires de droit privé, et devant le Conseil d’Etat pour les affaires de droit public. En cassation, on ne rejuge pas l’affaire : on contrôle, à partir de faits qui sont réputés définitivement acquis, la correcte application des règles de droit. Si l’application du droit est conforme, l’arrêt est confirmé. S’il apparaît que la cour d’appel a commis une erreur de droit, l’arrêt est cassé, et l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel, qui à partir de faits considérés comme définitivement jugés, rendra un nouvel arrêt.
Quels sont les noms des décisions de justice ?
Les tribunaux rendent des jugements, les cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat des arrêts. Les ordonnances sont rendues par les juges uniques : juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, …
Comment définir la jurisprudence ?
La jurisprudence est d’abord un phénomène général. C’est l’ensemble des décisions rendues par la globalité des tribunaux.
Au sein de cet ensemble, quelques décisions font référence du fait de l’importance du sujet qu’elles traitent ou de l’autorité de la juridiction qui s’est prononcée. On dit alors que cette décision « fait jurisprudence », car la solution juridique dégagée a vocation à être reprise par d’autres juridictions.
Sur nombre de points, c’est la jurisprudence qui fait autorité, car la loi est trop générale : elle permet d’organiser le raisonnement, mais elle donne rarement la solution. D’ailleurs, on considère qu’une jurisprudence établie équivaut à une loi. Sur les questions sensibles, la loi hésite à entrer dans des définitions trop précises, et laisse le champ à la jurisprudence pour, au cas par cas, de définir les contours des notions juridiques.
Par exemple ?
En droit de la santé, la loi dit que la responsabilité est engagée en cas de faute, sans donner de définition directe la faute médicale.
En droit du travail, le code du travail autorise le licenciement s’il est fondé sur « une cause réelle et sérieuse », et c’est aux tribunaux de dire ce qu’est cette cause réelle et sérieuse.
Selon une disposition applicable droite interne de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il reste juste à définir ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant…
Quelle est la place des juges non-professionnels ?
Elle est considérable. Près de la moitié des magistrats, c’est-à-dire des personnes qui ont pour mission de rendre justice, ne sont pas des professionnels du droit mais des juges élus : tribunaux de commerce, conseils des Prud’hommes, instances professionnelles ordinales, instances disciplinaires des fédérations ou associations…
La Cour d’assises ?
La cour d’assises est illustrative de ce qu’est la fonction de juger dans une démocratie. Elle comprend trois magistrats professionnels, et six jurés, c’est-à-dire des citoyens tirés au sort à partir de la liste électorale. Les affaires les plus graves, les crimes, relèvent d’une juridiction au sein de laquelle sont majoritaires les jurés, alors qu’ils ne disposent a priori d’aucune formation juridique. Des règles garantissent la qualité de la procédure et le président de la juridiction assure la conduite des débats, mais l’esprit de la loi est clair : c’est le jugement du peuple que l’on attend.
Pour aller plus loin
Qu’est-ce que le droit pénal ?
La démarche du droit pénal est universelle : le législateur reconnaît qu’un certain nombre de notions fondamentales méritent d’être protégées en elles-mêmes, indépendamment d’une action de la victime. Indispensable à la préservation de l’ordre social, mais mettant en jeu la liberté et l’honneur des personnes : c’est le paradoxe du pénal qui tout à la fois protège et sanctionne.
Peut-on donner un exemple ?
Le droit de propriété. C’est un droit qui est de nature civile : on acquiert la propriété par un contrat, Ce contrat permet de faire respecter la propriété vis-à-vis des propriétaires antérieurs et des tiers. Mais il y a usurpation de la propriété, il n’est pas acceptable d’en rester à l’action civile du vrai propriétaire. En effet, le vol, au-delà de la victime directe, atteint la société dans son ensemble, qui doit réagir collectivement face aux voleurs. Le vol est donc une infraction, et le voleur s’expose au pénal à une peine de prison, sur les réquisitions du procureur, et au civil à restituer le bien au vrai propriétaire et à le dédommager.
Le pénal poursuit une logique autonome, au nom de société…
Exactement. D’ailleurs, pour de nombreux faits, il n’existe qu’une réponse pénale, sans action reconnue à des victimes. C’est par exemple le cas pour le trafic de stupéfiants ou l’ivresse au volant.
De plus, le pénal s’intéresse à l’intention de l’auteur, car cette intention coupable est redoutée, lequel escale le risque de réitération. Aussi, la loi pénale sanctionne l’intention dès qu’il y a eu un début d’exécution, et même s’il n’y a pas réussite. Un homme, qui cherche à voler une voiture, est parvenu à ouvrir la portière et à s’installer au volant les policiers qui ont été arrêtés interviennent rapidement alors que l’auteur cherche à faire démarrer le moteur. Pour le propriétaire, si le véhicule n’a pas été endommagé, il n’y a pas de préjudice car il n’a pas été volé. En revanche, pour la société, et donc le pénal, le fait déterminant est l’intention de voler, et la sanction est encourue pour la tentative dans les mêmes conditions que pour l’infraction réussie.
Que recoupe la distinction entre le Parquet et le Siège ?
La maîtrise du procès pénal est confiée à un corps de magistrats, les procureurs de la République, dont la mission est de conduire l’action publique. Les procureurs organisés en un système hiérarchique, dénommé « le Parquet », placé sous l’autorité du ministre de la Justice.
Au niveau de la Cour d’appel, le responsable du Parquet est le procureur général, assisté d’avocats généraux. Il existe auprès de chaque tribunal de grande instance un procureur de la République, assisté de substituts.
Les « juges du siège » sont les magistrats qui ont pour mission de juger : président du tribunal, président de chambre, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des enfants… Ces magistrats disposent d’un ensemble de garanties de carrière qui assurent leur indépendance.
L’initiative de l’action pénale revient au procureur de la République. Mais la victime peut aussi porter plainte ou se constituer partie civile, ce qui, selon diverses modalités, permet d’obtenir un procès pénal.
L’indépendance des juges ?
Tout le monde s’accorde à dire que le statut de la magistrature confère aux juges du siège une vraie indépendance, avec plusieurs garanties, dont celles de l’inamovibilité, de la nomination, et du droit disciplinaire.
S’agissant du parquet, la situation est sensiblement différente car juridiquement le parquet reste placé sous l’autorité du Garde des Sceaux, donc du pouvoir politique. Les gouvernements restent très attachés à conserver ce lien hiérarchique, qui permet d’insuffler des politiques pénales. S’il est certain que dans les prises de décisions individuelles, les procureurs disposent d’une grande liberté d’action, ce lien hiérarchique reste une gêne au regard des exigences d’indépendance que l’on attend de tout magistrat.
À plusieurs reprises, les représentants de la magistrature ont pris position pour une indépendance du Parquet, qui n’est pas d’actualité.
Quel est la mission du juge d’instruction ?
Le juge d’instruction est un magistrat du siège, qui est saisi par le procureur de la République pour les affaires pénales graves ou complexes. Le juge d’instruction dispose de pouvoirs d’investigation, et il peut prendre des mesures de contrôle sur les personnes par le biais du contrôle judiciaire, afin de s’assurer de la bonne tenue de la phase d’instruction.
Qu’est-ce que le principe de légalité des délits et des peines ?
Ne peuvent être sanctionnées que les infractions définies par la loi, et ne peuvent être prononcées par une juridiction que les sanctions prévues par la loi. En matière pénale, le tribunal doit définir quel article du Code pénal a été violé. De même, la sanction n’est pas laissée au libre-arbitre du tribunal. Celui-ci ne peut appliquer qu’une sanction prévue par la loi, et il adapte la peine au regard de la personnalité du délinquant en fonction du régime légal de l’adaptation des peines.
Qu’est-ce que le principe de la non-rétroactivité ?
Nul ne peut être poursuivi en fonction de textes qui n’existaient pas au moment des faits. On avertit à l’avance ce qui est puni ou on, et chacun adapte son comportement en fonction des prescriptions de la loi.
Comment sont classées les infractions ?
Les infractions les moins graves sont les contraventions, jugées par le tribunal de police, et les plus graves sont les crimes, jugées par les cours d’assises. Entre les deux, on trouve les délits jugés par le tribunal correctionnel.
Les droits de la défense ?
La condamnation pénale, au nom de la société, est un acte grave et solennel qui ne peut être prononcée qu’au terme d’une procédure protectrice des droits. Ces principaux droits sont la notification des griefs, l’accès au dossier, l’assistance d’un avocat, la possibilité d’apporter ses propres preuves, de faire citer des témoins, le droit d’appel…
Qu’est-ce que la mise en examen ?
Lorsqu’apparaissent à l’encontre d’une personne des indices précis et concordants de culpabilité, celle-ci doit être mise en mesure de se défendre. C’est à ce stade qu’intervient la mise en examen. La mise en examen est une mesure préoccupante, mais elle est aussi un droit de défense. La personne sait alors avec précision ce qui lui est reproché. Elle peut désigner un avocat qui a accès au dossier et peut en prendre copie. Elle ne peut plus être entendue par la police mais seulement par le juge, en présence de son avocat, et avec une convocation respectant un délai suffisant pour permettre à la défense de s’organiser.
Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?
Pendant l’enquête, il peut apparaître nécessaire que soient prises des mesures pour garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne poursuivie. Ce sont les procédés du contrôle judiciaire et de la détention provisoire. Ces mesures sont très contrôlées, car ces restrictions à la liberté sont décidées alors même que la culpabilité n’est pas établie.
La détention provisoire ?
C’est le seuil de gravité au-dessus. Alors que l’affaire n’est pas jugée, une réunion de critères liés à la gravité des faits, l’absence de garanties de représentation fournie par la personne, le risque de réitération, les pressions sur les victimes… démontre qu’il n’y a pas d’autres solutions que de placer la personne en détention. Cette décision est prise par un juge indépendant, le juge des libertés et de la détention.
Comment se déroule l’audience de jugement ?
Après instruction, et si les charges sont établies, l’affaire est renvoyée en audience de jugement. L’audience pénale est publique. L’instruction doit être reprise oralement à l’audience. Sont ensuite entendues la victime, le procureur de la République et la personne accusée.
Quels sont les délais de prescription ?
Les poursuites pénales doivent être engagées pour les contraventions dans un délai de deux ans, pour les délits dans un délai de six ans et pour les crimes dans un délai de vingt ans.
Droit, morale, éthique…
Dans la pratique quotidienne, les premières références ne sont pas la loi et le procureur, mais le bon sens, l’esprit de responsabilité et le devoir moral.
La morale irrigue la pratique. Mais il faut moins parler de la morale que de la coexistence des morales. Autant de personnes, autant d’époques, autant de pays : autant de morales. L’éthique tend à étudier la diversité des morales pour déterminer quelles sont les principes qui les fondent, et comment, lorsque la loi dit peu de choses, les décisions peuvent être prises au mieux.
Quelle est la caractéristique de la responsabilité juridique ?
C’est son caractère objectif. La responsabilité juridique est liée à la survenance de certains faits, et c’est l’analyse juridique qui permet de dire si oui ou non, la responsabilité est engagée.
La responsabilité juridique se subdivise en deux régimes distincts, et doit-on dire, de plus en plus distincts : la responsabilité civile, qui tend à la réparation des dommages, et la responsabilité pénale, qui vise à condamner les personnes fautives. Les distinctions et les liens entre ces deux régimes sont complexes, car le même fait peut donner lieu aux deux types de responsabilité, qui ont nature à se cumuler.
Un exemple ?
Les situations sont relativement proches lorsqu’il y a une infraction volontaire : le voleur ou l’agresseur sont condamnés sur le plan pénal, et de plus, ils assument personnellement l’indemnisation de la victime.
La différence nette lorsqu’il s’agit d’infractions « involontaires » c’est-à-dire commis sans intention coupable, comme c’est le cas responsabilité médical : le praticien hospitalier qui par sa faute a causer un dommage aux patients est condamné sur le plan pénal à titre personnel, mais sur le plan civil, la charge de l’indemnisation relève de l’établissement et de son assureur.
Quel est l’objet de la responsabilité civile ?
La responsabilité civile a pour objet la compensation matérielle du dommage causé, par l’allocation d’une somme d’argent. C’est un droit orienté vers les victimes. Ce droit à réparation s’effectue d’abord par le jeu de la solidarité, c’est-à-dire des mécanismes de la protection sociale : une personne malade doit être soignée et bénéficier des meilleurs soins, quelle qu’en soit la cause. Mais en complément, vient la responsabilité : demander des comptes à l’auteur des faits. C’est l’objet de la responsabilité en indemnisation, encore appelée responsabilité-réparation.
Existe-il un droit à indemnisation ?
Toute personne atteinte d’un dommage corporel causé par une infraction peut être indemnisée par l’auteur ou par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Il lui suffit de prouver qu’elle a été victime de faits infractionnels, même si l’auteur n’est pas retrouvé.
Un exemple ?
C’est par exemple le cas d’une personne victime de deux agresseurs au visage masqué. Une plainte pénale sera déposée, mais elle n’aboutira jamais, aucun signalement des agresseurs ne pouvant être donné. Elle peut obtenir l’indemnisation de son préjudice devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal de grande instance. L’indemnisation est versée par un fonds de garantie. Si les auteurs de l’agression sont identifiés, le fonds de garantie, qui a versé l’indemnisation, agira ensuite à leur encontre pour obtenir le remboursement des sommes payées.
D’autres système d’indemnisation ?
Dans cette volonté ne pas laisser sans indemnisation des personnes atteintes d’un préjudice important, la loi a institué un système des fonds d’indemnisation qui, s’il n’est pas encore généralisé, s’étend : sida post-transfusionnel, amiante, Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (ONIAM).
Comment décrire la responsabilité pénale ?
Avec le procès pénal, la société, par l’intermédiaire du ministère public, se saisit de l’affaire. Le procureur de la République dirige les poursuites, au nom de l’intérêt général. L’action publique devient prioritaire sur l’action de la victime, d’où l’expression : le criminel tient le civil en l’état. Il n’est possible de se prononcer sur la responsabilité civile que lorsque les culpabilités ont été établies.
Quelle place pour la victime ?
Dans la procédure pénale, la victime est associée à l’élaboration du jugement. Mais elle est d’abord orientée vers l’identification du délinquant et la connaissance de sa personnalité : son objet est d’établir une culpabilité et de prononcer la peine adaptée.
Quid de l’intention coupable ?
Le principe légal est qu’il n’existe pas de culpabilité sans intention de nuire, cette intention étant caractéristique du comportement délictueux. Toutefois, et compte tenu de ce que représente le corps humain, et l’intégrité physique, il a toujours été reconnu que lorsqu’il y avait atteinte à la personne, la culpabilité pouvait être retenue en cas de maladresse ou d’inattention. Ce sont les infractions « involontaires ». C’est la valeur protégée, l’être humain, qui justifie cette sévérité du droit pénal.
La procédure civile pas à pas…
- La responsabilité-réparation vise à indemniser le dommage subi par la victime.
- L’engagement de la procédure résulte de la seule volonté de la victime, qui décide, ou non, de faire un procès.
- Le procès est engagé contre la personne elle-même, pour l’exercice libéral, ou contre l’employeur, qui est un établissement public ou privé.
- Quand est en cause un infirmier libéral ou un infirmier salarié d’établissement privé, s’appliquent les règles de la responsabilité civile et le procès se tient devant les juridictions civiles : tribunal de grande instance, cour d’appel, cour de cassation.
- Quand est en cause un infirmier salarié d’établissement public, s’appliquent les règles de la responsabilité administrative, et le procès se tien devant les juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat.
- Les règles de la responsabilité civile et de la responsabilité administrative sont très proches, car désormais elles résultent des mêmes textes, qui définissent la responsabilité et les droits des patients, et qui se trouvent dans le Code de la santé publique.
- Cette dualité public/privé répond à des raisons historiques, mais à ce jour rien ne justifie cette distinction, car les établissements publics et privés sont tenus aux mêmes exigences de qualité des soins. Il est regrettable que la procédure n’ait pu être unifiée, mais il faut faire avec cette survivance historique !
- Si la faute ayant causé le dommage est établie, ou si on se trouve dans le cas d’une responsabilité sans faute, le tribunal prononce la condamnation du responsable à indemniser le dommage.
- Le responsable ayant l’obligation d’être assuré, c’est l’assurance de responsabilité civile qui assume en réalité la charge des condamnations, et verse l’argent à la victime.
- La faute détachable est la faute d’une gravité telle qu’elle se détache des fonctions confiées, et c’est l’agent qui supporte personnellement les conséquences financières ; mais dès lors qu’il existe un lien avec le service, et même si la faute est grave, on ne se trouve pas en situation de faute détachable et l’indemnisation reste à la charge de l’établissement.
La procédure pénale pas à pas….
- Le droit pénal organise la poursuite et la sanction des comportements individuels les plus graves, et qui sont définis comme des infractions.
- Les poursuites sont engagées par le procureur de la République, qui agit au nom des intérêts généraux de la société.
- La victime peut participer à l’enclenchement de l’action pénale en portant plainte, c’est-à-dire en signalant des faits qui peuvent constituer des infractions au procureur de la République.
- La première phase de l’enquête, dite enquête préliminaire, est secrète et ne dépend que des initiatives de la police, en lien avec le procureur de la République.
- Si les faits paraissent sérieux, le procureur désigne un juge d’instruction, qui conduira une information judiciaire.
- La victime peut participer à la phase d’instruction en se constituant partie civile.
- Si des éléments réunis par l’enquête apparaissent mettre en cause une personne, celle-ci doit être « mise en examen » par le juge d’instruction, ce qui lui permet d’être défendue par un avocat, d’avoir accès au dossier et de n’être interrogée que par le juge d’instruction.
Pour aller plus loin
Les droits des victimes, édité par l’Etat
Décider d’une action en justice n’est jamais simple, car cela renvoie à une situation complexe, et à des choix à opérer.
Comment déposer plainte ?
En réalité, la question est : est-ce une plainte qu’il faut déposer ? Cette précision est importante, car dans le langage courant, on utilise le mot de plainte pour toute action en justice, alors qu’il y a des régimes très différents.
Quels sont donc les différentes voies de justice ouverte ?
Schématiquement, il y a deux schémas principaux.
Dans le premier, la personne engage une procédure pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits, au nom de l’intérêt général, et en fonction de règles communes du droit. C’est typiquement la plainte pénale.
Dans le second, la personne engage une action en justice contre une autre, qui est un particulier ou une personne morale, pour obtenir dans un procès de nature interpersonnelle le rétablissement de ses droits. C’est le cas d’une assignation devant le tribunal de grande instance, d’une requête pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ou d’une saisine du conseil de prud’hommes.
Comment choisir ?
Il n’y a pas de règle générale.
Dans certaines circonstances, la plainte pénale va s’imposer, par exemple lorsqu’on est victime d’une agression ou d’une infraction complexe, faits qui nécessitent une enquête, et le savoir-faire des services de police, sous l’autorité du Procureur de la République, pour conduire ce travail d’enquête.
Dans d’autres, la personne qui entend agir dispose des éléments essentiels, et vise à défendre son intérêt particulier. Dans ce cas, elle doit plutôt s’orienter vers la procédure civile, et construire son procès, avec l’assistance d’un avocat.
Combien coûte l’engagement d’une procédure ?
En règle générale, il n’y a pas de cout direct : le plaignant saisi un service public d’Etat, et les coûts directs sont inexistants, ou faibles. La question est le coût des auxiliaires de justice : huissiers, avocats, experts…
Quelle est la procédure la plus coûteuse ?
Question délicate à voir avec son avocat.
Déposer plainte ne coûte pas cher, surtout si on effectue la démarche en se rendant au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Si l’enquête est vite et bien conduite par les services de police, il y aura ensuite renvoi devant le tribunal, et si c’est une affaire simple, la victime peut se rendre seule à l’audience, et exposer oralement sa demande, en répondant aux questions des juges. C’est alors le coût minimum.
Mais cette situation se rencontre rarement. Même si le dossier parait bien ficelé, une audience a vite de forts enjeux, et l’assistance d’un avocat pour préparer cette audience, faire entendre les justes arguments, répliquer et former les demandes s’avère alors indispensable.
Et puis, la plainte peut conduire à des dossiers complexes, confiés à un juge d’instruction, avec alors beaucoup de démarches à assurer, et les coûts deviendront élevés, voire très élevés.
Il faut évaluer la situation avec son avocat au début du procès, et faire une évaluation.
Le procès civil entraine toujours des frais de défense, car – sauf exception- il faudra la présence de l’avocat de A à Z, vu qu’au civil le demandeur construit lui-même le dossier.
Comment trouver ces premiers renseignements ?
Les tribunaux ont mis en place des procédés d’accueil des victimes. Les barreaux organisent des permanences gratuites par avocats, et nombre de communes ou de structures ont créé des régimes de consultation, par des avocats ou par des professionnels formés pour donner ce type d’information.
La méditation, la conciliation ?
Ce sont de très bons procédés, qui se développent. Pour des affaires délicates, il ne faut pas hésiter à solliciter des avocats pour trouver des conciliations. Une fois qu’une conciliation est conclue, elle a la même force qu’un jugement, alors il faut avoir une juste vision de ses droits avant de concilier.
Les délais de justice ?
Il existe des procédures rapides, comme les comparutions immédiates en correctionnelle, pour les délits flagrants, ou les référés, devant les juridictions civiles.
Mais en règle générale, les délais sont longs. Il existe parfois des retard importants, liés à l’engorgement des tribunaux, mais un procès prend naturellement du temps, le temps nécessaire à établir les faits et organiser les débats, alors qu’il peut y avoir beaucoup de version des faits, et des oppositions marquées. Il en est de même pour les expertises, qui sont un travail approfondi.
Qu’est-ce que le principe du contradictoire ?
C’est le grand principe directeur de procédure, au civil comme au pénal. Le juge ne peut se prononcer qu’après s’être assuré que toutes les parties au procès ont pu échanger leurs argumentaires et leurs pièces. Chacun de reproduire ses arguments, ses pièces ses preuves et les soumettre avant l’audience à la libre appréciation discussion de la partie adverse.
Pour aller plus loin
Commission d’accès aux documents administratifs
Avec la procédure civile, une personne forme une demande qui saisit un juge, qui a alors l’obligation de se prononcer. Cela suppose donc du formalisme et de la précision dans la rédaction.
Comment distinguer les procédures civiles et les procédures administratives ?
La France connaît deux ordres de juridictions différents.
Les juridictions judiciaires, qui connaissent des litiges entre les personnes privées, les associations, les sociétés,… sont principalement le tribunal de grande instance, la cour d’appel et Cour de cassation.
En matière commerciale, la juridiction est le tribunal de commerce.
S’agissant du droit du travail, les litiges civils relèvent du conseil de prud’hommes.
Les juridictions administratives, compétentes chaque fois qu’est en cause une collectivité publique, c’est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, sont principalement le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat.
Les conseils de discipline des ordres professionnels sont aussi des juridictions administratives.
Pourquoi les étudier ensemble ?
Les procédures civiles et administratives sont de même nature : une personne forme une demande en justice à l’encontre d’une autre personne. C’est en ce sens que ces deux procédures se distinguent du pénal, où le plaignant déclenche d’action du procureur, qui va diriger la procédure.
En matière civile et administrative, le demandeur constitue son dossier, réunit les pièces, cherchent les bons argumentaires juridiques, et formalisent les demandes aux quelles le tribunal, après avoir recueilli les arguments de la partie défenderesse, devra répondre.
Pour le reste, les techniques procédurales sont très différentes devant les juridictions administratives et judiciaires. En particulier, la procédure judiciaire mêle l’écrit et l’oral, et dans certaines procédures (juge des tutelles, tribunal d’instance, conseil de Prud’hommes…) la procédure est essentiellement orale, les écrits n’étant qu’un appui. En revanche, devant les juridictions administratives, la procédure est essentiellement écrite, et l’audience a un rôle formel.
Qu’est-ce que la procédure au fond ?
Le procès normal est appelé « la procédure au fond ». C’est le procès qui permet de faire trancher le litige, après l’échange entre les parties de toutes les pièces et arguments.
Ce procès suppose un certain délai, qui n’est pas toujours compatible avec la vie quotidienne. En règle générale, même bien conduite, une procédure devant le tribunal de grande instance dure entre 10 à 12 mois, et devant le tribunal administratif entre 18 mois à 2 ans.
Comment joue la recevabilité ?
Une demande en justice qui ne respecte pas les formalités du code peut être jugée irrecevable. Ainsi, il faut admettre un certain degré de technicité, pour passer le cap de la recevabilité.
Et la procédure de référé ?
Les procédures des référés se retrouvent devant le tribunal administratif et devant le tribunal de grande instance. En réalité, il y a une grande diversité dans les référés.
La désignation d’expert ?
La première procédure de référé vise à obtenir une mesure d’instruction, et en particulier, la désignation d’un expert. C’est une procédure efficace, car les délais sont courts, dans la mesure où ce qui est demandé au tribunal est assez limité, la désignation d’un expert. Cet expert interviendra en exécution de la décision de justice, c’est-à-dire en opérant de manière contradictoire.
Ainsi, les parties au procès sont convoquées et doivent se présenter à l’expertise. Si elles ne viennent pas, elles sont défaillantes et le rapport leur est opposable.
En pratique ?
L’audience peut être obtenue dans un délai très court, de 15 jours à 3 semaines. Le Tribunal alloue un délai, en général de 6 à 8 mois pour que le rapport d’expertise soit déposé. Mais il peut y avoir des mesures urgentes, notamment s’il faut rapidement faire un constat pour un équipement dangereux, dans ces cas les délais peuvent être beaucoup plus rapides, même ramenés à quelques semaines.
Pour obtenir la désignation de l’expert, il faut démontrer que l’expertise est nécessaire, c’est-à-dire que pour régler un litige, il y a besoin de disposer d’abord des lumières d’un technicien, pour comprendre une situation. Sous cette réserve, les procédures sont bien accueillies par les juges, et se révèlent d’une grande efficacité.
Les référés imposés par l’urgence ?
Il existe d’autres procédures de référés qui sont plus difficiles à exercer, car elles amènent le juge à prendre des mesures contraignantes, notamment la condamnation à verser une provision sur une indemnisation, ou à prendre des mesures conservatoires en cas de péril imminent.
La pratique de ces procédures nécessite une vraie dextérité de la part des avocats.
Il existe des audiences de référés toutes les semaines au tribunal, mais en cas d’urgence particulière, il est possible d’obtenir une audience à date rapprochée selon le système dit du « référé d’heure à heure » devant le tribunal de grande instance, ou du « référé-liberté », devant le tribunal administratif.
Qu’est-ce qu’une plainte ?
Déposer plainte, c’est transmettre au procureur de la République des informations qui sont susceptibles d’être la matière d’une infraction, et le procureur, autorité de l’Etat, seul maître de l’opportunité des poursuites, décide s’il y a lieu de faire une enquête, et quels moyens allouer à cette enquête.
La plainte n’est donc pas une action en justice en ce sens que, à l’inverse du civil, elle n’oblige pas le tribunal à trancher sur les faits qui sont dénoncés par la victime. La plainte de la victime déclenche un processus, qui ensuite lui échappe largement. La victime signale au procureur de la République des faits, et il revient au procureur d’apprécier s’il est opportun ou non d’ouvrir une enquête, et quel type d’enquête est approprié, puis de saisir le tribunal, en expliquant les griefs et en demandant une sanction pénale.
Quel est le rôle du procureur de la République ?
Le procureur est l’autorité poursuivante jusqu’à l’achèvement du procès.
Il existe pour chaque tribunal de grande instance un procureur de la République, mais il est entouré d’une équipe, avec un procureur-adjoint et des substituts.
Il peut agir de sa propre initiative, parce que des informations viennent à sa connaissance, notamment par le biais des services de police ou de gendarmerie dont l’une des missions est de constater les infractions à la loi. Mais il peut également agir à la suite de renseignements donnés par les particuliers. Juridiquement, c’est ce que l’on appelle la plainte.
Ainsi, il faut être très précis dans la dénonciation de ces faits, si l’on veut convaincre le procureur, car il est destinataire de nombreuses informations et qu’il n’est pas en mesure de toutes les exploiter.
Comment déposer plainte ?
Il est tout d’abord possible de se rendre au commissariat pour faire recueillir la plainte par une audition, qu’on appelle alors le procès-verbal. Ce mode est tout à fait jouable, mais il est préférable de passer par un écrit, avec un certain nombre de justificatifs.
De plus, dans la pratique, on observe une certaine réticence des services de police et de gendarmerie à enregistrer les plaintes. L’une des raisons est que le nombre de plaintes est analysé comme indicateur de la délinquance dans le pays. Aussi, il y a très souvent la proposition de transformer la plainte en une simple inscription sur un registre de main-courante. Le renseignement est laissé à l’appréciation de la police. Il pourra, un jour, être exploité, mais il ne donne pas lieu à enquête immédiate.
Ainsi, si le dossier est complexe ou délicat, il est très préférable de procéder par écrit.
Quand faut-il déposer plainte par écrit ?
La plainte peut être rédigée par toute personne ou par un avocat. Si le dossier est complexe, il pourra s’avérer nécessaire d’avoir recours aux services d’un avocat.
En particulier, il faut être très prudent quand on cite des noms dans une plainte pénale, car cela peut conduire à des procédures de dénonciation calomnieuse. De telle sorte, il est plus prudent de rédiger une plainte contre X, en proposant les noms d’un certain nombre de personnes pouvant être entendues comme témoins.
Si les faits sont caractérisés, exposés de manière cohérente et susceptibles de recevoir une qualification juridique, le procureur donnera suite. Les plaintes peuvent être adressées aux services du procureur de la République en écrivant directement au Palais de justice à l’attention de son secrétariat.
Qu’est-ce qu’une constitution de partie-civile ?
C’est l’action de la victime qui, atteinte par une infraction, se manifeste dans une procédure pénale, pour faire valoir ses droits, c’est-à-dire participer à la preuve de la vérité, démontrer que la personne poursuivie est coupable et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Ainsi, si le procureur a ouvert une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, ou a renvoyé une affaire devant le tribunal, la victime peut se constituer partie civile pour faire valoir ses droits.
Comment porter plainte avec constitution de partie-civile ?
C’est une démarche écrite auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance, la victime exposant les faits et indiquant qu’elle se constitue partie civile.
Sous réserve de quelques modalités de procédure, la plainte avec constitution de partie civile entraîne le déclenchement d’une action pénale contre l’auteur présumé de l’infraction. C’est donc un acte de haute portée, car la victime devient accusatrice.
Dans quels cas une victime peut-elle se porter plainte avec partie civile ?
Cette possibilité est ouverte dans trois situations :
- les faits en cause sont un crime,
- une plainte a été classée sans suite,
- une plainte simple a été déposée, et trois mois plus tard le procureur n’a pas donné de réponse.
Quel est le statut des avocats ?
Les avocats sont des professionnels du droit dont le statut garantit l’indépendance, avec une fonction de conseil et de défense. Un avocat est inscrit auprès d’un Barreau, organe collégial élu qui exerce un contrôle administratif et disciplinaire. Il existe une grande diversité dans les modes d’exercice tant par la structure du cabinet, que par le type d’activité.
Comment choisir un avocat ?
En se renseignant et en lui posant des questions. La profession reconnaît certaines spécialisations, mais elles ne sont pas marquées, à l’inverse des pratiques des professions médicales. Par ailleurs certaines spécialisations sont particulièrement larges, comme le droit de la santé, qui concerne les établissements publics de santé et les professionnels libéraux, la responsabilité pénale, civile et administrative, l’organisation de la santé publique, les carrières des personnels, la santé mentale…
En réalité, il existe toujours un fond généraliste et une expérience de la procédure que l’avocat met en œuvre dans des domaines qui font son activité dominante. Aussi, après des renseignements et en fonction de sa notoriété, il faut prendre contact avec l’avocat, et lui demander s’il est d’accord pour traiter le dossier. Si cette affaire n’entre pas dans son domaine de compétence, il préférera orienter vers un confrère.
Est-ce qu’un premier rendez-vous est payant ?
Chaque avocat est libre. La personne qui prend rendez-vous doit poser directement la question. Quant une consultation écrite doit suivre pour une étude du dossier, la pratique générale est de pas facturer le rendez-vous, mais d’inclure dans la facturation globale. Ceci dit, il est possible de prendre rendez-vous auprès d’un avocat pour disposer d’une consultation, orale et écrite, sans engager de procédure.
Comment s’organise le travail ?
Sauf pour les affaires simples ou urgentes, l’avocat doit prendre le temps d’une étude préalable du dossier pour rédiger une consultation, exposant à partir d’une synthèse des faits, le problème juridique et la manière dont il entend le résoudre. Cette consultation est un acte essentiel de la relation, et elle permet au client de s’engager sur une base raisonnée, et non pas sur une confiance aveugle. La consultation doit détailler la procédure, les délais et inclure également un devis. S’il y a accord, il est alors signé une convention d’honoraires, qui en substance valide la consultation et le devis.
Comment sont fixés les honoraires ?
Le montant des honoraires est arrêté avec son client par une convention. C’est à l’avocat de faire un devis. Il est souvent difficile de déterminer à l’avance quel sera le coût d’une affaire, beaucoup d’éléments sur son déroulement étant inconnus, aussi les règles de facturation par prestation doivent être fixées, avant toute intervention, dans la convention d’honoraires.
Quel montant ?
Le montant est libre, mais les règles professionnelles retiennent conq critères : la difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, la spécialisation ou la notoriété de l’avocat, la situation de fortune du client, et les frais à engager.
L’honoraire peut être fixé en fonction des prestations, listées dans la convention, ou de manière forfaitaire.
L’honoraire de résultat ?
Il est possible de convenir que l’avocat aura une rémunération référencée sur le résultat obtenu, ce qu’on appelle l’honoraire de résultat. Cet honoraire ne peut être que complémentaire à l’honoraire de base, fixée en fonction des prestations ou par forfait. La profession interdit un honoraire qui n’est fixé que sur le résultat, car ce serait ouvrir une dérive en invitant les avocats à ne s’intéresser qu’aux affaires fructueuses.
Lorsque la situation du client ne lui permet pas de payer l’honoraire de prestation ou de forfait, il est possible de faire reporter le paiement à l’issue de la procédure, en fonction des sommes qui sont obtenues.
Comment fonctionne l’aide juridictionnelle ?
L’aide juridictionnelle est versée par l’État en fonction de la situation économique d’un plaideur. Celui-ci doit donc remplir un dossier qui retrace la situation personnelle et financière, et ce dossier est soumis au bureau d’aide juridictionnelle qui, en fonction des chiffres, octroie l’aide juridictionnelle, totale ou partielle.
Si un avocat est accord pour intervenir sur le dossier, le bureau lui attribuera la désignation, et à défaut, ce sera un avocat désigné d’office.
De notoriété, les sommes versées par les juridictionnelles sont faibles et elles ne correspondent pas aux coûts de fonctionnement des cabinets structurés. Aussi, il faut en discuter clairement avec l’avocat pour voir s’il accepte cet effort, ou s’il est plus sage de confier le dossier à un jeune avocat, qui ne connaît pas les mêmes charges de fonctionnement.
* * *
Pour aller plus loin
A
Amnistie. L’amnistie, définie par la loi, efface la sanction pénale. Elle traduit la volonté de « tourner la page ». L’amnistie relève de la philosophie pénale. Si la sanction pénale ne joue plus de rôle dans la préservation de l’ordre public, il n’y a pas lieu de maintenir cette mesure punitive.
Appel. L’appel est une voie de recours qui prive le jugement de tout effet et conduit à un réexamen d’ensemble par la cour. C’est la voie de recours de droit commun. Seules les décisions de faible importance sont rendues en dernier ressort, sans possibilité d’appel.
Arrêtés. Les arrêtés sont les dispositions réglementaires, prises en application d’un décret, et la compétence revient aux chefs d’administration : ministre dans un ministère, préfet dans un département, recteur dans une académie, directeur dans un hôpital, maire dans la commune. La compétence pour signer un arrêté doit être prévue par un décret, et les arrêtés doivent respecter le contenue des décrets, des lois et des normes supérieures du droit.
Audience. Après la phase d’instruction pénale, et si les charges sont établies, l’affaire est renvoyée en audience de jugement. L’audience pénale est publique, la garantie d’une bonne justice dépendant autant de la qualité de l’enquête et du caractère public de l’audience. La personne poursuivie peut faire citer des témoins. L’instruction doit être reprise oralement à l’audience. Le prévenu est libre de ses déclarations, et la défense doit avoir la parole en dernier.
Avocat. L’avocat est un professionnel du droit qui exerce une fonction de conseil et de défense, selon un statut garantissant son indépendance. Les avocats doivent être inscrits à un Barreau, qui assure un encadrement administratif et disciplinaire de la profession, sous le contrôle des juges de la cour d’appel. Il existe une grande diversité de modes d’exercice et de compétences, et lorsqu’il est sollicité par un client, l’avocat doit, avant de s’engager dans la mission, adresser une consultation, qui qui a grands traits décrit son analyse du droit les diligences qu’il compte effectuer, et les conditions financières de son intervention.
Avocat général. L’avocat général et un magistrat de l’ordre judiciaire, membre du parquet près de la cour d’appel, exerçant sous l’autorité du Procureur général.
B
Barreau. Le Barreau est le regroupement des avocats exerçant dans un secteur géographique, le plus souvent auprès d’un tribunal. Le barreau est géré par un conseil de l’ordre élu, et présidée par le Bâtonnier, lui aussi élu par l’assemblée générale des avocats.
C
Cassation. Un arrêt de cour d’appel peut être contesté par un pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire. Elle contrôle à partir des faits, qui sont réputés définitivement acquis, si la règle de droit a été correctement appliquée. Si l’application du droit est conforme, l’arrêt est confirmé. Si la cour d’appel a commis une erreur de droit, la Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie la procédure à une autre cour d’appel qui devra tenir compte de la règle de droit posée par la Cour de cassation.
Circulaire. Les circulaires sont des textes interprétatifs, émanant de l’autorité hiérarchique, qui expliquent ou rappellent l’état du droit. Dans les services, elles doivent être respectées comme des consignes par les agents du service, mais elles n’ont qu’une valeur indicative vis-à-vis des tiers. Les circulaires sont attendues car elles ont cherchent à donner une lecture claire du droit. Le travers est que sous réserve d’explication, les circulaires comprennent souvent des éléments qui excèdent le cadre défini par les textes, et qui tendent à s’imposer dans les faits.
Code. Le code est un mode de regroupement des lois et décrets, Mais, le fait qu’un un texte soit codifié ne modifie pas sa valeur d’origine : il garde sa valeur législative ou réglementaire.
Codification. Au sein des codes, les lois sont reconnaissables par la lettre L qui précède le numéro de l’article. Les décrets les plus importants, dit décrets en Conseil d’Etat, sont précédés de la lettre R et les décrets simples de la lettre D. Les codes reposent sur une numérotation d’ensemble, les dispositions en L et en R se correspondant. Un article L. 2134-5 se situe dans la deuxième partie du code, livre premier, titre trois, chapitre quatre et c’est l’article cinq de ce chapitre. S’il existe un texte d’application, il portera le numéro R. 2134-5.
Contrat. Un contrat est un engagement librement souscrit par deux personnes qui en définissent le contenu. On affirme ainsi que « le contrat est la loi des parties ». Cette capacité de conclure des contrats doit toutefois composer avec les normes objectives du droit, c’est-à-dire le cadrage législatif des contrats. Il existe très souvent un déséquilibre dans les situations contractuelles, et le législateur veille donc à rétablir un équilibre. Ainsi, les parties peuvent décider ou non de signer un contrat de bail, et apporter quelques dispositions spécifiques, mais l’essentiel des droits et obligations résultent de l’application de la loi/
Conseil constitutionnel. Le texte loi voté est soumis à un délai de carence de dix jours pendant lequel le président de la République, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale ou le président du Sénat, ou encore un groupe de soixante parlementaires peut saisir le Conseil constitutionnel, si certaines dispositions votées leur paraissent contraires au droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut valider la loi, ou l’annuler, totalement ou partiellement. Si la loi partiellement invalidée reste cohérente, elle peut être publiée au Journal officiel. Si la loi est annulée sur des points essentiels, elle est abandonnée.
Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe, créé en 1951, qui regroupe à ce jour quarante-huit Etats, a pour objet la défense de l’idéal démocratique et des valeurs de l’humanisme. Les outils privilégiés sont d’une part la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg, et d’autre part la Charte sociale européenne et le Comité européen des droits sociaux.
Constitution (Adoption). En règle générale, la constitution est adoptée à la suite d’un référendum. Pour les modifications importantes doit être privilégié le référendum, alors que pour des modifications plus techniques, on peut se satisfaire de la voie parlementaire, par un vote solennel des deux chambres réunies. L’Assemblée et le Sénat siègent ensemble, sous le nom de « Congrès », et se réunissent à Versailles.
Constitution (Contenu). La Constitution regroupe deux types de dispositions : les grandes déclarations de droit et l’organisation des pouvoirs publics. L’organisation des pouvoirs publics définit les principaux organes du pouvoir, liste leur compétence et organise leurs relations… La Constitution de la V° République, maintes fois réformée, laisse place à l’interprétation, et à l’adaptation. Elle a permis d’instaurer un nouveau régime en 1958, d’affronter la crise algérienne en 1962, de dépasser le mouvement revendicatif de 1968, d’assurer l’alternance politique en 1981, de gérer les cohabitations politiques et d’assumer une forte intégration européenne.
Constitution de la V° République de 1958. Notre constitution, la V°, a été adoptée en 1958 avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, sur fond de crise algérienne. La ligne directrice de la Constitution de 1958 est de renforcer l’autorité de l’exécutif en donnant la primauté aux autorités gouvernementales et en limitant le rôle du Parlement, avec une place décisive confiée au président de la République. Le système s’est trouvé considérablement renforcé en 1962 lorsqu’il a été décidé, par référendum, de faire élire le président de la République au suffrage universel direct.
Contrôle de la légalité. La structure hiérarchique des normes juridiques est une garantie pour le respect des droits et libertés. Tout texte doit s’inscrire dans « l’Etat de droit » : un traité, pour être applicable, ne peut comprendre de dispositions contraires à la constitution. De même, une loi doit respecter la constitution et les traités. Le décret doit respecter les trois étages supérieurs, et l’arrêté l’ensemble des normes. Pour garantir la qualité du droit et éviter les abus de pouvoir, les textes doivent être soumis à toutes les critiques.
Contrôle judiciaire et détention provisoire. Pendant l’enquête judiciaire, il peut apparaître nécessaire au juge d’instruction que soient prises des mesures pour garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne poursuivie. Ce sont les procédés du contrôle judiciaire – assignation à résidence, versement d’une somme d’argent à titre de caution, interdiction de rencontrer tel ou tel témoin, interdiction d’exercer telle ou telle fonction… – ou de la détention provisoire.
Cour de Justice de l’Union Européenne. Cette juridiction, dont le siège est à Luxembourg, relève de l’Union européenne, qui regroupe 27 Etats. Elle peut être saisie par les Etats, par toute personne morale et par tout citoyen, mais les règles de recevabilité sont strictes, pour éviter un ensevelissement de la Cour sous les recours. La Cour peut aussi être saisie par une juridiction nationale, pour obtenir interprétation de la Cour sur les textes de droit européen, par le procédé de la « question préjudicielle ».
Cour européenne des droits de l’homme. Cette juridiction, dont le siège est à Strasbourg, relève du Conseil de l’Europe, qui regroupe 47 Etats. Elle peut être saisie par tout Etat ou par tout citoyen estimant qu’en droit interne sont violées les dispositions de la Convention européenne. La Convention, et surtout la jurisprudence de la Cour, peuvent être invoquées devant tout juge national. De fait, nombre de situations qui étaient bloquées en droit interne, ont évolué sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour.
D
Décisions de justice. Les tribunaux rendent des jugements. Les cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat des arrêts. Les ordonnances sont rendues par les juges uniques : juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des référés…
Déclarations de droits. Ces déclarations constitutionnelles, qui sont la référence pour tous les autres textes, sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte sur l’environnement de 2005. Par le jeu du contrôle de constitutionnalité, les lois sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel et à partir de ces textes généraux, s’élabore un corps de principes tout-à-fait actuels. L’activité du législateur est ainsi encadrée.
Décrets. Les décrets sont des textes pris en application des lois. Des décrets sont signés que par le Président de la République, notamment pour les nominations les plus importantes, mais le plus grand nombre – les décrets réglementaires, mesures d’application des lois – sont signés par le premier ministre, et cosignés par les ministres concernés.
Démocratie. Tout citoyen d’un Etat doit participer à la délibération commune qui vise à édicter les règles de droit. La démocratie confère ce pouvoir au peuple dans son entier, via des élections libres et le principe de la majorité. Mais la majorité peut s’aveugler et voter des lois liberticides. Aussi, l’adoption des lois est soumise à des mécanismes d’encadrement par les principes fondamentaux du droit
Droit européen. Les textes européens sont des traités, et ils ont une valeur supérieure à la loi. Si un plaideur a la conviction que le juge national a mal appliqué le droit européen, il peut avoir, après avoir passé toutes les étapes du droit interne – jugement, appel, cassation – saisir l’une des deux cours européennes : Cour Européenne des Droits de l’Homme (Strasbourg) pour le droit de l’Union européenne, ou Cour de Justice de l’Union Européenne (Luxembourg) pour le droit du Conseil de l’Europe. Mais surtout, il peut devant le juge national et dès la première instance, demander l’application des textes européens et de la jurisprudence européenne, et se servir de ces normes supranationales pour contester la validité d’une loi ou d’un décret.
Droit pénal. La démarche du droit pénal est universelle : le législateur reconnaît qu’un certain nombre de notions fondamentales méritent d’être protégées en elles-mêmes, indépendamment d’une action de la victime. Fondamentalement, l’action pénale est une action publique. Aussi, la maîtrise du procès pénal est confiée à un corps de magistrats, les procureurs.
Droits de la défense. La procédure vise à respecter les droits de la défense : être avisé suffisamment à l’avance, connaître les griefs, disposer du temps nécessaire pour s’organiser, être assisté d’un avocat, connaître les pièces qui fondent les griefs, soulever des moyens auxquels le tribunal devra répondre, disposer de voies de recours. La personne en cause doit également bénéficier de garanties dans la tenue de l’audience avec la possibilité de se taire – c’est le droit au silence, au nom duquel le fait de ne pas avouer n’aggrave pas la sanction – d’être entendu, de faire citer ses témoins, et ce dans le cadre d’une audience publique.
Droits des enfants. La Convention internationale sur les droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 dans le cadre de l’ONU, permet à tout enfant se trouvant sur le territoire d’un Etat signataire de voir ses droits garantis quelle que soit sa situation personnelle : nationalité, race, religion, situation des parents,… L’enfant est titulaire de droits dont l’exercice est étant assuré par les parents. Dès lors, des procédés et garanties doivent être institués pour permettre le bon exercice des droits parentaux, et des modes d’intervention publics doivent prendre le relais en cas de carence des parents. Depuis la loi du 4 mars 2002, un mineur peut demander à être soigné sans que ses parents soient avisés.
E
Etat de droit. L’Etat de droit, qui garantit les libertés publiques, résulte de la combinaison de deux mécanismes : la hiérarchie des normes – constitution, traité, loi, décret, arrêté – et un contrôle par le juge. Tout décision juridique doit s’inscrire dans le respect des principes, et sa validité doit pouvoir être contrôlée devant un tribunal.
Etat. La vie juridique est structurée au regard de l’Etat, qui est la référence en droit international et interne. L’Etat est souverain dans ses frontières et ne peut subir une ingérence étrangère. Un Etat existe lorsque sont réunis trois critères : une population, un territoire, un pouvoir organisé. Lorsque ces trois critères sont réunis, les autorités se revendiquent comme Etat, sont reconnus par d’autres Etats et sollicitent leur admission à l’ONU.
Europe. En droit, il n’y a pas une Europe mais deux : l’Union européenne, 27 Etats réunis dans une optique essentiellement économique et sociale, et le Conseil de l’Europe, qui regroupe 47 Etats et dont l’objet est la défense de l’idéal démocratique et les droits de l’homme.
F
G
Grâce. La grâce est une mesure individuelle qui relève de la compétence du chef de l’Etat. Il s’agit d’une mesure discrétionnaire, c’est-à-dire qui n’a pas à être motivée, et dont les effets peuvent être partiels ou généraux. Le chef de l’Etat peut être saisi d’une demande de grâce à propos de toute sanction, pénale ou disciplinaire.
I
Information judiciaire. Phase d’instruction d’un dossier pénal, confiée à un juge d’instruction.
J
Juges du siège. Les magistrats qui ont pour mission de juger sont les juges du siège : président du tribunal, président de chambre, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des enfants… Ces magistrats disposent d’un ensemble de garanties de carrière qui assurent leur indépendance. La plus significative de ces mesures est la règle de l’inamovibilité : un juge ne peut être déplacé d’office, mais seulement s’il en a fait la demande. En l’état actuel, l’indépendance des juges du siège est acquise.
Juridiction. La référence est donnée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Un tribunal doit être indépendant et impartial : indépendant, car il ne doit pas être lié à un organe administratif ; impartial, car le statut de ses membres doit les garantir de tout risque d’implication personnelle dans le procès.
Juridictions administratives. Lorsqu’est en cause l’Etat, une administration publique ou une collectivité locale, la compétence juridictionnelle revient aux juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat.
Juridictions judiciaires. Pour les affaires de droit privé, c’est-à-dire opposant des personnes physiques, ou les personnes morales de droit privé, telles que les associations, les syndicats ou les sociétés, la compétence revient aux juridictions judiciaires : tribunal de grande instance, cour d’appel, et Cour de cassation.
Juridictions pénales. Le contentieux pénal est confié aux juridictions judiciaires, saisies par le procureur de la République. Le tribunal de grande instance, formation civile, complété par le procureur de la République, devient le tribunal correctionnel, compétent à l’égard de tout citoyen. Praticien public ou libéral, un médecin peut être cité en correctionnelle si sa responsabilité pénale est recherchée. Le statut juridique est égalitaire sur le plan pénal, et les distinctions n’interviennent que sur le plan civil.
Juridictions. Pour des raisons historiques, la France connaît deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires, pour les affaires privées, et les juridictions administratives, pour le secteur public. Mais, comme le droit médical relève du privé et du public, il faut combiner les deux contentieux… Si une faute été commise dans un établissement public, c’est le tribunal administratif qui en connaîtra, et si elle l’a été à l’occasion d’un exercice libéral ou dans une clinique, la compétence reviendra au tribunal de grande instance. Alors qu’il y a identité du droit applicable et de la qualité attendue, cette dualité juridictionnelle est une source de complication qui ne doit son existence qu’à l’histoire.
Jurisprudence. La jurisprudence est d’abord un phénomène général. Au sens premier, il s’agit de l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Au sein de cet ensemble, quelques décisions font référence du fait de l’importance du sujet qu’elles traitent ou de l’autorité de la juridiction qui s’est prononcée, par exemple de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat. On dit alors que cette décision « fait » jurisprudence.
L
Loi (Adoption). Le texte est voté par l’Assemblée Nationale, puis soumis au Sénat. Si le Sénat rejette le texte ou adopte une version différente, l’Assemblée Nationale est à nouveau saisie. Ce jeu de la « navette » se poursuit jusqu’à l’obtention d’un accord. Le gouvernement peut interrompre le processus en saisissant une commission mixte paritaire composée à égalité de représentants de chacune des chambres. Si cette commission ne parvient pas à trouver le consensus, la parole revient en dernier lieu à l’Assemblée Nationale.
Loi (Origine). L’initiative d’un nouveau texte peut être parlementaire : c’est une proposition de loi. Le plus souvent l’origine est gouvernementale : c’est un projet de loi. Les projets de loi sont adoptés en conseil des ministres puis inscrits à l’ordre du jour du Parlement à l’initiative du gouvernement. De fait, l’immense majorité des lois est d’origine gouvernementale, et c’est le gouvernement qui, de fait, établit le calendrier du Parlement.
Loi. La loi se définit comme l’acte du Parlement, c’est-à-dire le texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux assemblées, qui constituent la représentation nationale.
M
Mise en examen. Lorsqu’apparaissent à l’encontre d’une personne des indices précis et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’une infraction, celle-ci doit être mise en mesure de se défendre. La mise en examen, mesure sévère, est aussi une mesure protectrice car la personne devient partie au procès et accède aux droits de la défense. Elle peut désigner un avocat qui a accès au dossier et peut en prendre copie. La personne mise en examen ne peut plus être entendue par la police mais seulement par le juge, en présence de son avocat, et avec une convocation respectant un délai suffisant pour permettre à la défense de s’organiser (Code de procédure pénale, Art. 80-1).
O
Ordonnance. Le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement, qui se prononce sous forme d’ordonnance. Une ordonnance a la valeur d’une loi. Le recours aux ordonnances est un signe de fragilité du gouvernement qui redoute le débat devant les assemblées parlementaires, et préfère se faire habiliter.
P
Préfet. Le préfet est le représentant de l’État dans une circonscription territoriale, qui peut être un département ou une région.
Prescription civile. Le temps qui passe est cause d’oubli. Au civil, un recours en responsabilité médicale ou hospitalière doit être engagé dans un délai de dix ans après l’apparition du dommage.
Prescription pénale. Les poursuites doivent être engagées pour les contraventions dans un délai de deux ans, pour les délits dans un délai de six ans et pour les crimes dans un délai de vingt ans. Ces délais peuvent être suspendus ou interrompus par des actes de procédure.
Présomption d’innocence. Toute personne qui ne fait pas l’objet d’une condamnation définitive, rendue par un tribunal indépendant et impartial est innocente. La sanction pénale, qui identifie un comportement antisocial, est d’une importance telle que la culpabilité ne peut être reconnue que lorsqu’elle résulte d’un jugement définitif, rendu par à la suite d’une procédure équitable. Cette règle n’interdit pas de parler des faits et de donner des opinions, mais on ne peut présenter comme coupable une personne seulement accusée.
Principe de la non-rétroactivité. La loi pénale ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. C’est une condition décisive du respect des libertés individuelles. Ne peuvent être poursuivies que des infractions qui étaient légalement définies au moment des faits.
Principe de légalité des délits et des peines. Ne peuvent être sanctionnées pénalement que les comportements définis par la loi, et ne peuvent être prononcées par les juridictions que les sanctions prévues par la loi. Si la répression pénale, qui est d’ordre général, entre en jeu, c’est que des comportements ont été suffisamment graves pour troubler l’ordre public. Aussi, le législateur doit identifier au préalable ces comportements en leur donnant une définition stricte, à travers les éléments constitutifs de l’infraction.
Privation de liberté. Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire (CSP, Art. 4127-10).
Procédure. La justice ne peut être rendue sans le respect de garanties de forme, qui sont le moyen du respect des droits. La mise en œuvre de ces règles se traduit parfois par des formalités contraignantes, mais on ne peut s’écarter du principe : pas de justice sans procès, pas de procès sans procédure.
Procureur (Fonction). L’initiative de l’action pénale revient au procureur de la République, maître de l’opportunité des poursuites. Tant qu’il s’agit de promouvoir une politique générale, l’accord est unanime pour défendre le rôle directif du ministère de la justice. La question devient plus délicate lorsqu’il s’agit d’instructions individuelles, et deux thèses s’opposent : pour la première, une immixtion dans la conduite des affaires individuelles est inopportune ; pour la seconde, le gouvernement ne peut se désintéresser du suivi d’affaires importantes et sensibles, et il est préférable que cette intervention ait lieu clairement. La CEDH a jugé que le Parquet en France était trop lié au pouvoir exécutif. A terme, une réponse devra être trouvée, car l’ensemble des mesures judiciaires se trouveraient transférées au juge du Siège, si le statut du Parquet n’évoluait pas vers plus d’indépendance.
Procureur (Statut). Les procureurs de la République sont organisés en un système hiérarchique dénommé « le Parquet », placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Il existe auprès de chaque tribunal de grande instance un procureur de la République, assisté de substituts. Au niveau de la Cour d’appel, le responsable du Parquet est le procureur général, assisté d’avocats généraux, et l’on retrouve un parquet général auprès de la Cour de cassation.
Protection fonctionnelle. Mis en cause à l’occasion de faits survenus dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, un agent de la fonction publique bénéficie de la protection fonctionnelle, c’est-à-dire de l’assistance par un avocat librement choisi et dont les honoraires sont pris en charge par l’employeur. Pour les fautes involontaires, comme la maladresse ou l’inattention, cette protection fonctionnelle est de droit, et elle permet au praticien d’assurer sa défense dans les meilleures conditions. De même, l’hôpital conserve la charge de la responsabilité civile, en indemnisation (Statut général, Art. 11).
R
Recours en légalité. Un ensemble de recours existe pour faire respecter « l’Etat de droit ». Tout citoyen ou personne morale intéressée peut attaquer un décret ou un arrêté devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif, dans le délai de deux mois de sa publication. Les lois, décrets et arrêtés peuvent être soumis à l’examen des deux cours européennes (Cour Européenne des Droits de l’Homme et Cour de Justice de l’Union Européenne) ou devant le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours en annulation contre une disposition législative qui leur apparaît contraire à la constitution. Chaque citoyen peut, avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), invoquer à l’occasion d’un procès la constitutionnalité de la loi, et si le juge estime la question sérieuse, il doit saisir le Conseil constitutionnel.
T
Traité. Un Etat conclut des accords internationaux, les traités, par lesquels il s’engage vis-à-vis d’autres Etats. Il en résulte des contraintes juridiques, mais il n’y a pas d’atteinte à la souveraineté car ces limitations sont librement consenties.
U
Union européenne (Institutions). L’Union européenne, c’est à ce jour le regroupement volontaire de vingt-sept Etats à travers cinq structures : le Conseil de l’Union européenne, qui regroupe dans un cadre collégial tous les chefs de gouvernement européens ; la Commission de Bruxelles, organe exécutif permanent, composé de hauts dirigeants politiques désignés par les Etats ; le Parlement qui siège à Strasbourg et à Bruxelles ; la Cour de Justice de l’Union Européenne, installée à Luxembourg ; un haut représentant pour les affaires étrangères. De grands traités, le fondateur de Rome en 1957, de portée essentiellement économique, ou le refondateur de Maastricht en 1990, ouvrant la voie à une Europe politique, puis le traité de Lisbonne de 2009 ont institué des autorités internationales avec de véritables transferts de compétence.
V
Voies de recours. Toute personne qui est en désaccord avec un jugement peut exercer des voies de recours, et principalement : appel, cassation et saisine des juridictions internationales.
Chapître 2 :
Les droits fondamentaux
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950, entrée en vigueur en 1953, est aujourd’hui ratifiée par les 47 Etats membres de cette organisation. Son respect est contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), mise en place en 1959.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’Homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Obligation de respecter les droits de l’Homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
Titre I : Droits et libertés
Article 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6 – Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Article 7 – Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 10 – Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 – Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.
Article 12 – Droit au mariage
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence
1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.
Article 17 – Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
* * *
Pour aller plus loin :
La Cour européenne des Droits de l’Homme
Le Pacte, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, est ratifié par 172 Etats.
La force juridique du Pacte
Au sein de l’ONU, s’est dégagée la volonté d’adopter un texte serait proche de la Déclaration de 1948, mais qui aurait la forme d’une référence juridique opposable. Ce texte est le Pacte des droits civils et politiques de 1966. On trouve une rédaction plus juridique et plus précise, et les Etats qui ratifient ce texte s’engagent à respecter le contenu. À l’appui, a été créé le Comité des Droits de l’Homme, composé de juristes experts, qui contrôle à espace régulier l’application du Pacte dans les Etats signataires. De plus, les Etats sont encouragés à signer un protocole additionnel qui donne à chaque ressortissant la possibilité de s’adresser au Comité des Droits de l’Homme pour lui soumettre une situation individuelle lorsqu’il estime que les juridictions de son Etat n’ont pas respecté les dispositions du Pacte.
À ce jour, le Pacte a été ratifié par 172 Etats, et le protocole additionnel par 115. Ceci confère au Comité des Droits de l’Homme un rôle considérable, telle une véritable juridiction internationale. Certes, le Comité ne condamne pas les Etats, mais les Etats se sont engagés à mettre en œuvre les décisions du Comité.
Pour ce qui concerne la France, ont été ratifiés le Pacte et le protocole additionnel. De telle sorte, chaque ressortissant, après avoir épuisé les voies de recours internes, peut s’adresser directement au Comité des Droits de l’Homme. Par ailleurs, les lois votées doivent respecter les dispositions du Pacte, et la jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme peut être invoquée devant le juge interne, avec une autorité supérieure à celle de la loi. Selon l’article 2 du Pacte, les Etats signataires « s’engagent à respecter et à garantir » les droits reconnus dans le Pacte, et à prendre les mesures « propres à donner effet » à ces droits. » Dans son observation générale n° 31 (Observation générale n° 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004) le Comité souligne :
« 13. Le paragraphe 2 de l’article 2 fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans l’ordre interne aux droits énoncés dans le Pacte. Il s’ensuit que si les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas déjà protégés par les lois ou les pratiques internes, les États parties sont tenus, lorsqu’ils ont ratifié le Pacte, de modifier leurs lois et leurs pratiques de manière à les mettre en conformité avec le Pacte. Dans les cas où il existe des discordances entre le droit interne et le Pacte, l’article 2 exige que la législation et la pratique nationales soient alignées sur les normes imposées au regard des droits garantis par le Pacte ».
Le texte du Pacte
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;
c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.
* * *
Pour aller plus loin :
Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, et ratifiée par 165 Etats.
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 7
1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
* * *
A voir aussi
Le Comité contre la torture, un organe composé de 10 experts indépendants qui surveille l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les États parties.
* * *
Pour aller plus loin
Le rapporteur spécial pour la torture
La Torture en Droit International, guide de jurisprudence Publié conjointement par l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) et le Center for Justice and International Law (CEJIL) en 2008.
Jurisprudence de la CJUE, 24 avril 2018 [GC], affaire C-353/16, MP c. Royaume-Uni
Texte
Selon l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Principe
Le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention ne souffre aucune dérogation ; toutefois, la définition de cette notion ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais elle est au contraire fonction des circonstances propres à chaque affaire (CEDH, O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], nos 15809/02 et 25624/02, § 53). Il s’agit de déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (CEDH, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84 ; CEDH, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 101).
La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24 ; CEDH, Imbrioscia, § 38).
Jugement des actes de terrorisme
Les exigences générales d’équité posées à l’article 6 s’appliquent à toutes les procédures pénales, quel que soit le type d’infraction concerné. Il est hors de question que les droits tenant à l’équité du procès soient atténués pour la seule raison que les personnes concernées sont soupçonnées d’être mêlées à des actes de terrorisme. En ces temps difficiles, la CEDH estime primordial que les Parties contractantes manifestent leur engagement pour les droits de l’homme et la prééminence du droit en veillant au respect, notamment, des garanties minimales offertes par l’article 6 de la Convention.
Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, le poids de l’intérêt public à la poursuite de l’infraction particulière en question et à la sanction de son auteur peut être pris en considération (CEDH, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 97). Il ne faut pas appliquer l’article 6 d’une manière qui causerait aux autorités de police des difficultés excessives pour combattre par des mesures effectives le terrorisme et d’autres crimes graves, comme elles doivent le faire pour honorer l’obligation, découlant pour elles des articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention, de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique des membres de la population (CEDH, Sher et autres c. Royaume-Uni, no 5201/11, § 149), mais les préoccupations d’intérêt général ne sauraient justifier des mesures vidant de leur substance même les droits de la défense d’un requérant (CEDH, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 93, 10 mars 2009 ; CEDH, Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, § 39, 18 février 2010).
Droit de prendre part à l’audience
La comparution d‘un prévenu revêt une importance capitale dans l‘intérêt d‘un procès pénal équitable et juste (CEDH, Lala c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 33 ; CEDH, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 35 ; CEDH, De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004), et l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience est l‘un des éléments essentiels de l‘article 6 (CEDH, Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005).
La comparution personnelle du prévenu ne revêt pourtant pas la même importance décisive en appel qu’au premier degré (CEDH, Kamasinski, no 9783/82, 19 décembre 1989 § 106). Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l‘ordre juridique interne et le rôle qu‘y a joué la juridiction d‘appel (CEDH, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 27 ; CEDH, Monnell et Morris c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 56).
La présence de l’accusé aux débats d’appel est nécessaire lorsque la cause ne pouvait bien se résoudre sans une appréciation directe des témoignages personnels du requérant et du plaignant, la cour d‘appel étant appelée à trancher, au principal, quant à la culpabilité ou l‘innocence du prévenu (CEDH, Dondarini, § 28 ; CEDH, De Biagi c. Saint-Marin, no 36451/97, § 23, 15 juillet 2003).
Droit de l’accusé d‘être informé des accusations portées contre lui
Aux termes du paragraphe 3 a) de l‘article 6 de la Convention, tout accusé a le droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu‘il comprend et d‘une manière détaillée, de la nature et de la cause de l‘accusation portée contre lui ».
Si elle ne spécifie pas qu‘il échet de fournir ou traduire par écrit à un inculpé étranger les renseignements pertinents, cette disposition montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l‘intéressé. L’acte d‘accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, l‘inculpé est officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui. Un accusé à qui la langue employée par le tribunal n’est pas familière peut en pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi une traduction de l‘acte d‘accusation, établie dans un idiome qu‘il comprenne (CEDH, Sejdovic, § 89 ; CEDH, Kamasinski, § 79 ; CEDH, Tabaï c. France (déc.), no 73805/01, 17 février 2004 ; CEDH, Vakili Rad c. France, no 31222/96, 10 septembre 1997).
Eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (CEDH, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25 ), l‘article 6 de la Convention implique pour toute juridiction nationale l‘obligation de vérifier si l‘accusé a eu la possibilité d‘avoir connaissance de la date de l‘audience et des démarches nécessaires pour y participer lorsque, comme en l’espèce, surgit sur ce point une contestation qui n‘apparaît pas d‘emblée manifestement dépourvue de sérieux (CEDH, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 72, CEDH 2004-IV). Il en va de même dans le cas de procédures simplifiées telles que la procédure abrégée, où l‘accusé renonce à certains de ses droits.
Droit à un interprète
Le paragraphe 3 e) de l‘article 6 proclame le droit à l‘assistance gratuite d‘un interprète. Ce droit ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l‘audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l‘instruction préparatoire. La disposition en question signifie que l‘accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d‘un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal (CEDH, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, 28 novembre 1978, § 48).
Une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (CEDH, Husain c. Italie (déc.), no 18913/03), mais l’assistance prêtée en matière d‘interprétation doit permettre à l‘accusé de savoir ce qu‘on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (Güngör c. Allemagne (déc.), no 31540/96, 17 mai 2001). Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L‘obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d‘exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l‘interprétation assurée (CEDH, Kamasinski, § 74).
Assistance par un avocat
Pour exercer ses droits, l’accusé doit pouvoir en principe bénéficier effectivement de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de la procédure pénale, car une législation nationale peut attacher à son attitude au cours de la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de la suite de la procédure (CEDH, Salduz, 27 novembre 2008, 36391/02, § 52). En outre, l’accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable lors de cette phase, vulnérabilité qui, dans la plupart des cas, ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à veiller au respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même (CEDH, Salduz § 54 ; CEDH, Pavlenko c. Russie, no 42371/02, § 101, 1er avril 2010).
Dès les premiers stades de la procédure, un accusé qui ne souhaite pas se défendre lui-même doit pouvoir recourir aux services d’un défenseur de son choix (CEDH, Martin c. Estonie, no 35985/09, §§ 90 et 93, 30 mai 2013). C’est ce qui découle du libellé même de l’article 6 § 3 c), qui garantit à tout accusé le droit à se défendre avec l’assistance d’un défenseur de son choix. L’équité de la procédure exige que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil (CEDH, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, 13 octobre 2009).
Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure « concret et effectif », il faut en principe que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque de telles raisons peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment léser l’accusé dans ses droits découlant de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi en l’absence d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (CEDH, Salduz, §§ 55-57 ; CEDH, Panovits c. Chypre, no 4268/04, § 66, 11 décembre 2008).
Preuves et témoins
La procédure pénale doit globalement revêtir un caractère équitable, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis (CEDH, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, CEDH 2010). La procédure doit respecter non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis (CEDH, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 163 et 175).
Avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire (CEDH, 15 décembre 2011 Al-Khawaja et Tahery, § 118).
Il faut souligner l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase fixent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée lors de l’audience (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54).
Pour examiner si l’absence d’un témoin est préjudiciable, il faut rechercher (CEDH, Al-Khawaja et Tahery) :
- s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition (§§ 119-125) ;
- si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (§§ 119 et 126-147) ; et
- s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble (§ 147).
Motivation
Les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26).
Pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef l’accusé, doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, comme la Cour l’a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (CEDH, Lhermitte c. Belgique [GC], no34238/09, §§ 66 et 67 ; CEDH, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 116). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique (CEDH, Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003 ; CEDH, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58).
Les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (CEDH, Hadjianastassiou c. Grèce, no 12945/87, 16 décembre 1992, § 33). La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois, l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (CEDH, Ruiz Torija, § 29). Si les tribunaux ne sont pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé, il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (CEDH, Boldea c. Roumanie, no19997/02, § 30, 15 février 2007).
Selon l’article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit ».
La jurisprudence de la Cour résulte des affaires Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, 18 juin 2013) et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie ([GC], no 47848/08, CEDH 2014).
Principe
Pour saisir la CEDH, un requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention. La notion de « victime », selon la jurisprudence constante de la Cour, doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (Nencheva et autres, § 88).
Une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse (CEDH, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 33 ; CEDH, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52). Cette condition est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention, même si ce critère ne doit pas s’appliquer de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure (CEDH, Fairfield et autres c. Royaume-Uni, no 24790/04).
Victimes indirectes
Ce principe connaît une exception lorsque la ou les violations invoquées de la Convention sont étroitement liées à des disparitions ou décès dans des circonstances dont il est allégué qu’elles engagent la responsabilité de l’État. Dans de tels cas, en effet, la Cour reconnaît aux proches parents de la victime la qualité pour soumettre une requête (CEDH, Nencheva et autres, § 89, ; CEDH, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, §§ 98-99).
Dans des cas où le requérant était décédé après l’introduction de la requête, la Cour a admis qu’un proche parent ou un héritier pouvait en principe poursuivre la procédure dès lors qu’il avait un intérêt suffisant dans l’affaire (Veuve et enfants : CEDH, Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2 ; CEDH, Stojkovic c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 14818/02, 8 novembre 2007, § 25 ; Parents : CEDH, X c. France, 31 mars 1992, § 26 ; compagne non mariée : CEDH, Velikova c. Bulgarie (déc.), no 41488/98 ).
La situation est en revanche variable lorsque la victime directe est décédée avant l’introduction de la requête devant la Cour. En pareil cas, la Cour, s’appuyant sur une interprétation autonome de la notion de « victime », s’est montrée disposée à reconnaître la qualité pour agir d’un proche soit parce que les griefs soulevaient une question d’intérêt général touchant au « respect des droits de l’homme » (article 37 § 1 in fine de la Convention) et que les requérants en tant qu’héritiers avaient un intérêt légitime à maintenir la requête, soit en raison d’un effet direct sur les propres droits du requérant (CEDH, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 44-51 ; CEDH, Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, no 55929/00, §§ 21-31, 5 juillet 2005).
La Cour a ainsi reconnu à un proche de la victime la qualité pour soumettre une requête lorsque la victime était décédée ou avait disparu dans des circonstances dont il était allégué qu’elles engageaient la responsabilité de l’État (CEDH, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 92 ; CEDH, Bazorkina c. Russie, no 69481/01, 15 septembre 2005).
Dans l’affaire S.P., D.P. et A.T. c. Royaume-Uni (no 23715/94, 20 mai 1996), qui portait notamment sur l’article 8 de la Convention, la Commission a admis la requête introduite par un solicitor au nom d’enfants qu’il avait représentés dans la procédure interne, dans laquelle il avait été désigné par le tuteur ad litem, après avoir relevé notamment que leur mère s’en désintéressait, que les autorités locales étaient critiquées dans la requête et qu’il n’y avait pas d’opposition d’intérêts entre le solicitor et les enfants.
Dans l’affaire İlhan c. Turquie ([GC] (no 22277/93, §§ 54-55), dans laquelle la victime directe souffrait de séquelles graves résultant de mauvais traitements infligés par les forces de sécurité, la Cour a estimé que la requête fondée sur les articles 2 et 3 de la Convention était valablement introduite par son frère, dès lors qu’il résultait des faits que la victime avait consenti à l’engagement de la requête, qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre ellemême et son frère, qui avait été touché de près par l’incident, et qu’elle était dans une situation particulièrement vulnérable en raison des séquelles dont elle souffrait.
Dans l’affaire Y.F. c. Turquie (no 24209/94, § 31), dans laquelle un mari se plaignait, en invoquant l’article 8 de la Convention, que son épouse ait été forcée de subir un examen gynécologique à l’issue de sa garde à vue, la Cour a considéré qu’il était loisible au requérant, en tant que proche de la victime, de soulever un grief concernant les violations alléguées de la Convention formulées par son épouse, compte tenu en particulier de la situation vulnérable dans laquelle elle s’était trouvée dans les circonstances particulières de l’espèce.
Par ailleurs, toujours dans le contexte de l’article 8 de la Convention, la Cour a admis à plusieurs reprises que des parents qui n’avaient pas de droits parentaux puissent la saisir au nom de leurs enfants mineurs (CEDH, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 138-139 ; CEDH, Šneersone et Kampanella c. Italie, no 14737/09, § 61, 12 juillet 2011 ; CEDH, Diamante et Pelliccioni c. Saint Marin, no 32250/08, §§ 146-147, 27 septembre 2011 ; CEDH, A.K. et L. c. Croatie, no 37956/11, §§ 48-50, 8 janvier 2013 ; CEDH, Raw et autres c. France, no 10131/11, §§ 51-52, 7 mars 2013). Le critère essentiel qu’elle a retenu dans ces affaires était le risque que certains intérêts des mineurs ne soient pas portés à son attention et qu’ils soient privés d’une protection effective des droits qu’ils tirent de la Convention.
Enfin, la Cour a adopté une approche similaire dans l’affaire Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu (§ 112), qui concernait un jeune homme d’origine rom gravement handicapé et séropositif décédé à l’hôpital avant l’introduction de la requête, sans proches connus et sans que l’État lui ait désigné de représentant. Au vu des circonstances exceptionnelles de l’espèce et de la gravité des allégations formulées, la Cour a reconnu au Centre de ressources juridiques la qualité pour représenter Valentin Câmpeanu, en soulignant que conclure autrement reviendrait à empêcher que ces graves allégations de violation de la Convention puissent être examinées au niveau international :
« Dans le contexte qu’elle vient d’exposer, la Cour est convaincue qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations formulées, le CRJ doit se voir reconnaître la faculté d’agir en qualité de représentant de M. Câmpeanu, même s’il n’a pas reçu procuration pour agir au nom du jeune homme et si celui-ci est décédé avant l’introduction de la requête fondée sur la Convention. Conclure autrement reviendrait à empêcher que ces graves allégations de violation de la Convention puissent être examinées au niveau international, avec le risque que l’État défendeur échappe à sa responsabilité découlant de la Convention par l’effet même de la non-désignation par lui, au mépris des obligations qui lui incombaient en vertu du droit interne, d’un représentant légal chargé d’agir au nom du jeune homme (CEDH, Argeş College of Legal Advisers c. Roumanie, no 2162/05, § 26, 8 mars 2011). Permettre à l’État défendeur d’échapper ainsi à sa responsabilité serait incompatible avec l’esprit général de la Convention et avec l’obligation que l’article 34 de la Convention fait aux Hautes Parties contractantes de n’entraver en aucune manière l’exercice effectif du droit d’introduire une requête devant la Cour.
Victimes potentielles et actio popularis
L’article 34 de la Convention n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention. Celle-ci ne reconnaît pas l’actio popularis (CEDH, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 33 ; CEDH, Parti travailliste géorgien c. Géorgie (déc.), no 9103/04, 22 mai 2007), ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention.
Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (CEDH, Tauira et 18 autres c. France, no 28204/95, 4 décembre 1995 ; CEDH, Monnat c. Suisse, no 73604/01, §§ 31-32).
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Principe sans exceptions
La Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, d’après l’article 15 § 2 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (CEDH, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95 ; CEDH, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119 ).
Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79) et même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (CEDH, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95 ; CEDH, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119). La nature de l’infraction qui est reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (CEDH, Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69 ; CEDH, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116 ; CEDH, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127).
Gravité
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (CEDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162 ; CEDH, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67). Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré (CEDH, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64 ; CEDH, Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 78 ; CEDH, Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004), ainsi que son contexte, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle (CEDH, Selmouni, § 104 ; CEDH, Egmez, § 78).
Traitement inhumain
La Cour a jugé un traitement inhumain au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (CEDH, Labita, § 120 ; CEDH, Ramirez Sanchez, § 118).
Traitement dégradant
La Cour a défini un traitement dégradant comme étant de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir (CEDH, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92) et briser éventuellement la résistance physique ou morale de la personne qui en est victime, ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (CEDH, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110 ; CEDH, Jalloh, § 68). La Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci de manière incompatible avec l’article 3. Même l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (CEDH, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 101).
Torture
Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la distinction que comporte l’article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction a été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances, distinction qui ressort également de l’article 1er de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CEDH, Selmouni, § 97) :
« Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
Pour déterminer si une forme de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi que la Cour l’a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (CEDH, Irlande c. Royaume-Uni, § 167 ; CEDH, Aksoy, § 63 ; CEDH, Selmouni, § 96). Outre un élément de gravité, la torture implique une volonté délibérée, ainsi que le reconnaît la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : en son article 1, elle définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements, de la punir ou de l’intimider (CEDH, Akkoç, § 115).
Un risque d’agissements prohibés par l’article 3 peut se heurter lui-même à ce texte s’il est suffisamment réel et immédiat. Ainsi, menacer quelqu’un de le torturer pourrait, dans des circonstances données, constituer pour le moins un traitement inhumain (CEDH, Campbell et Cosans, § 26).
Sanctions légitimes
La souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. L’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (CEDH, Kudła, §§ 92-94).
Peine capitale
La peine capitale, compte tenu de l’évolution et des normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l’Europe, soulève un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Lorsqu’une peine capitale est prononcée, les circonstances liées à la personnalité du condamné, à la proportionnalité à la gravité de l’infraction, ainsi qu’aux conditions de la détention vécue dans l’attente de l’exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l’article 3 le traitement ou la peine subis par l’intéressé (CEDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 104 ; CEDH, Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 133).
Aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter l’écoulement d’un certain délai entre le prononcé et l’exécution de la peine, ni les fortes tensions inhérentes au régime rigoureux d’incarcération. La condamnation à une telle peine pourrait néanmoins entraîner, dans certaines circonstances, un traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3, par exemple si elle s’accompagne d’une longue période passée dans le « couloir de la mort » dans des conditions extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale (CEDH, Soering, § 111).
Isolement en détention
L’interdiction de tout contact avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain. En revanche, l’isolement sensoriel complet, combiné à un isolement social total, peut détruire la personnalité, et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison (CEDH, Messina c. Italie, no 25498/94). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (CEDH, Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46).
Preuve
Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s’il y a eu violation de l’article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (CEDH, Jalloh, § 67 ; CEDH, Ramirez Sanchez, § 117). Lorsqu’un individu est placé en garde à vue en bonne santé mais que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible à l’origine de ces blessures, faute de quoi il se pose manifestement une question sur le terrain de l’article 3 de la Convention (CEDH, Tomasi c. France, 27 août 1992, § 110 ; CEDH, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34 ; CEDH, Aksoy, § 61 ; CEDH, Selmouni, § 87).
En cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (CEDH, Matko c. Slovénie, no 43393/98, § 100, 2 novembre 2006 ; CEDH, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (CEDH, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29 ; CEDH, Jasar c. « l’exRépublique yougoslave de Macédoine », no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins d’habitude des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des observations auxquelles ils sont parvenus.
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun (CEDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41).
Elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent une personne ou une partie de la population ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de « société démocratique » (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49 ; CEDH, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 37).
L’exercice de cette liberté est soumis à des formalités, conditions, restrictions et sanctions qui doivent s’interpréter strictement, leur nécessité devant être établie de manière convaincante (CEDH, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59 ; CEDH, Jersild c. Danemark, § 31 ; CEDH, Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 30 ; CEDH, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43).
Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse, laquelle joue un rôle éminent dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (CEDH, De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37 ; CEDH, Thoma c. Luxembourg, n° 38432/97, § 45 ; CEDH, Colombani et autres c. France, n° 51279/99, § 55).
A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (CEDH, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, série A n° 239, p. 27, § 63 ; CEDH, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39 ; CEDH, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59).
Les bornes de la liberté d’expression
Limiter la liberté d’expression est une ingérence et l’Etat doit prouver qu’elle est « nécessaire dans une société démocratique ». Vu l’importance de cette liberté, il doit être prouvé qu’elle correspond à un « besoin social impérieux », et qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), 26 avril 1979, § 62).
Pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10 (CEDH, Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 47 ; CEDH, Nilsen et Johnsen c. Norvège, § 43).
En évaluant la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (CEDH, De Haes et Gijsels c. Belgique, § 42). Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (CEDH, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76).
La liberté comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (CEDH, Bladet Tromsø et Stensaas, § 59 ; CEDH, Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38). Elle considère ainsi que l’on doit tolérer un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un tract militant – et même s’y attendre. Il reste qu’en l’espèce les allégations étaient très graves et étaient présentées comme des assertions de fait plutôt que comme des jugements de valeur.
Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d’un simple particulier. Un personnage politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes de la part des journalistes, des organisations non gouvernementales, ainsi que de la masse des citoyens, et il doit montrer une plus grande tolérance à cet égard. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (CEDH, Oberschlick c. Autriche (n° 1) §§ 57-59 ; CEDH,Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, 19 décembre 1994, § 37).
S’agissant des fonctionnaires, les limites de la critique admissible à leur encontre étaient plus larges qu’à l’encontre de simples particuliers, même si l’on ne peut pas leur appliquer les mêmes critères qu’à l’égard des hommes politiques (CEDH, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 29 ; CEDH, Janowski c. Pologne, § 33
Responsabilité des journalistes
Toute personne qui exerce sa liberté d’expression assume « des devoirs et des responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49). Malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes sont tenus de respecter les lois pénales de droit commun (CEDH, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n° 21980/93, § 65 ; CEDH, Monnat c. Suisse, n° 73604/01, § 66, CEDH 2006-X).
La protection qu’offre l’article 10 est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique (CEDH, Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 54 ; CEDH, Monnat, § 67 ; CEDH, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n° 49017/99, § 78).
Cela étant, même la presse « ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui et à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles » (CEDH Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/03, § 59).
Dans un monde dans lequel l’individu est confronté à un immense flux d’informations, circulant sur des supports traditionnels ou électroniques et impliquant un nombre d’auteurs toujours croissant, le contrôle du respect de la déontologie journalistique revêt une importance accrue (CEDH, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31 ; CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26 ; CEDH, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82 ; CEDH, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n° 46827/99 et 46951/99, § 121).
Là où la liberté de la « presse » est en jeu, les autorités ne disposent que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger de l’existence d’un « besoin social impérieux » (CEDH, Editions Plon c. France, n° 58148/00, § 44).
En outre, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58). La plus grande attention s’impose lorsque les mesures prises ou les sanctions infligées sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime (CEDH, Bladet Tromsø et Stensaas, § 64 ; CEDH, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35 ; CEDH, Stoll c. Suisse ([GC], no 69698/01, §§ 39-44).
Equilibre avec le respect de la vie privée
Un juste équilibre est à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général.
La liberté d’expression comprend la publication de photos (CEDH, Österreichischer Rundfunk c. Autriche (déc.), no 57597/00, 25 mai 2004 ; CEDH, Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, §§ 29 et 40, 14 décembre 2006). Il s’agit là néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière, les photos pouvant contenir des informations très personnelles, voire intimes, sur un individu ou sa famille (CEDH, Von Hannover, § 59 ; CEDH, Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 42, 14 juin 2007 ; CEDH, Eerikäinen et autres c. Finlande, no 3514/02, § 70, 10 février 2009).
Les photos paraissant dans la presse dite « à sensation » ou dans « la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité du public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (CEDH, Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003) sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, pouvant entraîner pour la personne concernée un sentiment très fort d’intrusion dans sa vie privée voire même de persécution (CEDH, Von Hannover, § 59).
Concernant la marge d’appréciation
La contribution à un débat d’intérêt général
Un premier élément essentiel est la contribution que la parution de photos ou d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général (CEDH, Von Hannover, § 60 ; CEDH, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, § 68). Un tel intérêt existe non seulement lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (CEDH, White, § 29 ; CEDH, Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 58, 16 avril 2009), mais également lorsqu’elle concernait des questions relatives au sport ou aux artistes de scène (CEDH, Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, no 5266/03, § 25, 22 février 2007 ; CEDH, Sapan c. Turquie, no 44102/04, § 34, 8 juin 2010).
La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage
Le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature des activités faisant l’objet du reportage et/ou de la photo constituent un autre critère important, en lien avec le précédent. A cet égard, il y a lieu de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. Ainsi, alors qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques (CEDH, Minelli c. Suisse (déc.), no 14991/02, 14 juin 2005 ; CEDH, Petrenco, § 55 ; CEDH, Von Hannover, § 63)
Le comportement antérieur de la personne concernée
Le comportement de la personne concernée avant la publication du reportage ou le fait que la photo litigieuse et les informations y afférentes ont déjà fait l’objet d’une publication auparavant constituent également des éléments à prendre en compte (CEDH, Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), §§ 52-53 ). Toutefois, le seul fait d’avoir coopéré avec la presse antérieurement n’est pas de nature à priver l’intéressé de toute protection contre la publication de la photo litigieuse (CEDH, Egeland et Hanseid, § 62).
Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
La façon dont la photo ou le reportage sont publiés et la manière dont la personne visée est représentée sur la photo ou dans le reportage peuvent également entrer en ligne de compte (CEDH, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, § 47, 13 décembre 2005 ). De même, l’ampleur de la diffusion du reportage et de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible (CEDH, Karhuvaara et Iltalehti, § 47).
Les circonstances de la prise des photos
Enfin, on ne peut faire abstraction du contexte et des circonstances dans lesquels les photos publiées ont été prises. A cet égard, il importe d’examiner la question de savoir si la personne visée a donné son consentement à la prise et à la publication des photos (CEDH, Gourguénidzé, § 56) ou si celles-ci ont été faites à son insu ou à l’aide de manœuvres frauduleuses (CEDH, Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 81, 6 avril 2010).
Principe
La liberté d’expression, définie par l’article 10, s’applique à la sphère professionnelle. Tout le problème est que si les employés jouissent du droit à la liberté d’expression, ils sont également tenus par un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur.
La cour, statuant en grande chambre, a défini un régime jurisprudentiel général, pour la première fois dans l’affaire Guja contre. Moldova (12 février 2008, n° 14277/04, §§ 70-78).
- La liberté d’expression s’applique également à la sphère professionnelle, mais les salariés et les fonctionnaires ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur,la nature des fonctions exigeant loyauté et réserve ;
- La mission des fonctionnaires dans une société démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et le public étant en droit d’attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et n’opposent pas d’obstacles au gouvernement démocratiquement élu, l’obligation de loyauté et de réserve revêt une importance particulière les concernant. De plus, eu égard à la nature même de leur position, les fonctionnaires ont souvent accès à des renseignements dont le gouvernement, pour diverses raisons légitimes, peut avoir un intérêt à protéger la confidentialité ou le caractère secret. Dès lors, ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion très stricte.
- La dénonciation, par des agents de la fonction publique ou des salariés, de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail doit être protégée lorsque l’employé ou le fonctionnaire concerné est seul à savoir – ou fait partie d’un petit groupe dont les membres sont seuls à savoir – ce qui se passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé pour agir dans l’intérêt général en avertissant son employeur ou l’opinion publique.
L’équilibre entre le devoir de loyauté et la liberté d’expression
Les employés sont tenus à des devoirs de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur (CEDH, Martchenko c. Ukraine, 19 février 2009, n° 4063/04, § 45). Si ce devoir de loyauté peut être plus accentué pour les agents de la fonction publique que pour les salariés travaillant sous le régime du droit privé, il constitue sans nul doute aussi une composante de ce régime, et les mêmes principes d’analyses et critères sont applicables. Les questions sont la nature et l’étendue de ce devoir de loyauté dans telle ou telle affaire et ses incidences sur la mise en balance des droits des employés avec les intérêts concurrents de leur employeur (CEDH, 21 juillet 2011, Heinish c. Allemagne, n° 28274/08, § 64).
Eu égard à leur devoir de loyauté et de discrétion, il importe que les personnes concernées procèdent à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement. Dès lors, pour juger du caractère proportionné ou non de la restriction imposée à la liberté d’expression de la requérante, la Cour doit examiner si la personne concernée disposait d’autres moyens effectifs de faire porter remède à la situation qu’elle jugeait critiquable (CEDH, 5e, 21 juillet 2011, Heinish c. Allemagne, n° 28274/08 § 65).
Les six critères
1/ Intérêt public présenté par les informations divulguées
Il faut accorder une attention particulière à l’intérêt public que présente l’information divulguée, rappelant que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général (CEDH, Stoll c. Suisse [GC], n° 69698/01, § 106 ; CEDH, Sürek c. Turquie (n° 1)[GC], n° 26682/95, § 61).
Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi (CEDH, Fressoz et Roire c. France ([GC], n° 29183/95 ; CEDH, Radio Twist c. Slovaquie, n° 62202/00).
Sont reconnus comme présentant cet intérêt :
– le manque d’indépendance de la justice (CEDH, GC, 12 février 2008, Guja c. Moldavie , n° 14277/04) ;
– Les abus de pouvoir commis par des hauts fonctionnaires (CEDH, 26 février 2009, Kudeshkina c. Russie, req. n° 29492/05) ;
– les comportements contraires à la déontologie des professionnels de santé (CEDH, 17 octobre 2011, Sosinowska c. Pologne, n° 10247/09) ;
– la critique du comportement de hauts fonctionnaires après un accident nucléaire (CEDH, 7 novembre 2006, Mamère C. France, n° 12697/03) ;
– l’accès du public aux conclusions des études environnementales ainsi qu’à des informations permettant d’évaluer le danger auquel chacun est exposé (CEDH, Tătar c. Roumanie, 27 janvier 2009, n° 67021/01, § 88) ;
– la dénonciation par un journaliste de la censure au sein d’une télévision publique (CEDH, 2e Sect., 21 octobre 2014, Matúz c. Hongrie, n° 73571/10).
2/ Existence ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation
S’il n’existe pas de voies internes pour donner l’alerte, ou qu’elles ne fonctionnent pas correctement, voire qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elles fonctionnent correctement étant donné la nature du problème dénoncé par le donneur d’alerte, il convient de protéger celui qui utilise des voies externes (CEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c. Roumanie, n° 40238/02, § 97).
Eu égard à l’obligation de discrétion, il importe que l’employé concerné procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement. Dès lors, pour juger du caractère proportionné ou non de la restriction imposée à la liberté d’expression, il faut examiner si l’intéressé disposait d’autres moyens effectifs de faire porter remède à la situation qu’il jugeait critiquable (CEDH, GC, 12 février 2008, Guja c. Moldavie , n° 14277/04, § 73).
On ne peut raisonnablement attendre d’un employé qu’il signale d’abord à son employeur les faits qu’il lui reproche lorsqu’il a connaissance d’un délit dont la non-dénonciation l’exposerait à des poursuites pénales. Le signalement préalable des faits au sein de l’entreprise n’est pas non plus requis lorsqu’il n’existe aucun espoir réel de résolution du problème, et qu’un employé ayant averti son employeur d’une pratique illicite est délié de son devoir de loyauté dès lors que ce dernier n’y a pas remédié (CEDH, 5e Sect., 21 juillet 2011, Heinish c. Allemagne, n° 28274/08, § 72à 74).
3/ Authenticité de l’information divulguée
Tout donneur d’alerte doit être considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve qu’il ait des motifs raisonnables de penser que l’information divulguée était vraie, même s’il s’avère par la suite que tel n’était pas le cas, et à condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraires à l’éthique (CEDH, Heinisch c. Allemagne, 21 juillet 2011, n° 28274/08, § 80 ; CEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c. Roumanie, n° 40238/02, § 107).
L’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités, et quiconque choisit de divulguer des informations doit vérifier avec soin, dans la mesure où les circonstances le permettent, qu’elles sont exactes et dignes de crédit (CEDH, Morissens c. Belgique, n° 11389/85, 3 mai 1988 ; CEDH, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n°21980/93, § 65, CEDH 1999-III). Cela joue en particulier lorsque cette personne est tenue à un devoir de réserve et de loyauté à l’égard de son employeur (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49 ; CEDH, Haseldine c. Royaume-Uni, n° 18957/91; CEDH, Heinish c. Allemagne, 21 juillet 2011, n° 28274/08, § 77).
Il incombe au premier chef aux procureurs, représentants de la loi, de vérifier la véracité des allégations contenues dans une plainte pénale et on ne saurait raisonnablement attendre de la personne ayant déposé plainte de bonne foi qu’elle sache si l’enquête débouchera sur une inculpation ou sur un classement sans suite (CEDH, 21 juillet 2011, Heinish c. Allemagne, n° 28274/08, § 80).
4/ Dommage causé à l’employeur
Il faut apprécier le poids respectif du dommage que la dénonciation litigieuse risquait de causer à l’employeur ou l’autorité publique concerné et de l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette divulgation (CEDH, Guja, § 76 ; CEDH, 5e Sect., 21 juillet 2011, Heinish c. Allemagne, n° 28274/08, § 68 ; CEDH, Hadjianastassiou c. Grèce, 16 décembre 1992, § 45 ; CEDH, Stoll, § 130).
Par exemple, l’intérêt général à ce que soient divulguées les informations faisant état de pressions et d’agissements illicites au sein du parquet est si important dans une société démocratique qu’il l’emporte sur l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public dans le parquet général. Une libre discussion des problèmes d’intérêt public est essentielle en démocratie et qu’il faut se garder de décourager les citoyens de se prononcer sur de tels problèmes (CEDH, Barfod c. Danemark, 22 février 1989, § 29 ; CEDH, GC, 12 février 2008, Guja c. Moldavie , n° 14277/04, § 91).
De même, l’intérêt général s’attachant à la révélation des dysfonctionnements pouvant affecter la prise en charge institutionnelle des personnes âgées par une société publique revêt une importance telle, dans une société démocratique, qu’il prévaut sur la protection de la réputation professionnelle et des intérêts commerciaux de celle-ci (CEDH, 21 juillet 2011, Heinish c. Allemagne, n° 28274/08, § 88-90).
5/ La motivation du salarié
La motivation du salarié qui procède à la divulgation est un autre facteur déterminant pour l’appréciation du point de savoir si la démarche doit ou non bénéficier d’une protection. Par exemple, un acte motivé par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d’un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne justifie pas un niveau de protection particulièrement élevé. Il importe donc d’établir si la personne concernée, en procédant à la divulgation, a agi de bonne foi et avec la conviction que l’information était authentique, si la divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question (CEDH, § 77).
6/ Sévérité de la sanction
Enfin, l’évaluation de la proportionnalité de l’ingérence par rapport au but légitime poursuivi passe par une analyse attentive de la sanction infligée et de ses conséquences (Fuentes Bobo, § 49). Une sanction très sévère emporte des répercussions très négatives sur la carrière du requérant, mais elle risque également d’avoir, compte tenu de l’écho donné par les médias, un effet dissuasif sur d’autres agents, et de les décourager de signaler des agissements irréguliers (CEDH, GC, 12 février 2008, Guja c. Moldavie , n° 14277/04, § 95 ; CEDH, Heinisch, § 91 ; CEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c. Roumanie, n° 40238/02).
Selon l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Jurisprudence de la CEDH
Une des assises d’une société démocratique
La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993 ; CEDH, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], § 34).
Rôle de l’Etat
Il existe diverses formes de relation entre l’État et la religion majoritaire, variables en fonction du contexte dans lequel elles s’inscrivent. Même si la plupart des États contractants opèrent une séparation entre l’État et les religions, un système de religion d’État existe dans plusieurs États contractants où il était déjà en vigueur lorsque la Convention a été rédigée et que ces États y sont devenues parties (CEDH, Ásatrúarfélagid c. Islande, no 22897/08, 18 septembre 2012). Un modèle constitutionnel fondé sur le principe de laïcité est lui aussi compatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention (CEDH, Dogru c. France, no 27058/05, § 72, 4 décembre 2008). Cependant, pour satisfaire aux exigences de l’article 9, tous les systèmes doivent comporter des garanties spécifiques pour la liberté de religion de chacun (CEDH, Darby c. Suède, 23 octobre 1990, § 45).
La liberté de religion n’astreint pas les États contractants à créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers. Néanmoins, un État qui a créé un tel statut doit non seulement respecter son devoir de neutralité et d’impartialité, mais également veiller à ce que les groupes religieux aient une chance équitable de solliciter le bénéfice de ce statut et que les critères établis soient appliqués d’une manière non discriminatoire (CEDH, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres, § 92 ; CEDH, Savez crkava « Riječ života » et autres, § 85 ; CEDH, Ásatrúarfélagid, § 34 ; CEDH, Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours c. Royaume-Uni, no 7552/09, § 34, 4 mars 2014).
Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (CEDH, Kokkinakis, § 33). Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention (CEDH, Leyla Şahin, § 106).
Il convient de mettre l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (CEDH, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 47 ; CEDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78 ; CEDH, Refah Partisi c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98,41343/98 et 41344/98, § 91), et considère que ce devoir impose à l’État de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent (voir, notamment, Leyla Şahin, précité, § 107). Elle en a déduit que le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (CEDH, Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53 ; CEDH, Leyla Şahin, § 107).
Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (CEDH, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63 ; CEDH, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique (CEDH Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 45, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, § 99).
Le respect des croyances
Le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut l’appréciation de la part de l’Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses (CEDH, Manoussakis c. Grèce, 26 septembre 1996).
L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions (CEDH, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75).
Pour qu’une conviction personnelle ou collective puisse relever du droit à la « liberté de pensée, de conscience et de religion », il faut qu’elle atteigne un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance. À supposer cette condition satisfaite, le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des convictions en question ou à la manière dont elles sont exprimées (CEDH, Eweida et autres c. Royaume-Uni, § 81).
Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or le droit consacré par l’article 9 se révélerait éminemment théorique et illusoire si la latitude accordée aux États leur permettait de donner à la notion de « culte » ou de « religion » une définition trop restrictive au point de priver une forme non traditionnelle et minoritaire d’une religion d’une protection juridique. De telles définitions limitatives ont des répercussions directes sur l’exercice du droit à la liberté de religion et sont susceptibles de restreindre l’exercice de ce droit dès lors que la nature religieuse d’un culte est niée. En tout état de cause, ces définitions ne peuvent être interprétées au détriment des formes non traditionnelles de la religion (CEDH, İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], § 114).
En règle générale, même s’il existe, au sein de la communauté religieuse en question, une discussion interne quant aux postulats de base de sa croyance et à ses revendications face à l’État, cela ne change rien aux fins d’application de l’article 9 (İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], § 134).
Droit d’avoir une conviction et droit de la manifester
Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (CEDH, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73 ; CEDH, Leyla Şahin, § 105).
Le premier volet est le droit d’avoir n’importe quelle conviction (religieuse ou non) dans son for intérieur et de changer de religion ou de conviction. Ce droit est absolu et inconditionnel ; l’État ne peut pas s’y immiscer – par exemple, en dictant à l’individu ce qu’il doit croire ou prendre des mesures visant à le faire changer de convictions par la contrainte (CEDH, Ivanova c. Bulgarie, § 79 ; Mockutė c. Lituanie, § 119)
Le second volet est le droit de manifester sa croyance seul et en privé mais aussi de la pratiquer en société avec autrui et en public. Ce droit n’est pas absolu : puisque la manifestation par une personne de ses convictions religieuses peut avoir des conséquences pour autrui, les rédacteurs de la Convention ont assorti ce volet de la liberté de religion des réserves émises au second paragraphe de l’article 9. Ce dernier dispose que toute restriction à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doit être prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de l’un ou de plusieurs des buts légitimes qui y sont énoncés (CEDH, Eweida et autres c. Royaume-Uni, § 80).
En d’autres termes, les limitations prévues au second paragraphe de l’article 9 portent uniquement sur le droit de manifester une religion ou une conviction et non sur le droit d’en avoir (CEDH, Ivanova c. Bulgarie, § 79).
Vêtements
Les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. Elle en a déjà jugé ainsi s’agissant du choix de la coiffure ou des vêtements (CEDH, Popa c. Roumanie, no 4233/09, §§ 32-33 ; CEDH, McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no8317/78, 15 mai 1980, DR 20, p. 44, § 83). a Cour a eu l’occasion d’examiner plusieurs situations à l’aune de ces principes.
La Cour s’est prononcée
- sur l’interdiction de porter des signes religieux dans les établissements d’enseignement public prescrite aux enseignants (CEDH, Kurtulmuş c. Turquie, no 65500/01) ou aux élèves et étudiantes (CEDH, Leyla Şahin ; CEDH, Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02 ; CEDH, Kervanci c. France, no 31645/04, 4 décembre 2008 ; CEDH, Aktas c. France, no 43563/08, 30 juin 2009 ; CEDH, Ranjit Singh c. France (déc.), no 27561/08, 30 juin 2009),
- sur l’obligation de retirer un élément vestimentaire à connotation religieuse dans le cadre d’un contrôle de sécurité (CEDH, Phull ; CEDH, El Morsli),
- sur l’obligation d’apparaître tête nue sur les photos d’identité destinées à des documents officiels (CEDH, Mann Singh c. France, no 24479/07, 13 novembre 2008),
- sur la sanction du voile intégral (CEDH, S.A.S. c. France, no 43835/11, 1er juillet 2004)
Garantir le pluralisme
L’Etat doit jouer son rôle en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Aussi, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993).
La croyance, intérieure, ne se comprend pas sans des manifestions publiques, que l’Etat doit protéger. Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion » individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (CEDH, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, § 114).
Pratiques abusives
Les libertés garanties par la Convention ne sauraient priver les autorités d’un Etat, dont une association, par ses activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci. Sur ce point, la Cour estime qu’un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l’Etat à deux conditions : les moyens utilisés à cet effet doivent être légaux et démocratiques, et le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu’un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs (CEDH, Refah Partisi c. Turquie, 13 février 2003).
Sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (CEDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], § 76 ; CEDH, Leyla Şahin c. Turquie [GC], § 107). En effet, les convictions religieuses et philosophiques ont trait à l’attitude des individus envers le divin, dans laquelle même les perceptions subjectives peuvent revêtir de l’importance, compte tenu du fait que les religions forment un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d’ordre philosophique, cosmologique ou éthique (CEDH, İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], § 107).
Par conséquent, s’agissant des décisions religieusement motivées prises par les individus dans le cadre de leur autonomie personnelle, l’État n’a qu’une marge d’appréciation très réduite pour s’ingérer dans leurs choix. Une ingérence pourrait être justifiée au sens de l’article 9 § 2 dans le cas d’une incompatibilité claire et radicale avec les principes fondamentaux et les valeurs fondamentales sous-tendant la Convention : par exemple, lorsqu’il s’agit d’un mariage polygame ou contracté avec un mineur, d’une violation flagrante de l’égalité des sexes, ou encore d’une décision prise sous contrainte (CEDH, Les témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie).
* * *
Pour aller plus loin
Selon l’article 4 du Pacte International des Droits Civiques et Politiques
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Analyse du Comité des Droits de l’homme
Principe
L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques revêt une importance primordiale pour le système de protection des droits de l’homme dans le cadre de cet instrument. D’une part, il autorise l’État partie à adopter unilatéralement des mesures dérogeant provisoirement à certaines obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. D’autre part, il soumet à la fois ces dérogations ellesmêmes et leurs conséquences matérielles à un régime de garantie bien précis. Le retour à une situation normale, permettant d’assurer de nouveau le plein respect du Pacte, doit être l’objectif primordial de l’État partie qui déroge au Pacte (Observation générale sur l’article 4, adoptée le 24 juillet 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11).
Les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire. Avant qu’un État ne décide d’invoquer l’article 4, il faut que deux conditions essentielles soient réunies: la situation doit représenter un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation et l’État partie doit avoir proclamé officiellement un état d’urgence.
Tout trouble ou toute catastrophe n’entre pas automatiquement dans la catégorie d’un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation, selon la définition du paragraphe 1 de l’article 4. Pendant un conflit armé, international ou non, les règles du droit international humanitaire deviennent applicables et contribuent à empêcher tout abus des pouvoirs exceptionnels par un État. Le Pacte stipule expressément que même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette situation constitue une menace pour la vie de la nation.
Dérogations
Les dérogations ne soient permises que dans la stricte mesure où la situation l’exige, comme l’impose le principe de proportionnalité (Rapport sur Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11)
Outre les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, il y a des éléments qui, de l’avis du Comité, ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation licite en vertu de l’article 4. On en donne ciaprès quelques exemples représentatifs.
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Bien que ce droit, énoncé à l’article 10 du Pacte, ne soit pas expressément mentionné au paragraphe 2 de l’article 4, le Comité considère que le Pacte exprime ici une norme du droit international général, ne souffrant aucune dérogation, opinion étayée par la mention de la dignité inhérente à l’être humain faite dans le préambule du Pacte et par le lien étroit entre l’article 7 et l’article 10.
L’interdiction de la prise d’otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues n’est pas susceptible de dérogation. Le caractère absolu de cette interdiction, même dans une situation d’exception, est justifié par son rang de norme du droit international général.
Le Comité est d’avis que la protection internationale des droits des personnes appartenant à des minorités comporte des aspects qui doivent être respectés en toutes circonstances. Cela est reflété dans l’interdiction du génocide en droit international, dans l’inclusion d’une clause interdisant la discrimination dans l’article 4 luimême (par. 1) ainsi que par l’interdiction de déroger à l’article 18.
Comme le confirme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la déportation ou le transfert forcé de population, entendus comme le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international, constituent un crime contre l’humanité. Le droit légitime de déroger à l’article 12 du Pacte en cas de situation d’exception ne peut en aucun cas être reconnu comme justifiant de telles mesures.
En aucun cas la proclamation d’un état d’exception faite conformément au paragraphe 1 de l’article 4 ne peut être invoquée par un État partie pour justifier qu’il se livre, en violation de l’article 20, à de la propagande en faveur de la guerre ou à des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitueraient une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.
Toute garantie relative à la dérogation, consacrée à l’article 4 du Pacte, repose sur les principes de légalité et la primauté du droit, inhérents à l’ensemble du Pacte. Certains éléments du droit à un procès équitable étant expressément garantis par le droit international humanitaire en cas de conflit armé, le Comité ne voit aucune justification à ce qu’il soit dérogé à ces garanties au cours d’autres situations d’urgence. De l’avis du Comité, ces principes et la disposition concernant les recours utiles exigent le respect des garanties judiciaires fondamentales pendant un état d’urgence. Seuls les tribunaux peuvent juger et condamner un individu pour infraction pénale. La présomption d’innocence doit être strictement respectée. Afin de protéger les droits non susceptibles de dérogation, il découle du même principe que le droit d’introduire un recours devant un tribunal, dans le but de permettre au tribunal de statuer sans délai sur la légalité d’une détention, ne peut être affecté par la décision d’un État partie de déroger au Pacte.