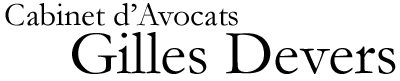Les actualités du droit, novembre 2021
En musique avec LIZZ WRIGHT, Bale 2016
La Géniale Lizz Wright en concert… Attention, si vous ne connaissez pas, vous allez craquer. Lizz Wright est enregistrée à Bâle en 2016, avec Robin Macatangay et Marvin Sewell à la guitare, Nick D’Amato à la basse et Jano Tix aux drums. En route vers le ciel…
Focus sur… le peuple français, père de l’abolition de la peine de mort
Quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort en 1981 :
L’affaire d’un homme ou une victoire collective ?
La réécriture des faits – et de faits aussi simples que certains – sous nos yeux reste un exercice étonnant. Regardons les conditions de l’abolition de la peine de mort en France.
Une peine qui, sans disparaitre, devenait rare
Les chiffres montrent le lent recul de la peine de mort sans disparaitre, devenait rare. On partait de haut : en 1947, trente et une exécutions, en 1948 vingt et une, et en 1949 vingt-cinq. De 1968 à 1977, sur 12 514 condamnations pour crime, on a compté trente-huit condamnations à mort et sept exécutions. Sept de trop, mais c’est une tous les deux ans.
De juin 1969 à 1974, sous la présidence de Georges Pompidou, trois condamnés à mort furent guillotinés : Claude Buffet et Roger Bontems, le 28 novembre 1972, à la prison de la Santé de Paris ; Ali Benyanès, le 12 mai 1973, à la prison des Baumettes de Marseille.
De 1974 à 1981, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, les trois dernières exécutions capitales eurent lieu : Christian Ranucci, le 28 juillet 1976, à la prison des Baumettes de Marseille ; Jérôme Carrein, le 23 juin 1977, à la prison de Douai ; Hamida Djandoubi, le 10 septembre 1977, à la prison des Baumettes de Marseille.
Mais la peine de mort restait, comme une plaie, et la France était bien en retard.
Entre 1863 (le Venezuela) et 1979 (le Brésil) l’abolition était devenue majoritaire en Amérique du Sud. Elle l’était également en Europe : Portugal en 1867, Pays Bas en 1870, Norvège en 1905, Suède en 1921, Islande en 1928, Danemark en 1933, Suisse en 1942, Italie en 1947, Finlande en 1949, Allemagne en 1949, Autriche en 1950, Malte en 1971, Royaume Uni en 1976, Espagne en 1978… Pays proche, le Canada l’avait aboli 1978.
Lors des débats à l’Assemblée nationale le 17 septembre 1981, le président de la Commission des lois, Raymond Forni, avait souligné ce retard et ses effets : « Souvenons-nous que la France est de plus en plus marginalisée au sein de la Communauté européenne, que de plus en plus des pressions s’exercent sur elle pour que s’affirment, là plus qu’ailleurs, une solidarité de points de vue, une communauté de référence. Pouvons-nous longtemps encore rester insensibles aux suppliques, aux demandes qui, ici ou là, sont lancées sur la scène internationale pour que notre pays aligne droit et raison ? »
Bref, avec le rappel des faits, le film de la France, terre d’humanisme et puissance éclairante du monde, prend un sacré coup sur la cafetière : la France était dans le fond de classe européen, bien en retard. Ce vote reste un moment important, mais vouloir faire de cette loi légende d’une France à l’avant-garde est juste ridicule.
Un homme incarnant la cause, ou les efforts de milliers de personnes ?
Ensuite faire de cette loi la chose de Robert Badinter, généreusement appelé « le père de l’abolition de la peine de mort » est déplorable. Cette loi est une victoire de mille acteurs de l’abolition, puis une victoire politique, portée par de grands responsables politiques qui ont su se présenter aux élections en affrontant une opinion hostile. Rien ne justifie cette appropriation de la loi par Robert Badinter, et bien au contraire, c’est une occasion rare de saluer la victoire collective, fruit courage politique des grandes organisations de la Gauche. Ce qui nous rappelle que la Gauche politique a existé dans ce pays, et c’était une excellente chose. Le terrain était prêt, mais il ne serait rein passé sans le programme commun de la Gauche et le courage politique de François Mitterrand.
Alors, faut-il aller chercher du côté de l’avocat qui se serait identifié dans les affaires contre la peine de mort ? Robert Badinter n’est intervenu que dans deux affaires ; difficiles, oui, mais deux. Il a été en charge, aux côtés de Maître Philippe Lemaire, de l’affaire de la centrale de Clairvaux, où en 1971, deux détenus Buffet et Bontems avaient pris en otage puis égorgé une infirmière et un gardien. La cour d’assises de l’Aube en juin 72 avaient prononcé la peine de mort, et le président Pompidou avait refusé la grâce présidentielle, ouvrant vers les excusions le 28 novembre 1972. Second procès, début 1977, lorsqu’il a défendu avec Maitre Robert Bocquillon, Patrick Henry, jugé pour le meurtre d’un enfant de 8 ans, qu’il avait enlevé à Troyes le 30 janvier 1976 pour exiger une rançon à ses parents. S’écartant des réquisitions, les avocats avaient évité la peine de mort, pour une sanction de perpétuité.
Deux procès lourds, et avec beaucoup de responsabilité pour la défense. Mais c’était alors la règle du barreau et des bataillons d’avocats ont conduit cette défense. Il y a maints témoignages d’avocats décrivant ces procès sous haute tension, surtout à une époque où la cour d’assises statuait sans appel. Je pense en particulier aux confrères qui ont assuré ce type de défense pendant la guerre d’Algérie, en Algérie ou en France, où le risque de condamnation à mort était très élevé. Et à tous les avocats, dont de nombreux français, qui plaident dans les pays où la peine de mort est restée.
Alors oui, collectivement, le barreau a été un grand acteur de l’abolition, mais ce n’est pas une aventure personnelle.
Une grande tradition abolitionniste au Parlement
En février 1848, la peine capitale en matière politique a été abolie par décret du gouvernement provisoire de la IIe République, validé l’Assemblée constituante en septembre.
Il restait à élargir l’abolition aux crimes de droit commun, mais la majorité, collant à l’opinion, était en sens inverse. L’histoire est riche d’initiatives, mais retenons trois hommes politiques qui ont magnifiquement argumenté.
Victor Hugo, le 15 septembre 1848 à l’Assemblée :
« Qu’est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Ce sont là des faits incontestables. L’adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siècle, c’est là une partie de sa gloire, a aboli la torture ; le XIXe abolira certainement la peine de mort. Vous ne l’abolirez pas peut-être aujourd’hui ; mais n’en doutez pas, vous l’abolirez ou vos successeurs l’aboliront demain ! Vous avez renversé le trône ; maintenant renversez l’échafaud. Je vote l’abolition pure, simple et définitive de la peine de mort ».
En 1908, Aristide Briand, garde des Sceaux :
« On a dit que bien des malfaiteurs redoutaient la peine de mort et que, si elle n’existait pas, ils commettraient un plus grand nombre de crimes. On l’a affirmé, mais on ne l’a pas prouvé. Je me suis efforcé de démontrer par les chiffres et des faits, que là où la peine de mort a été supprimée, on n’a pas pu constater une recrudescence dans les grands crimes qui étaient antérieurement passibles de cette peine, et je dis que c’est une démonstration. Le malfaiteur va à son méfait avec la conviction, avec la certitude, qu’il ne sera pas pris ; voilà la vérité. Quand l’opinion publique est excitée comme elle l’est en ce moment, quand elle exige impérieusement du sang, lui obéir, c’est un geste commode. Les responsabilités sont bien plus lourdes quand il s’agit de remonter les courants de l’opinion publique. Il faut plus de courage pour lui résister que pour se laisser dominer par l’aveuglement de la foule ».
Jean Jaurès, le 18 novembre 1908, devant la Chambre des députés :
« Ce qui m’apparaît surtout, c’est que les partisans de la peine de mort veulent faire peser sur nous, sur notre esprit, un dogme de fatalité. Il y a des individus, nous dit-on, qui sont à ce point tarés, abjects, irrémédiablement perdus, à jamais incapables de tout effort de relèvement moral, qu’il n’y a plus qu’à les retrancher brutalement de la société des vivants, et il y a au fond des sociétés humaines, quoiqu’on fasse, un tel vice irréductible de barbarie, de passions si perverses, si brutales, si réfractaires à tout essai de médication sociale, à toute institution préventive, à toute répression vigoureuse mais humaine, qu’il n’y a plus d’autre ressource, qu’il n’y a plus d’autre espoir d’en empêcher l’explosion, que de créer en permanence l’épouvante de la mort et de maintenir la guillotine. Voilà ce que j’appelle la doctrine de fatalité qu’on nous oppose. Je crois pouvoir dire qu’elle est contraire à ce que l’humanité, depuis deux mille ans, a pensé de plus haut et a rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l’esprit du christianisme et à l’esprit de la Révolution ».
Les actions parlementaires se sont poursuivies, jusqu’à un vote abolitioniste de la commission des lois le 14 juin 1979, donc sous une majorité de droite, mais pour passer devant le parlement, il faudra attendre 1981.
Les engagements clairs de 1981
1981, c’était la politique désormais honnie « de l’ancien monde », qui avait pourtant tant de vertus. Donc, ce n’était pas « moi » qui pense en direct à la télé, mais de grands partis politiques, avec une représentativité effective dans le pays et vrais débats internes, qui définissaient leur programme et leur action, et négociaient ensuite pour des programmes de gouvernement. Des discussions souvent difficiles, mais s’il y en a une question qui faisait consensus, c’était l’abolition de la peine de mort. Consensus aussi avec les grands syndicats.
Aussi, c’est tout simplement que l’abolition s’est trouvée le programme de François Mitterrand, les 110 propositions pour la France.
Dans l’émission Cartes sur table, le 18 mars 1981, Mitterrand avait pris position de la manière la plus claire, expliquant que la peine de mort était contraire aux enseignements de la philosophie, des religions et de l’humanisme : « Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l’église catholique, les églises réformées, la religion juive et la totalité des grandes associations humanitaires internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort.»
Soulignant que l’opinion publique était majoritairement favorable au maintien de la peine de mort, il avait affirmé qu’une loi serait rapidement votée et qu’il gracierait les condamnés à mort s’il y avait lors de son arrivée à l’Elysée : « Je ferai ce que j’aurai à faire dans le cadre d’une loi que j’estime excessive, c’est-à-dire régalienne, d’un pouvoir excessif donné à un seul homme : disposer de la vie d’un autre. Mais ma disposition est celle d’un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales ». Une leçon qui ignore le rôle de conscience poisseuse donnée désormais aux sondages.
De fait, le 10 mai 1981, Philippe Maurice, 24 ans, était dans le couloir de la mort, condamné pour avoir tué un policier. Si c’est Giscard qui gagne, c’est fini ; si c’est Mitterrand, la vie reprend. Dès le 25 mai, Mitterrand le gracie et la peine est commuée en perpétuité. Ce jour-là, la France ne connait plus la peine de mort.
Il restait à faire voter la loi.
Une loi de large consensus
L’une des grandes surprises du premier gouvernement de Pierre Mauroy, le 22 mai 1981, est que le ministre de la justice n’était pas Robert Badinter mais Maurice Faure, maire de Cahors et parlementaire chevronné. Le travail en équipe de la campagne électorale avait laissé des traces, et la sanction était tombée.
Après les législatives de la fin juin, la décision a été prise de faire entrer quatre ministres communistes au gouvernement. Dans ces conditions, Maurice Faure n’entendait plus siéger au gouvernement, et Robert Badinter est revenu dans la boucle avec le gouvernement du 23 juin 1981.
Le texte – abolition de la peine de mort et remplacement par la perpétuité – a été présenté avec un calendrier accéléré, du fait de l’importance du texte,… et du consensus politique, une large partie de la droite parlementaire s’apprêtant à le voter : Conseil des ministres le 26 août, adoption par la commission des lois le 10 septembre, vote à l’Assemblée nationale le 18 septembre par 363 voix contre 117, puis par le Sénat le 30 septembre par 160 voix contre 126, et promulgation le 9 octobre 1981.
Les débats sont disponibles au Journal officiel, et je souligne l’intervention de Philippe Séguin.
« Mes chers collègues, monsieur le ministre de la justice, nous devons nous garder de la prétention qui serait probablement démesurée et dangereuse de vouloir arbitrer ce soir, devant l’Histoire, sur le fond d’un débat aussi ancien. La controverse sur la peine de mort dure depuis des siècles et assurément elle se poursuivra après notre verdict. Le débat parlementaire est lui-même entamé depuis près de deux siècles. Tant de grandes voix se sont exprimées ici même que nous sommes probablement condamnés à des comparaisons peu flatteuses, à des plagiats ou à des redites.
« Ne surestimons donc pas le rôle qui nous revient : sachons de même éviter dans cette grande et ancienne confrontation de désigner des vainqueurs et des vaincus. Ne surestimions pas notre rôle car nous n’avons en vérité qu’à donner une dernière chiquenaude qui suffira à abattre un trop vieux monument qu’ont déjà affaibli, ébranlé, ratiné par leur talent et leur courage des hommes et des femmes qui s’illustrèrent dans les prétoires, les assemblées, les églises, les universités, les associations, hommes et femmes auxquels revient tout le mérite. […] »
Alors, une loi Badinter, et un père de l’abolition. Il faut bien quarante ans de réécriture des faits pour y parvenir. D’autant plus regrettable, qu’une victoire politique collective, non partisane, rejetant les excès des passions populaires, c’est la grande signature d’une démocratie
Document
Koen Lenaerts : « L’UE ne peut fonctionner que si le droit national cède le pas au droit commun européen »
De premier intérêt, voici l’interview donnée par Koen Lenaerts, le président de la Cour de justice de l’Union européenne aux Echos. Propos recueillis par Karl De Meyer et Catherine Chatignoux, publiés le 28 octobre 2021.
La CJUE a imposé mercredi une astreinte journalière d’un million d’euros à la Pologne pour n’avoir pas restauré l’indépendance de sa justice, Ces sanctions financières sont-elles courantes ?
Il reste heureusement très inhabituel que des Etats membres ne respectent pas une décision de la Cour de justice. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, la Cour a été amenée à imposer des sanctions financières à des Etats membres.
Comment expliquez-vous que la Cour de justice européenne soit aujourd’hui contestée dans plusieurs pays et par différents bords politiques ?
Ces dernières années, la Cour de justice a eu à trancher de nombreuses affaires dans des domaines qu’on peut qualifier de hautement politiques, comme la stabilité de l’euro, la crise migratoire, le Brexit, ainsi que, dernièrement, l’Etat de droit. Il est donc peu surprenant qu’elle soit la cible de critiques. Mais la Cour n’est pas un acteur politique qui s’engage dans un débat public. Son rôle est tout autre : veiller au respect et à l’application uniforme du droit commun dans les 27 Etats membres. Et cela uniquement quand elle est saisie dans le cadre des procédures prévues à cet effet. J’ajoute que lorsqu’elle est valablement saisie, elle n’a d’autre choix que de trancher l’affaire, sinon elle commettrait un déni de justice car elle a une compétence juridictionnelle obligatoire.
Certains pays d’Europe de l’Est considèrent que la Cour outrepasse ses compétences et crée du droit. Qu’en pensez-vous ?
Il y a 35 ans, quand j’étais référendaire à la Cour, on ne s’occupait que du marché commun. Les frontières intérieures existaient encore. Il n’y avait pas de coopération judiciaire en matière pénale, pas de politique commune d’asile et de migration. Les sujets qui fâchent n’existaient pas encore. Ils sont apparus après l’adoption de l’Acte unique, lorsque le marché intérieur s’est peu à peu débarrassé des contrôles aux frontières intérieures et que la libre circulation s’est généralisée.
Les Etats membres ont ainsi conféré de nouvelles compétences à l’Union européenne en matière de coopération policière et judiciaire, en matière pénale, d’asile et de migration et de non-discrimination. Dans ce contexte évolutif, la Cour n’invente pas le droit mais elle précise les normes quand elles manquent de clarté. Cela se traduit par une fonction créatrice de droit, je ne m’en défends pas. Mais notre Cour a été instituée par les Etats membres, pour dire le droit commun et éviter qu’il y ait des interprétations nationales différentes à partir du même texte.
Au cœur des controverses actuelles, il y a cette notion de primauté du droit européen. En quoi consiste-t-elle exactement ?
En décembre 2007, tous les Etats membres, y compris ceux qui ont adhéré en 2004 et 2007, ont signé une déclaration relative à la primauté du droit de l’Union, dite « déclaration 17 », annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a abouti au Traité de Lisbonne. Ils y reconnaissent que le droit de l’Union l’emporte sur le droit national, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour. Ce principe de primauté a été identifié pour la première fois dans l’arrêt Costa contre Enel de 1964. Les juges de l’époque l’ont déduit, de manière convaincante, de la nature même du droit de l’Union. Car sans le principe de primauté, le droit de l’Union perd son caractère commun et l’égalité des Etats membres et des citoyens n’est plus assurée. C’est un arrêt fondateur sans lequel l’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui n’existerait pas.
Pourquoi la primauté du droit européen n’est-elle pas inscrite dans le Traité lui-même ?
Le contenu de cette déclaration 17 était à l’origine intégré au Traité constitutionnel préparé par Valéry Giscard d’Estaing. Après le double « non » français et néerlandais à ce texte en 2007, les Européens en ont sorti tout ce qui pouvait symboliser un Etat en devenir. Car la codification de la primauté du droit européen, telle qu’elle avait été prévue, était perçue comme la quintessence de la puissance d’un Etat fédéral. On a retiré les quelques paragraphes concernant la primauté du droit européen, en en conservant la substance. L’Union européenne ne peut fonctionner que si le droit national cède le pas au droit commun européen. Cette déclaration est absolument univoque.
Constatez-vous aujourd’hui une remise en cause de la primauté du droit européen par les juridictions nationales ?
Abstraction faite de quelques cas récents, je ne perçois pas une remise en cause fondamentale de la Cour de justice de l’Union européenne ni du principe de primauté du droit européen. Bien qu’il y ait des voix qui s’élèvent contre ce dernier, la coopération entre la Cour de justice et les juridictions nationales fonctionne harmonieusement.
Nous recevons chaque année autour de 600 questions préjudicielles, c’est-à-dire des questions de juridictions nationales sur l’interprétation qu’il faut donner à un texte pour savoir comment l’appliquer au niveau national. Ces juridictions mettent en œuvre notre jurisprudence et écartent la loi ou la jurisprudence nationale contraire au droit de l’Union. Et ce dans les domaines les plus divers : protection des consommateurs, marché intérieur, concurrence, TVA, aides d’Etat.
Un autre chiffre atteste du respect de l’ordre juridique européen : le nombre de recours en manquement contre des Etats membres oscille depuis 2011 entre 30 et 60 par an, contre une fourchette de 150 à 200 par an entre 2000 et 2010, signe que les Etats membres font plus d’efforts qu’auparavant pour être en conformité avec leurs obligations découlant du droit de l’Union.
En France, certains politiques invoquent une identité constitutionnelle qui permettrait d’échapper à une règle européenne. Est-ce bien le cas ?
Selon l’article 4 du Traité sur l’Union européenne, celle-ci doit respecter l’identité nationale des Etats-membres. Le Traité ne parle pas de l’identité constitutionnelle en tant que telle mais de « l’identité inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ». L’Union s’engage aussi à respecter les fonctions essentielles de l’Etat notamment la sécurité nationale. Nous avons pris en compte cet élément dans un arrêt récent, dit « Quadrature du net » . Dans cette affaire, le Conseil d’Etat nous a posé une question préjudicielle à l’instigation d’une ONG qui défend les libertés individuelles contre les intrusions de l’Internet. La Cour a dit qu’en vue de protéger la sécurité nationale, y compris la lutte contre le terrorisme, un Etat membre peut conserver les données de trafic et de localisation dans la mesure nécessaire à la protection de la sécurité nationale. Mais si un Etat membre veut invoquer la sécurité nationale pour interdire sur son sol, par exemple, des réfugiés d’une certaine religion, nous répondons que ce n’est pas possible car on est là en présence, en réalité, d’une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la religion.
Nous veillons toujours à ce que les Etats membres n’utilisent pas abusivement cet article sur l’identité nationale. On ne peut jamais invoquer l’identité nationale pour faire fi des valeurs de l’article 2 du Traité, qui défend le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes, car il est la précondition d’appartenance à l’UE. Cet article exprime l’identité constitutionnelle de l’Union elle-même.
Comment fonctionne la coopération avec les juridictions des Etats membres quand il s’agit de faire interagir le droit européen et le droit national ?
Elle fonctionne très bien. Le dialogue sur l’interprétation des normes de l’Union est très fructueux. Pour la France, ce sont souvent le Conseil d’Etat et la Cour de cassation qui mettent sur la table, par le biais des renvois préjudiciels, des questions qui se posent à eux dans le cadre de l’interaction entre le droit européen et le droit national. La recherche de la juste articulation entre normes juridiques issues de systèmes différents donne chaque fois l’occasion d’ouvrir un débat paneuropéen, car chaque renvoi préjudiciel est traduit et notifié aux 27 Etats membres. C’est ainsi que la question de savoir si l’interdiction du foulard islamique sur le lieu du travail est ou non une discrimination fondée sur la religion nous a été soumise par plusieurs cours nationales de France, de Belgique et d’Allemagne.
On a au bout du compte une jurisprudence consolidée qui concilie le principe de laïcité, consubstantiel à l’identité nationale de la France, avec la sensibilité allemande qui est plutôt celle de l’acceptation de toute expression de conviction religieuse.
Vos relations avec la Cour de Karlsruhe sont houleuses. Elle a contesté à plusieurs reprises vos arrêts…
Notre relation avec la Cour constitutionnelle allemande est excellente. Il ne faut pas s’arrêter à un ou deux cas de crise. Elle est notre meilleure alliée. Elle a qualifié la Cour de justice de l’Union européenne de juge légal de l’interprétation du droit de l’Union. En conséquence, une juridiction suprême allemande qui ne respecte pas son obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice ne viole pas seulement les Traités européens mais aussi l’article 101 de la Constitution allemande.
L’ordre juridique interne allemand renforce donc notre position. Les 27 Etats membres ont tous une responsabilité pour la préservation des valeurs de l’article 2 du Traité. N’oublions jamais que l’Union européenne est un projet de paix et que la paix repose sur la consolidation de ces valeurs communes. Nous savons tous ce qui est arrivé à l’Europe au siècle passé quand des Etats voulaient imposer leur droit à la différence, voire leur supériorité…
Les actualités du droit, ocotobre 2021
1er octobre – Un an de prison ferme pour un ancien président de la République
Par jugement du 30 septembre, Nicolas Sarkozy est condamné à un an de prison ferme pour dépassement du plafond des dépenses de sa campagne dans l’affaire Bygmalion. Les quinze prévenus ont été condamnés, souvent à des peines supérieures aux réquisitions du parquet, avec des peines de deux à trois ans, partiellement assorties de sursis.
Pour Nicolas Sarkozy, il s’agit de la peine maximale prévue par la loi pour dépassement du plafond des dépenses électorales, soit un dépassement de 20 millions d’euros, près du double des dépenses autorisées. « Je n’étais au courant de rien, ces questions financières étant gérées pas d’autres ». Pas d’accord a répondu le tribunal, jugeant qu’« averti du risque de dépassement » par deux notes rédigées par les experts-comptables, il avait eu à la fois « la conscience et la volonté » de dépasser le plafond autorisé. Nicolas Sarkozy a fait appel, affirmant que le droit avait été « une nouvelle fois bafoué ».
Il y a six mois, c’était une condamnation à trois ans de prison dont un an ferme dans l’affaire dite des « écoutes ».
Toute la classe de droite stigmatise le jugement, et apporte son soutien à Sarkozy, victime de l’injustice. Dans l’opinion, un ancien président de la République condamné à un an ferme, c’est presque rien. Outre la question de l’honnêteté des dirigeants de l’Etat, est en cause aussi la confiance dans le processus électoral, alors qu’on pleure devant les chiffres de l’abstention. Tout ceci à quoi inquiéter sur la perte du sens civique.
7 octobre – Covid : Lamentables manœuvres devant la CEDH
18 000 requêtes contre le pass sanitaire en France inscrites devant la CEDH, un joli exploit ? Non, une affaire lamentable montée par un universitaire de Montpellier, Guillaume Zambrano, opposant à la législation sur le pass, et qui avait installé sur son site internet un formulaire simplifié, pour atteindre un effet de masse.
Ce 7 octobre, la CEDH a déclaré irrecevables ces 18 000 requêtes standardisées pour avoir oublié deux principes clés : l’épuisement des voies de recours internes et des requêtes individualisées. Genre mauvais débutant de première année.
Dans un communiqué, la CEDH déplore cette manœuvre qui avait pour objectif de provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour, et « de forcer sa porte d’entrée pour faire dérailler le système.
Il est déjà difficile de se retrouver dans le cadre juridique du dossier Covid, et ce type de manœuvre n’amène que du discrédit et de l’incompréhension. Lamentable.
7 octobre – Le Tribunal constitutionnel polonais conteste la primauté du droit européen
Le 7 octobre 2021, le tribunal constitutionnel polonais a jugé que les articles 1er Traité sur l’Union européenne – qui proclame une « union sans cesse plus étroite des peuples de l’Europe » – et 19 – relatif à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – contreviennent à la Constitution polonaise en tant qu’ils permettent d’écarter celle-ci au profit du droit européen. Une remise en cause de la primauté du droit communautaire, issu des traités, ayant été consacré dans un arrêt Costa c. Enel du 15 juillet 1964 de la Cour européenne : « Le droit du traité ne pourrait, en raison de sa nature originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit. »
Le gouvernement polonais dénie tout projet de Polexit, mais il veut poser un débat général, comme l’affirme le premier ministre, Mateusz Morawiecki : « Nous ne sommes pas un invité malvenu dans l’Union européenne. Et c’est pourquoi nous n’acceptons pas d’être traités comme un pays de deuxième catégorie ».
Deux remarques, avant de renvoyer à l’interview de Koen Lenaerts.
D’abord, si les juges sont amenés à mettre dans la clarté des principes un peu camouflés dans les Traités, ils ont pour base ces Traités, dont le contenu est arrêté par les responsables politiques étatiques. La jurisprudence ne trouve pas sa source dans l’imagination des juges. Et si aucun Etat n’est contraint à rejoindre l’Union européenne, celui qui fait ce choix doit ensuite en appliquer les règles. Il faut écouter ce que dit la Pologne, mais dans le respect de la construction européenne, qui est un choix libre.
Ensuite, c’est une caricature que de présenter la primauté du droit européen, qui est une réalité, comme laminant les constitutions nationales. Lorsqu’il existe, ce droit mis en commun s’impose comme la règle, et toute autre solution serait ingérable, mais il laisse de larges domaines régis librement par chaque Etat, selon sa constitution.
Un exemple ? Saisis dans des affaires très diverses, les juges donnent un contenu au principe de liberté religieuse, qui est posé par le Traité, et ses arrêts ont un effet général, mais ils respectent entièrement les régimes nationaux de cette liberté, avec une grande diversité au sein des 27 Etats-membres.
17 octobre – Londres veut empêcher la CEDH de lui « donner des ordres »
Nos amis britanniques ont quitté l’Union européenne, mais ils sont restés membres du Conseil de l’Europe, et donc soumis à l’autorité de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Une petite diatribe anti-européenne fait toujours son effet, alors pourquoi s’en priver ? C’est au tour du ministre britannique de la Justice, Dominic Raab, de faire son numéro dans une interview au Sunday Telegraph , en affirmant vouloir empêcher la CEDH de « lui donner des ordres », car il n’est « pas normal » que des juges de Strasbourg se prononcent sur des questions relatives aux soldats britanniques combattant à l’étranger, ou au service public de santé (NHS). Le ministre a également qualifié de « problème grave » le fait que des étrangers utilisent le régime du « droit à la vie familiale », pilier des droits de l’Homme, pour empêcher leur expulsion.
Quitter la CEDH à laquelle les citoyens sont très attachés vu sa fonction de garantie et un bilan qui l’honore, et à laquelle adhère tous les pays de la grande Europe – dont la Russie et la Turquie – serait beaucoup plus facile à gérer que le Brexit : il suffit de retirer une signature. Mais quitter cette instance phare dans la protection des droits aurait un coût juridique et politique élevé. Alors, le ministre Dominic Raab préfère brasser de l’air. Ces politiques irresponsables nous gavent.
18 octobre – Chine : La carrière du grand pianiste compromise pour le recours au service d’une prostituée
Yundi Li, 39 ans, le pianiste chinois renommé, ancien lauréat du concours international Chopin en 2000, a été arrêté le 18 octobre à Pékin alors qu’il était en présence d’une prostituée dans le quartier de Chaoyang. Selon la loi chinoise, il risque une peine de prison de 15 jours et une forte amende mais le plus sévère sera la disgrâce auprès des autorités musicales.
L’Association chinoise des arts du spectacle appelle au boycott du pianiste dont le comportement reflèterait « son indifférence vis à vis de la loi et son manque d’autodiscipline morale ». Sur le plus grand site communautaire chinois Weibo (500 millions d’utilisateurs) toutes ses fonctions et titres honorifiques ont été effacés. Il n’y est plus, désormais, que « pianiste international ».
22 octobre – Présidentielle 2022 : Zemmour peine à jouir
Enfin, voici un sondage de bonheur, qui place Zemmour second au deuxième tour, avec 16 % des voix, juste devant Le Pen.
Et bien, oui, je trouve cela plutôt encourageant. Depuis des années, malgré ses condamnations pénales pour incitation à la haine et ses thèmes dépressifs qui tournent en boucle, ce type dispose de tous les meilleurs plateaux-télés, d’émissions radio aux moments de grande écoute et de la une du Figaro quand il veut. Actuellement, il a fait son nid sur Cnews. Omniprésent. Je n’oublie pas quand, alors qu’il venait d’écoper d’une condamnation, il avait été accueilli comme un héros lors d’une réunion des Républicains, expliquant savamment que ce n’était pas aux juges de contrôler la liberté d’expression.
Bref, des années de propagande, et malgré cette mise en avant permanente, notre journaliste obtient (dans un sondage) à peine 16 % d’intention de vote. Donc 84% le renvoie à son statut de cafard. Oui, c’est encourageant.
23 octobre – Politique en Allemagne : la classe
En Allemagne, on ne vote pas pour un chef qui avec moins de 25% au premier tour récupère ensuite l’ensemble des pouvoirs. On vote pour des partis, et en fonction de leurs programmes de gouvernement.
Au pouvoir comme chancelière depuis 2005, Merkel et sa CHU ont perdu les dernières élections, ouvrant une coalition des Sociaux-démocrates et des Verts. Quand ? Bientôt, et sans doute en décembre, car le chancelier reste en poste jusqu’à ce que son successeur ait réussi à trouver une coalition, et donc un programme. Et ça discute très serré, sous la direction du socialiste Olaf Scholz.
Dans une interview accordée au « Süddeutsche Zeitung » la chancelière se dit sereine à l’idée de passer la main à cette coalition dirigée par Olaf Scholz. Avec lui au pouvoir, Angela Merkel estime qu’elle pourra « dormir tranquille, même s’il y aura bien sûr des différences politiques, ça va de soi. »
La classe.
23 octobre – Matteo Salvini, ancien ministre de l’intérieur d’Italie, devant le tribunal de Palerme
Un exemple d’efficacité judiciaire qui nous vient d’Italie : Matteo Salvini, l’ancien ministre de l’intérieur d’Italie, comparait devant le tribunal pénal de Palerme, accusé d’avoir en aout 2019 bloqué en mer 147 migrants sauvés par l’ONG Open Arms, les laissant dans des conditions sanitaires désastreuses. Le bateau était amarré au large de l’île italienne de Lampedusa, mais le ministre lui avait interdit d’accoster.
Les migrants n’avaient été autorisés à débarquer que grâce à une ordonnance émise par la justice sicilienne après une inspection à bord qui avait confirmé la gravité de la situation sanitaire sur le navire surpeuplé.
Salvini, accusé de séquestration de personnes et d’abus de pouvoir, risque jusqu’à quinze ans de prison. Commentaire du leader en perte de vitesse : « Le procès voulu par la gauche et par les partisans de l’immigration clandestine commence : combien cela coûtera-t-il aux citoyens italiens ? ». Complètement à côté de la plaque…
27 Octobre – La Pologne condamnée à une astreinte d’un million d’euros par jour pour atteinte à l’indépendance de la justice
Ce 27 octobre, la Pologne a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à payer à la Commission européenne une astreinte d’un million d’euros par jour, pour ne pas avoir mis fin aux activités de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, qui menace directement l’indépendance des juges.
Varsovie ne contestait pas vraiment cette législation, mises en place en 2017, autorisant des actions directes du gouvernement dans le fonctionnement de cette juridiction disciplinaire, mais ces mesures étaient estimées nécessaires pour éradiquer la corruption au sein du système judiciaire.
Le 15 juillet, la CJUE avait ordonné à la Pologne de faire cesser immédiatement les activités de cette chambre, qui bafoue l’indépendance des juges.
Mateusz Morawiecki, le chef du gouvernement, s’était engagé en aout à abolir la chambre disciplinaire, mais le nécessaire n’a pas été fait, et la Commission avait réclamé à la CJUE d’imposer des sanctions.
Réponse claire de la CJUE expliquée dans un communiqué. : « Les systèmes judiciaires de l’UE doivent être indépendants et équitables. Le respect des mesures provisoires ordonnées le 14 juillet est nécessaire afin d’éviter un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union européenne ainsi qu’aux valeurs sur lesquelles cette Union est fondée, notamment celle de l’Etat de droit ».