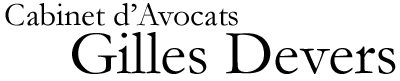Excellent entretien avec le Professeur Bruno PY de l’université de Lorraine, spécialiste de droit médical et pénal, publié par Le Point, le 13 mai 2020. Le Professeur explique comment on est passé du droit de la santé au flicage sanitaire, et il déplore : « Même sous Vichy, les hôpitaux ont su garder le secret »… Propos recueillis par Nicolas Bastuck.
Le Point : Que pensez-vous du nouveau dispositif de fichage entré en vigueur le 11 mai ?
Bruno Py : Il ouvre une nouvelle brèche dans la violation du secret professionnel et médical, et c’est inquiétant. Il y a eu des précédents, je pense aux dispositions récentes visant à lutter contre les violences intrafamiliales, mais, pour la première fois, cette violation n’intervient plus dans l’intérêt supposé du patient, ni même de son entourage, mais au nom d’un impératif de santé publique qui, de mon point de vue, relève davantage de la surveillance que de la sécurité sanitaire. Tout le monde, en effet, est à peu près d’accord pour dire que le double fichage qui se met en place ne sera pas d’une grande utilité, dans la lutte contre la propagation du virus.
Vraiment ?
À supposer qu’il faille lever le secret, ce que je conteste avec vigueur, et en se plaçant uniquement sur le terrain de l’efficacité, il aurait fallu un traçage numérique, des dépistages massifs et des brigades serrées, bref, un dispositif à la coréenne, moyens dont nous ne disposons absolument pas en France. De quoi parlons-nous ? Des médecins vont alerter l’Assurance maladie, qui tentera de joindre à son tour les personnes censées avoir été en contact avec leur patient. Pour leur proposer un test ? Nullement, en tout cas pas immédiatement. Dans un premier temps, on leur demandera surtout de rester chez elles, en attendant de pouvoir effectivement les tester. Ma collègue Caroline Zorn, dans un article (« État d’urgence pour les données de santé », sur Dalloz.actualité.fr), a trouvé la bonne formule lorsqu’elle explique que depuis le début de l’épidémie, la France adapte en permanence ses méthodes à ses moyens – qui sont faibles –, alors qu’il faudrait faire le contraire. On a choisi de peu tester, car on ne disposait pas de tests ; on a enfermé tout le monde alors qu’il aurait fallu tester massivement et confiner de manière ciblée. Aujourd’hui, on va cerner les malades et leur tourner autour, sachant que les tests PCR qui seront utilisés ont un taux de « faux négatif » de 30 %. Il va y avoir des trous dans la raquette, sans parler des « asymptomatiques ».
Quel intérêt, alors ?
De mon point de vue, ce dispositif d’une faiblesse redoutable n’a d’autre but que de procurer à la population un sentiment de sécurité. Pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, il s’agit en fait d’une illusion.
Qu’aurait-il fallu faire ?
Utiliser ce qui existe, à savoir la liste des maladies à déclaration obligatoire – une trentaine au total, essentiellement infectieuses. La peste, le choléra, la tuberculose ou le chikungunya y figurent, alors pourquoi pas le Covid-19 ? On l’a dit, car nous ne disposons pas de tests fiables et en nombre suffisant. Le suivi des personnes « contacts » qui nous est proposé ici – pardon, imposé – est une surveillance colorée de sanitaire. Ce n’est pas pour rien si le Haut Conseil de la santé publique et les ARS (agences régionales de santé) ont refusé d’organiser les choses, laissant l’Assurance maladie prendre la main. Or, cet organisme fait du contrôle, pas de la médecine.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé que si le Covid-19 n’était pas une maladie à déclaration obligatoire, « il en avait le goût, la couleur et l’odeur »…
Vous constaterez que ce n’est pas le choix qui a été fait. Le gouvernement a fait le choix de la surveillance des malades, de leurs proches et de leurs contacts, créant des fichiers, un outil numérique aux contours encore flous, à défaut de pouvoir assurer une prise en charge individuelle et de mener une politique de prévention digne de ce nom.
Lorsque l’épidémie de sida a démarré, les mêmes questions se sont posées sur les chaînes de transmission, les cas contacts, la protection et la contagion des personnes séropositives… Comment les a-t-on réglées ? L’ordre des médecins a, en 1994, résisté à la pression d’une partie de la société, refusant de déroger au secret, condition de la confiance que le patient porte à son médecin. En 1920, le même choix avait été fait lorsque la peste était réapparue dans plusieurs foyers de contamination, à Saint-Ouen et Marseille, notamment. Même sous Vichy, les hôpitaux ont su garder le secret, refusant de dénoncer les « terroristes » (les résistants) qu’ils prenaient en charge. Le Pr Louis Portes, président du conseil de l’ordre des médecins, avait en son temps théorisé l’idée selon laquelle « il n’y a pas de médecine sans confiance, pas de confiance sans confidence, pas de confidence sans secret ». « Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés », proclame le serment d’Hippocrate. Le code de déontologie des médecins rappelle que le secret n’est pas le privilège d’une corporation, mais une garantie pour le patient, sujet autonome et responsable.
Et voilà qu’on lâche tout en nous faisant croire qu’en dérogeant au secret, on obtiendra la sécurité. Si je voulais paraphraser Churchill (« Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre »), je dirais qu’avec la loi du 11 mai 2020, on a perdu le secret sans gagner la sécurité. Je ne m’explique pas que l’ordre des médecins ait pu céder à la peur et accepter cette surveillance individualisée et identifiante. Il a suffi d’un virus présentant un taux de létalité de 1 % pour que toutes les digues cèdent : sur le consentement, le secret médical, la pénalisation de la prévention avec la création d’une infraction de non-port du masque…
Dans un but épidémiologique, peut-être : il s’agit d’identifier les foyers de contamination pour casser les chaînes de transmission…
On disposait de tous les outils pour le faire, je pense notamment au réseau Sentinelle. On a su gérer les choses quand les premiers foyers de contamination se sont déclarés aux Contamines, dans l’Oise ou à Mulhouse. Sauf que là, ce n’est plus l’intérêt du patient qui est en jeu, mais celui de la société. On ne parle plus de santé publique mais d’autre chose. J’emploie le terme de surveillance, mais disons les choses : le suivi direct, immédiat et permanent des personnes infectées qui se met en place est un flicage organisé. Flicage sanitaire, certes, mais flicage tout de même. Permettez-moi de citer Michel Foucault, qui décrit un système de police et de quadrillage de la population sur le modèle de la surveillance au temps de la peste : « Il faut repérer les porteurs du mal, il faut les surveiller, voire les enfermer. » Nous y sommes ! À défaut d’agir et de prévenir, on veut tout voir de l’épidémie, en tout cas tout pouvoir voir, de manière à compter les morts, les guéris, le nombre de patients en réanimation…
Quels risques le juriste que vous êtes pointe-t-il dans le dispositif qui se met en place ?
La question est simple : la fin justifie-t-elle tous les moyens ? Dans un État de droit, la réponse est non. Celui-ci impose de respecter certains principes, y compris quand l’objectif mis en avant pour y déroger est noble. On joue aux apprentis sorciers en accréditant l’idée que le secret médical, le respect de la vie privée sont des valeurs désuètes, dépassées. En considérant que ce que l’on va confier à son médecin traitant va se retrouver dans les fichiers des labos, des pharmaciens, de la médecine du travail ou de la Caisse primaire d’assurance maladie, on sape la confiance, sans laquelle il n’y a pas de médecine possible. Certaines sphères de la vie privée doivent demeurer inaccessibles à l’autorité étatique, la santé en fait partie. L’intimité et la vie privée sont le propre de la liberté.
Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions du texte, émettant par ailleurs quelques réserves d’interprétation.
En effet, et il faut saluer cette décision. Les sages ont agi promptement, ils ont parfaitement vu les problèmes qui se posaient. Ils ont rappelé qu’il ne pouvait y avoir de privation de liberté sans contrôle du juge ; ils ont interdit l’accès des données aux personnes dont la fonction ne relève pas directement de la lutte contre l’épidémie ; ils ont indiqué que les données d’identification d’une personne infectée ne pouvaient être transmises à ses contacts sans son autorisation ; qu’elles ne sauraient être conservées indéfiniment… Le Conseil s’en est tenu au principe de la vie privée et s’est abstenu d’invoquer le secret médical. Il ne pouvait malheureusement en être autrement, aucune norme supérieure à la loi ne protégeant ce secret.
Cette décision vient rappeler que la peur de la maladie, de la souffrance et de la mort ne saurait justifier tous les moyens et l’abandon de tous nos principes. Suffira-t-elle à les préserver ? On peut en douter.